
A PROPOS ET TABLE DES MATIERES SUIVENT.
à propos
Les séries qu’on propose ici sont celles dont l’on se souvient intensément, qui ne sont donc pas celles englouties mécaniquement pendant des nuits d’insomnie, dans lesquelles les images se succèdent automatiquement, le sentiment en repos. Notre part enfantine se laisse toujours avoir lorsque l’histoire commence, même si elle est insipide et mal tournée. C’est notre côté fainéant, récepteur du vide, lequel, il est vrai, repose l’esprit, mais laisse une impresson de méchante fatigue qui s’évanouit quand la série est bonne.
Remerciements à Sens critique, Télérama (Dieu, qu’il est dommage, pour le plaisir du texte, que cette revue magnifique emplie de talents, ait plongé dans le wokisme primaire et l’insoumission de principe, dans la ligne éditoriale du Groupe de presse auquel elle appartient), Wikipédia, et autres sites en ligne, toujours cités quand on colle une critique.
LA TABLE DES MATIERES EN TÊTE DE LA SECTION POURRA AIDER. UN CLIC SUFFIT POUR ATTERRIR OU L’ON VEUT. ON S’EST PERMIS DE METTRE UNE OU PLUSIEURS ETOILES ASTERISQUE (*) DEVANT LE TITRE DE CELLE QUE J’APPRECIE LE PLUS, MÊME SI, EVIDEMMENT, “BETTER CALL SAUL” EST LA MEILLEURE DE TOUS LES TEMPS ET QUE “FLEABAG” OU “THE BEAR” SONT DE PETITES MERVEILLES, COMME “FRIDAY NIGHT LIGHTS“, NUL NE POUVANT ME CONTREDIRE PUISQU’AUSSI BIEN, IL N’EXISTE PAS DE FONCTION “COMMENTAIRE ” SUR LES PAGES. CERTAINS TITRES SE RETROUVENT DANS PLUSIEURS RUBRIQUES. CE NE SONT PAS DES ERREURS.
HORS CADRE. TWIN PEAKS, MÈRE DE TOUTES LES SÉRIES, CHEF-D’OEUVRE DE DAVID LYNCH

8 JANVIER 2026. Arte TV, chaine merveilleuse, même si comme Télérama, elle croit pouvoir exister par le wokisme alors qu’il suffit de plonger dans l’Océan Qualité, nous offre les 3 saisons de TWIN PEAKS, chef d’oeuvre et “matrice” des séries. Il faut, vite, faire comme moi, regarder à) nouveau, porte de chambre fermée.
Je donne, sympathique envers des idiots idéologiques (les “idiologiques” du même Télérama, que je soutiens malgré tout, qui vaut mieux que Télé 7 jours, même si je connais pas cette revue, un article excellent. Dommage et encore dommage pour cette revue, remplie de talents qui se fondent dans une ligne grise et jouent, comme le garçon de café Sartre, à être des wokistes propalestiniens qu’ils ne peuvent être en écrivant que “Twin Peaks est la matrice de toutes les séries”.
Pourquoi “Twin Peaks”, de David Lynch, est la matrice de toutes les séries
En 1990, le réalisateur américain, mort ce jeudi 16 janvier à 78 ans, signait son chef-d’œuvre absolu : la série culte “Twin Peaks”, découverte en France sur La Cinq… Un objet inédit, à la fois hommage à un monde révolu et totalement novateur. Kyle MacLachlan alias l’agent Dale Cooper appréciant son café et Sherilyn Fenn dans le rôle d’Audrey Horne, dans la saison 1 de « Twin Peaks » (1990). Lynch – Frost Productions / Alamy /AKG-images
Par Caroline Veunac
Publié le 08 janvier 2026 à 17h34
Le 8 avril 1990, David Lynch a fait une bonne blague aux spectateurs de la chaîne américaine ABC. Ceux qui avaient consulté leur programme télé ce jour-là pensaient s’asseoir devant un polar classique. Une lycéenne nommée Laura Palmer est découverte sans vie au bord du lac d’une bourgade forestière, le visage violacé, « wrapped in plastic »(emballée dans du plastique). Un agent du FBI bien élevé vient mener l’enquête. Révolutionnaire, ça ? Pourtant, très vite, le public voit que quelque chose est différent. La mère de la défunte pleure trop fort, elle pousse même des cris déments sur le cercueil de sa fille. La courtoisie de Dale Cooper, ce détective amateur forcené de café et de tartes à la cerise, confine au burlesque.
À lire aussi
David Lynch est mort : on a classé tous ses films, du plus hermétique au chef-d’œuvre absolu
La musique est étrangement langoureuse. Et pourquoi ces gros plans insistants sur les objets inanimés qui peuplent la maison des Palmer ? Sous couvert d’une soirée comme les autres, le cinéaste, entre Blue Velvet et Sailor et Lula, est en train de pirater en douceur l’esthétique télévisuelle. Avec la complicité du scénariste Mark Frost, il fait du whodunnit un voyage mental labyrinthique, horrifique et drolatique, qui envoûte aussi bien les cinéphiles que le grand public. Et en l’espace de deux saisons (complétées par une suite vingt-sept ans plus tard), Twin Peaks devient la série de toutes les séries.
Le début de la télé postmoderne
Enfant des années 1950, ballotté de l’Idaho à l’État de Washington (où se déroule Twin Peaks), David Lynch est arrimé au téléviseur : son imaginaire se forme au contact des soap operas de l’époque, avec leur ambiance suburbaine et leur narration intarissable, qui requiert de flamboyants coups de théâtre, du mélodrame à gogo et parfois de faire revivre les morts. Twin Peaks, pour laquelle David Lynch et son cocréateur Mark Frost disent s’être inspirés de Peyton Place (1964-1969), est d’abord un pastiche amoureux de ces feuilletons à rallonge. Un hommage à la télévision d’un monde révolu, mâtiné d’une peur du noir et d’une fascination pour l’étrange, qu’on imagine conséquentes au visionnage précoce de LaQuatrième Dimension.
À lire aussi :
Mort de David Lynch, immense cinéaste qui conjuguait le monstrueux et le sublime
Twin Peaks détourne les conventions du soap et les pousse jusqu’à l’horreur, jusqu’à l’absurde ou jusqu’au romantisme fou. Ces outrances en font un objet inédit, et la matrice d’une nouvelle écriture. Twin Peaks marque le début de la télé postmoderne : avec elle, on entre de plain-pied dans l’ère du méta, du mélange des genres et des séries à énigmes. Elle annonce également l’émergence des séries d’auteur. Lynch en signera coup sur coup deux autres, On the Air (1992) et Hotel Room (1993), mais sa manière de déconstruire les codes est devenue la norme en imprégnant celles des autres, deLost ou Les Soprano, dans les années 2000, jusqu’aux récentes The OA, Reservation Dogs ou La Mesías.
Une œuvre hybride
Venu du cinéma expérimental, Palme d’or à Cannes pour Sailor et Lula quelques semaines après le lancement de Twin Peaks, peintre à ses heures, Lynch est avant tout un créateur de formes, un esthète hanté de visions équivoques. Une anomalie au sein d’une industrie télé qui tend à privilégier la solidité du scénario. Avec Twin Peaks, le réalisateur adopte les tropes du médium télévisuel sans renoncer à la singularité de son regard. À la clé, une œuvre hybride, où l’intrigue policière est lardée de mouvements de caméra insolites, lents zooms, ralentis, plans récurrents sur un arbre qui bruisse ou sur un feu de signalisation la nuit…
À lire aussi :
L’inconscient cinématographique de Twin Peaks se trahit dans la figure de Laura Palmer, blonde iconique et suppliciée dont le visage bouffi par les eaux évoque celui de Marilyn sur son lit de mort (à laquelle Lynch rêvait de consacrer un film), et qui se dédouble en sosie aux cheveux noirs, comme dans Vertigo. Ces signatures et résonances, étoffées par la partition planante du compositeur attitré de Lynch, Angelo Badalamenti, donnent à la série une beauté sensorielle qui transforme le salon en salle obscure, et créent des instants qui échappent à l’efficacité narrative. Un peu trop au bout du compte : lestée d’inutiles digressions scénaristiques, la saison 2 perd ses spectateurs et signe l’arrêt de mort de la série. Lorsque Twin Peaks renaît en 2017 avec une miraculeuse troisième saison baptisée The Return, le geste s’est radicalisé, tirant plus encore vers le formalisme. Entre-temps, Lynch aura ouvert la porte de la télévision aux réalisateurs de cinéma, qui, de Nicolas Winding Refn à Jane Campion, se bousculent aujourd’hui au portillon des séries.
L’héritage lynchien
Si déstabilisante soit-elle, Twin Peaks est un succès public, jusqu’en France où les spectateurs de La Cinq s’échangent leurs VHS en 1991. Culte, la série l’est dès son origine — on dit même que la reine d’Angleterre aurait interrompu une entrevue avec Paul McCartney par peur de manquer un épisode. Devenue un phénomène culturel, elle s’imprime sur des tee-shirts (« C’est moi qui ai tué Laura Palmer ») et fait l’objet de multiples clins d’œil dans d’autres séries, comme Les Simpson ou la comédie policière Psych (2006). Cet engouement s’ancre dans le fétichisme de la série : Bob, le terrifiant esprit qui visite Laura ; la red room, cet outre-monde bordé d’un rideau rouge où Dale va chercher la trépassée ; la tarte à la cerise, que les touristes vont déguster dans le diner de la vraie ville qui a servi de décor à Twin Peaks…
À lire aussi :
“Twin Peaks” n’existe pas, mais nous y sommes allés quand même
La cristallisation collective est alimentée par la fin, ouverte à l’interprétation. L’idée d’un mystère jamais résolu a contaminé notre rapport aux séries, qu’il produise de l’obsession voyeuriste (le genre true crime), des déductions et de la déception (Lost et ses questions sans réponses) et parfois un regard critique (Laura Palmer n’est-elle pas à l’origine de la vague de féminicides qui inondent les séries jusqu’à l’overdose ?). Quant à l’équation de départ — un macchabée vient révéler les secrets d’une petite communauté bien sous tous rapports —, elle est devenue celle d’un nombre incalculable de séries américaines (Desperate Housewives), scandinaves (The Killing) ou françaises (Les Revenants ou Polar Park). Parfois jusqu’à l’épuisement — rien de pire qu’une lyncherie ratée. Mais à chaque fois que l’on croit l’héritage usé, une œuvre vient nous surprendre : dans le film I Saw the TV Glow, sorti l’année dernière aux États-Unis, des jeunes accros à une série télé zonent dans une banlieue résidentielle aux frontières du surnaturel. C’est Twin Peaks chez les milléniaux. Et la preuve que l’esprit de Lynch est bien vivant.
LES PLUS OU MOINS RECENTES ( ou découvertes récemment)
ouvertes récemment)
THE BEAST IN ME

extrait TELERAMA
Claire Danes et Matthew Rhys lancés dans une jouissive valse macabre
Une auteure à succès rongée par le deuil retrouve son inspiration lors de l’arrivée de son voisin, un magnat de l’immobilier froidement monstrueux et principal suspect dans le meurtre de sa femme. Un thriller qui dissèque la masculinité toxique de façon inspirée.
Claquemurée dans le confort — relatif — de sa grande maison, Aggie Wiggs (Claire Danes) vit au milieu des fantômes. Celui de son fils, tué cinq ans auparavant dans un accident de voiture. Celui de son mariage, qui n’aura pas survécu au drame. Celui d’une gloire fanée, vite remplacée par l’austérité des quatre coins d’une page blanche. Car Aggie Wiggs n’arrive plus à écrire — un comble, pour une autrice de best-sellers. Et voilà justement que le riche héritier d’un empire immobilier (Matthew Rhys, The Americans) emménage dans la maison d’à côté. Lui, et le parfum de scandale qui lui colle à la peau : si personne n’a jamais réussi à le prouver, tout l’accuse du meurtre de sa femme, disparue sans laisser de traces. Le voici, le sujet du prochain Aggie Wiggs.
Quelle musique agréable que ces « Jesus ! » intempestifs, poussés par une Claire Danes au meilleur de sa forme ! L’intense actrice fait de cette femme au bord de la crise de nerfs, impulsive, erratique, la petite sœur de Carrie Mathison (Homeland) — une filiation renforcée par la présence de Howard Gordon, producteur de la série d’espionnage, aux manettes de cette nouvelle pépite Netflix.
Mais plus qu’un thriller inspiré — et sublimé par la caméra d’Antonio Campos — avec agents spéciaux insubordonnés (ici David Lyons), chausse-trappes et coups bas, la série fait surtout l’anatomie d’une masculinité toxique grise d’un pouvoir meurtrier. Face à l’empressement échaudé de Danes se dresse la violence froide, implacable, souriante même, d’un Matthew Rhys chargé de personnifier cette monstruosité en puissance. Et le duo des contraires de se lancer dans une valse macabre au rythme du Psycho Killer des Talking Heads. Un jeu du chat et de la souris jouissif sur fond d’intrigues politico-économiques, où prédateur et proie sont pareillement à même de réveiller la bête qui sommeille en chacun d’eux.
Série créée par Gabe Rotter (États-Unis, 2025). 8 × 50 mn. Avec Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow. Sur Netflix.https://www.youtube.com/embed/sQQH7vESqGg
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite préalable de Telerama, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos Conditions Générales d’Utilisation.
Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@telerama.fr.
DOWN CEMETERY ROAD
Emma Thompson et Ruth Wilson, géniales en tandem d’espionnes
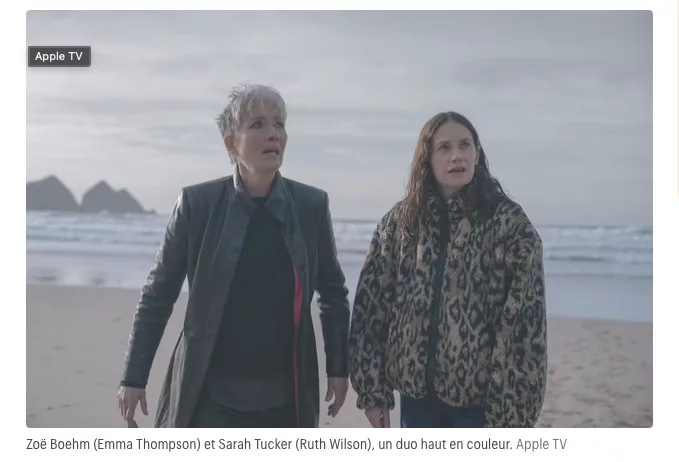
L’une est une détective privée endeuillée, l’autre est obsédée par la disparition d’une enfant… Ensemble, elles vont mener l’enquête sur un possible scandale d’État. Après “Slow Horses”, une nouvelle série réussie adaptée d’un roman de Mick Herron.
Zoë Boehm (Emma Thompson) et Sarah Tucker (Ruth Wilson), un duo haut en couleur. Apple TV
Publié le 29 octobre 2025 à 18h30 Mis à jour le 31 octobre 2025 à 16h34
Ce soir, Sarah Tucker, restauratrice d’œuvres d’art, et son compagnon, un homme d’affaires ambitieux, reçoivent un potentiel client de ce dernier. Un dîner diplomatique, donc. Entrée, plat, discussions polies, compliments courtois, cirage de mocassins… Quand, soudain, avant même l’arrivée du plateau de fromages, une déflagration souffle les vitres du charmant pavillon niché dans la banlieue d’Oxford. Voilà qui ne devrait pas faciliter les affaires entre les deux hommes… Mais qui a de quoi nous plonger, sans aucune forme de ménagement, dans Down Cemetery Road, polar adapté des écrits de Mick Herron.
En 2003, l’auteur britannique imaginait dans son premier roman une association improbable entre Sarah, obsédée par la disparition d’une fillette dans l’explosion susmentionnée… et Zoë Boehm, détective privée, dont le mari vient d’être retrouvé mort. Le lien entre ces deux affaires ? Sans trop en révéler, cela pourrait bien avoir à voir avec un possible scandale d’État. Suspense, retournements de situation, plongée dans les arcanes du renseignement britannique (décidément rarement dépeint par Mick Herron sous son meilleur jour) et cynisme de rigueur… Down Cemetery Roaddevrait contenter les aficionados de Slow Horses, autre adaptation d’Herron, sur Apple TV.
Confidences…
Le créateur de “Slow Horses” : “J’aime placer des gens normaux dans des situations hors du commun”
Moins spectaculaire (mais pas non plus avare de scènes d’action), la série transposée à l’écran par Morwenna Banks mise avant tout sur son tandem de comédiennes truculentes. Emma Thompson, en forte tête indépendante (et fouineuse), touche lorsqu’elle fend l’armure. Tandis que Ruth Wilson surprend en oiseau tombé du nid, finalement pas si fragile. Deux personnages très complémentaires face à l’adversité… et aux complots d’État.
Série d’espionnage adaptée par Morwenna Banks (Royaume-Uni, 2025). Avec Emma Thompson, Ruth WIlson, Adeel Akhtar. 8 x 50 mn. Disponible sur Apple TV.https://www.youtube.com/embed/0unUwpCfRg0
Synopsis
Lorsqu’une maison explose dans la banlieue calme d’Oxford et qu’une enfant disparait par la suite, Sarah Tucker, une habitante du quartier, se met en tête de la retrouver et sollicite l’aide de la détective privée Zoë Boehm. Toutes deux se retrouvent au coeur d’une affaire complexe, dans laquelle des gens que l’on croyait morts depuis longtemps sont vivants, tandis que certains vivants trouvent très vite la mort.
THE 8 SHOW

Extrait Télérama : sur Netflix : touchant, lucide, poétique… Un “Squid Game”, en mieux
cette série sud-coréenne, sans doute produite pour faire patienter les fans de “Squid Game”, redéfinit le jeu de survie tout en étant bien plus pertinente.
Publié le 26 décembre 2024 à 17h00
Huit personnes surendettées acceptent de participer à un mystérieux jeu d’argent filmé dans un décor clos… Un vulgaire ersatz de Squid Game ? Pas si simple. Certes, Netflix a voulu surfer sur son carton sud-coréen en produisant cette série, mais le webtoon (bande dessinée en ligne) à l’origine de The 8 Show est antérieur (2018) à Squid Game. Surtout, The 8 Show s’avère bien meilleure, en tout cas plus pertinente et moins laborieuse dans sa dénonciation d’une société du spectacle moderne, capitaliste et voyeuriste jusqu’à l’absurde.
La démonstration philosophique (le mythe de Sisyphe et Albert Camus sont convoqués), mais aussi mathématique (il faut sortir la calculette et maîtriser par exemple la suite de Fibonacci), est implacable. Ici, le jeu reproduit une société verticale, avec son lot d’injustices, dans laquelle chaque participant occupe un étage du décor et gagne plus d’argent à la minute que celui qui habite en dessous. Au début tout va bien : la question de la répartition des richesses (le fameux « ruissellement » de haut en bas) et de l’harmonie sociale est au cœur des débats. Mais dans cette télé-réalité retorse, le temps, c’est de l’argent, l’oisiveté n’est pas permise, il faut donner envie aux spectateurs d’augmenter régulièrement le chronomètre général qui, s’il tombe à zéro, sonne la fin du jeu.
Les participants deviennent alors littéralement des « créateurs de contenu » malgré eux, et vont irrémédiablement basculer dans une surenchère violente (âmes sensibles s’abstenir dans les derniers épisodes). L’utopie du vivre-ensemble explose. Satirique plus que cynique, tragi-comique, terriblement lucide au sujet des nouvelles formes de divertissement qui nous entourent, The 8 Show est aussi touchante, voire poétique, dans son désir avoué de retrouver une forme d’authenticité dans la société, désir auquel on ne peut qu’adhérer.
Synopsis
Huit personnes piégées dans un mystérieux immeuble de huit étages participent à une émission tentante mais dangereuse dans laquelle leurs gains augmentent avec le temps.
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite préalable de Telerama, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos Conditions Générales d’Utilisation.
Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@telerama.fr.
CHRONIQUE ARCTIQUE


De mère en fille, et même en petite-fille, cette comédie Netflix explore avec authenticité et originalité la vie des femmes inuites dans le nord du Canada. Touchante et drôle, une réussite !
Par Marianne Levy
Publié le 11 avril 2025 à 20h02
Au nord du Canada, il y a l’Arctique. Et encore plus au nord, la petite communauté de Ice Cove, Nunavut. C’est là que vit Siaja (lumineuse Anna Lambe), jeune mère au foyer. Enfin, vivre est un grand mot puisque son quotidien est calé sur l’agenda de son mari, un mascu toxique à l’ego gonflé à l’hélium. Dans son sillage, elle étouffe. Et finit par le lui avouer au beau milieu d’une partie de chasse au phoque… Évidemment, il ne le prend pas très bien. Une surréaction de trop pour Siaja qui, sa fille de 7 ans à la main, emménage chez Neevee, sa mère… La filiation compliquée ? Rien de nouveau sous le soleil sériel. Sur le papier (glacé), cette Chronique arctique ressemble à une énième déclinaison du genre comédie gentillette menée par une mère courage.
Bonne surprise, Stacey Aglok MacDonald et Alethea Arnaquq-Baril, ses créatrices, prennent le chemin opposé avec un culot rafraîchissant. Des femmes inuites, elles font leur sujet en connaissance de cause. Avec un burlesque assumé, elles dénoncent les restes du patriarcat qui, dans le Grand Nord comme ailleurs, continuent d’empêcher les femmes. Mais elles pointent aussi les autres entraves que les Inuites doivent surmonter. « Tu te conduis comme une fille blanche qui aurait des options », lance Neevee à Siaja. Car mère célibataire, ce n’est pas non plus simple tous les jours. Elle en sait quelque chose, elle, la grand-mère rebelle, qui veille à ce que sa petite-fille sache faire un doigt d’honneur correctement. Irrévérencieuse, la série se révèle aussi touchante grâce à d’excellentes actrices, dont Maika Harper et Mary Lynn Rajskub (24 heures chrono). Toutes déploient une énergie qui évoque Gilmore Girls. Comme quoi, au sud comme au nord, il ne faut pas se fier à la face visible de l’iceberg !
NIGHT MANAGER

REDECOUVERTE
Par Sébastien Mauge
L‘impassible Jonathan Pine est directeur de nuit dans un hôtel du Caire. En pleine révolution égyptienne, il a une aventure avec Sophie, mystérieuse femme qui lui demande de copier des documents compromettants au sujet du milliardaire Richard Roper. Jonathan les transmet aux services du renseignement anglais. Peu de temps après, Sophie est assassinée…
Adaptation léchée, sans être lisse, d’un roman d’espionnage de John le Carré, cette coproduction anglo-américaine tient toutes ses ambitieuses promesses. En premier lieu, celle d’un face-à-face haletant entre la valeur montante Tom Hiddleston, « james-bondien » en diable, et Hugh Laurie, débarrassé de la blouse du Dr House mais pas de son cynisme désespéré. Captivant, et palliant un schéma narratif sans surprise, cet affrontement masculin est magnifié par deux femmes. Susanne Bier et sa caméra sensuelle et scrutatrice, récompensée par un Emmy Award. Et l’indispensable Olivia Colman (Broadchurch), en agent truculente enceinte jusqu’aux yeux comme jadis Frances McDormand dans Fargo.
Synopsis
Au Caire, lors du printemps arabe, Jonathan Pine, directeur de nuit d’un hôtel de luxe, découvre le véritable visage de Richard Roper, un milliardaire qui s’avère être à la tête d’un important trafic d’armes. Il en informe les services secrets britanniques en contactant Angela Burr, qui cherche à arrêter l’homme d’affaires depuis un moment, mais l’opération se solde dramatiquement. Quatre ans plus tard, Pine rencontre à nouveau Roper et accepte d’infiltrer son milieu pour le compte des renseignements. Une série d’espionnage à la tension palpable qui doit sa réussite à la qualité de sa distribution, justement récompensée aux Golden Globes 2017, comme à sa réalisation soignée.
Casting
- Tom HiddlestonJonathan Pine Hugh Laurie Richard Roper
- Olivia Colman ,Angela BurrElizabeth DebickiJed MarshallAlistair PetrieSandy Langbourne Michael NardoneFrisky Hovik Keuchkerian TabbyTom HollanderLance Corkoran Nasser Memarzia Omar Barghati Adeel AkhtarRob Singhal
PLATONIC

extrait Télérama
Par Caroline Veunac
Publié le 24 mai 2023 à 19h05
Ils ne se marièrent pas et n’eurent pas beaucoup d’enfants… Déjà dans Cinq Ans de réflexion (2012), comédie romantique dans laquelle Jason Segel et Emily Blunt repoussaient sans fin le moment de se dire oui, Nicholas Stoller méditait sur l’angoisse de l’engagement. Cette phobie de l’âge adulte toujours pas soignée dans Friends from College, série écrite en 2017 où d’anciens potes de fac relevaient les compteurs. Quelques encâblures plus tard, ça ne va toujours pas mieux : les protagonistes de Platonic, deux amis de jeunesse qui s’étaient perdus de vue, ont certes passé respectivement le cap du mariage, mais leurs retrouvailles vont rallumer la mèche et manquer de tout remettre en question.
Sylvia (Rose Byrne) et Will (Seth Rogen) ont un certain âge, elle, ex-avocate devenue mère au foyer, mi-comblée, mi-frustrée ; lui, ado attardé fraîchement divorcé, accessoirement le Mozart de la bière artisanale. Autrefois, ils formaient un duo festif et fusionnel. Aujourd’hui, l’épouse rangée et l’indécrottable hipster n’ont plus rien en commun… si ce n’est cette petite voix dans la tête qui leur murmure que grandir, c’est mourir un peu. La série met en scène avec grâce ce glissement, qui les conduit, lorsqu’ils se revoient, du constat triste que désormais tout les sépare à la joie, retrouvée dès le lendemain, d’une complicité finalement là, toute proche. Et la comédie qui suit, potache, tient moins d’un remake deQuand Harry rencontre Sally sur la possibilité ou non d’une amitié entre homme et femme que d’une ode unisexe à la régression.
Jeunesse estudiantine
Certes, il y a un mari jaloux et quelques regards doux-amers dans le rétro ; certains gags bien sentis taclent l’horreur de la vie domestique (quand Sylvia et son mari trouvent la maison de leurs rêves et découvrent qu’elle a été le théâtre d’un triple homicide) ou la ringardisation de l’humour des quadras (quand une blague de bureau sur la masturbation passe très mal auprès des collègues de la génération Z). Mais la nostalgie et l’ambiguïté, souvent assorties d’amertume, ne sont pas les moteurs de cette série franchement plaisante. Le cliché veut que l’on regrette sa jeunesse estudiantine lorsqu’on a pris des rides. Platonic va un peu plus loin en célébrant plutôt la liberté de l’enfance, accessible à tous les âges de la vie si l’on trouve le bon camarade de jeu.
Dès qu’ils sont ensemble, Will et Sylvia redeviennent des (sales) gosses, qui se racontent des trucs débiles, font des crises, volent des animaux de compagnie et mentent pour dissimuler leurs bêtises. Bref, ils s’amusent, comme un frère et une sœur de 8 ans et demi – Rose Byrne et Seth Rogen font ça les doigts dans le nez. Simplement divertissante, la série parvient aussi, jusqu’à sa conclusion malheureusement tiédasse, à présenter la puérilité comme une forme de résistance à la corporatisation de nos existences. Quand Will fait son boulot avec amour, ses associés lui répondent productivité ; quand Sylvia décide de retourner au bureau, elle ne tient qu’une journée… Leur amitié platonique est une échappatoire aux rapports de pouvoir, y compris ceux qui régissent les amours sexués.
PLURIBUS

le nouveau coup de génie du créateur de “Breaking Bad”, qui transforme les zombies en gentils
Après les iconiques “Breaking Bad” et “Better Call Saul”, Vince Gilligan revient avec une armée de zombies bienveillants, déterminés à bonifier et unir les hommes. Le résultat est palpitant, y compris (et surtout) dans les scènes les plus banales.
Par Michel Bezbakh
Publié le 07 novembre 2025 à 18h30
«Nous avons trop longtemps rendu les méchants glamours », déclarait récemment Vince Gilligan. On ne s’attendait quand même pas à ce que sa nouvelle série mette en scène une invasion de gentils zombies. Avec Breaking Bad et son spin-off Better Call Saul, le showrunneur a produit deux des meilleures séries de l’histoire, mais aussi des tee-shirts à l’effigie du gangster Heisenberg. Maintenant que les « méchants » sont un peu trop nombreux dans la vraie vie (et à la Maison-Blanche), il appelle à proposer d’autres modèles.
De prime abord, l’héroïne de Pluribus n’est pourtant pas sympathique. La trop rare Rhea Seehorn, découverte dans Better Call Saul, incarne Carol Sturka, autrice de mauvais romans à l’eau de rose hétéronormés, bien qu’elle soit lesbienne et visiblement intelligente. Aigrie, Carol. Alors qu’elle sirote un verre avec sa compagne pour célébrer, en râlant, la sortie de son dernier livre, les gens autour sont tout à coup saisis d’étranges convulsions. Certains meurent, les autres deviennent des espèces de zombies aimables, attentionnés, déterminés à ranger tout ce bordel (cadavres, pannes, dégradations).
Une expérience immanquable
Que se passe-t-il ? On croit comprendre que des aliens ont envoyé un virus sur Terre pour bonifier l’espèce humaine, et fondre toutes les individualités en une seule. Le « je » n’existe plus, l’« autre » non plus, ces néohumains n’ont que le « nous » à la bouche. Hélas (ou pas ?), treize personnes sont restées comme avant. Treize comme le nombre de lettres de la locution latine E pluribus unum (« De plusieurs, un ») qui fut choisie comme devise par les États-Unis pour rassembler ses treize premiers États, avant d’être remplacée en 1956 par, ce n’est pas une blague, In God We Trust (« En Dieu nous croyons »). À vous de chercher les intentions de Vince Gilligan, lui qui regrette les « profondes divisions » de son pays. Autre conseil : laissez votre sensibilité examiner ce que cette œuvre géniale produit sur vous.
À lire aussi :
Car Vince Gilligan est un metteur en scène formidablement réaliste, d’une part, sensoriel, d’autre part. Le monde de Pluribus est tout autant le nôtre que celui de Breaking Bad : il n’est pas facile de porter un corps de 60 kilos, de faire un massage cardiaque, d’ouvrir une porte fermée à clé, on n’est pas à Hollywood. Entrer en contact avec cette sorte de « matérialisme fantastique » est une expérience immanquable.
LE SENS DES CHOSES

Elisa Guedj est formidable, formidable.
J’avais abordé cette série avec une réticence crispée, tant son annonce (“inspirée du trajet de Delphine Horvilleur, rabbine parisienne”) pouvait pour différents motifs (non religieux) me rebuter. J’ai beaucoup écrit sur Horvilleur et ses manipulations médiation-philosophiques, même si je l’aime beaucoup pour son courage et sa tenue. En réalité, il s’agit d’une adaptation libre sur un de ses bouquins sur la mort, laquelle, au demeurant glisse dans la série.
Cette série est très fraiche et Elisa Guedj, je le répète, éblouissante. Je suis tombé amoureux de cette femme que je ne connaissais pas.
EXTRAIT TELERAMA Par Marjolaine Jarry. Mis à jour le 03 avril 2025. Une jeune rabbine strasbourgeoise tente de trouver des réponses aux questions existentielles de ses fidèles, et aux siennes. Un sublime regard sur l’humanité, entre humour et tendresse.
Aperçue dans la série « Drôle », Elsa Guedj campe à merveille le rôle de Léa Schmoll, jeune rabbine de 28 ans.
Ah non, pas la femme rabbin […], ça fait homme-grenouille ! » L’intrépide rapprochement émane du propriétaire (impayable Manu Payet) d’une petite synagogue libérale de Strasbourg au moment d’accueillir, pour son premier poste, la rabbine Léa Schmoll (Elsa Guedj, tout en sobriété, coiffée d’un singulier piquant). Récit initiatique au côté d’une héroïne dont la fonction même est une rareté dans le paysage hexagonal ; regard en coulisses sur un métier qui prend à bras-le-corps le symbolique et le rituel ; inventive parabole prompte à immerger, sans déférence, la foi dans le grand bain de l’existence, la série de Noé Debré et Benjamin Charbit fait entendre la même gamme de convictions qui nous avait cueillie dans Le Dernier des Juifs, réalisé par le premier des deux. Ou comment ne rien escamoter du réel – antisémitisme compris –, tout en désamorçant sa violence par un humour frondeur et une tendresse qui tutoie le courage.
Au commencement était le livre de Delphine Horvilleur, Vivre avec nos morts (Grasset, 2021), patchwork d’histoires récoltées au fil des obsèques où officie la célèbre rabbine. Le duo de scénaristes s’en est librement inspiré pour camper Léa et ceux qui viennent la consulter dans ces moments existentiels – enterrement, mais aussi mariage ou baptême… Un couple se déchire : faire circoncire ou non leur nouveau-né ? Le pilote en dit long en prenant le problème par le petit bout… Le dilemme se vit dans nos chairs, expérience humaine partagée par tous. Confrontée, au fil des épisodes, à l’épaisseur de nos vies minuscules, portée par la vocation et pétrie de doutes, Léa tente de donner un sens aux choses, en puisant dans ces textes sacrés qui n’en ont jamais fini, selon l’art de l’herméneutique talmudique, de susciter d’autres questionnements.
Filant à vélo au bord des canaux de Strasbourg, la rabbine pédale et rétropédale, incarnation d’une pensée en mouvement qui gagne le spectateur. Et son dialogue n’est pas qu’intérieur… En témoigne une fabuleuse scène de débat interconfessionnel où elle s’écharpe avec son homologue masculin orthodoxe, tous deux accaparant le micro et privant de parole les autres représentants de culte, comme ses passe-d’armes à la table familiale, avec son propre père, psychanalyste de son état (Éric Elmosnino)… Sur le terrain des âmes, la concurrence générationnelle fait rage, alimentée par la déception du paternel face à sa progéniture « qui se prend pour Don Camillo ». Depuis leurs chapelles métaphysico-névrotiques, l’irrésistible duo de comédie atrabilaire poursuit pourtant, d’écoute en interprétation, un même horizon : permettre à chacun d’élaborer un récit avec lequel vivre.
« En quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits ? » Lors du repas cérémonial de Pessah, Léa prononce la formule consacrée, cette version interrogative du « Il était une fois » des contes de fées où résonne la recherche de la particularité. On y entend le leitmotiv d’une série qui voit, dans la quête du singulier, le chemin du commun, et dans la célébration de la nuance, une résistance. Alors que le refrain d’Anne Sylvestre J’aime les gens qui doutent vient bercer de son impertinence les dernières scènes, on se surprend à frémir d’émotion : tant d’esprit et d’espoir mêlés, cela nous avait manqué.
TELERAMA et Marjolaine Jarry
MON PETIT RENNE

Par Marion Michel
Publié le 23 avril 2024 à 17h21, Mis à jour le 18 septembre 2024 à 17h48
«Je lui ai juste offert un thé », répétera-t-il. S’il avait imaginé que cette simple tasse allait précipiter sa vie en enfer… Pendant cinq ans, Donny, barman apathique le jour et piètre humoriste la nuit, sera victime du harcèlement de Martha, cliente – à l’œil – du pub du quartier londonien de Camden dans lequel il travaille.
Une avocate au carnet d’adresses présumé doré et au rire dévastateur, plus âgée que lui d’une dizaine d’années et qui, émue par ce geste de gentillesse, s’autoproclame sa meilleure amie, sa soupirante et son meilleur public. Mais leur relation « amicale » naissante vire vite au drame : chaque jour, Martha inonde la boîte mail de Donny, surveille ses allées et venues, rend visite à sa famille, intimide ses parents, agresse sa petite amie. Et que fait Donny ?
C’est une histoire vraie. Celle de Richard Gadd, comédien et scénariste écossais (Sex Education, Outlander) qui joue ici son propre rôle, dans une adaptation de son seul-en-scène du même nom, Baby Reindeer (« bébé renne »), dans lequel il racontait cet épisode traumatique qui a ébranlé sa vingtaine.
On oscille entre dégoût et empathie
Dans la réalité, Martha (Jessica Gunning, qui livre une performance incroyable) ne s’appelle pas Martha et Gadd n’est pas tout à fait l’humoriste désastreux qu’il incarne. Mais à quelques détails fictionnels près, l’histoire est identique : celle d’un jeune homme en quête de reconnaissance artistique harcelé par une femme à la psychologie trouble, qui l’affuble de ce sobriquet étrange, « mon petit renne », et pénètre tous les recoins de sa vie. Et qu’a fait Richard ?
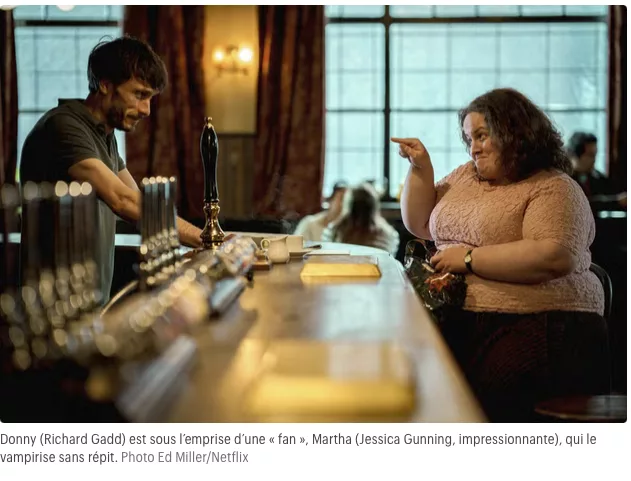
Il en a tiré, pour Netflix, une série troublante et poisseuse. Un drame en sept actes filmé comme un thriller, à la fois glaçant, réaliste et désarmant d’honnêteté. Donny / Richard, remettant sans cesse au lendemain le moment de porter plainte, s’y montre sans complaisance. Et les sentiments de dégoût et d’empathie changent sans cesse de camp : on éprouve de la pitié pour Donny, puis pour Martha. Donny (Richard Gadd) est sous l’emprise d’une « fan », Martha (Jessica Gunning, impressionnante), qui le vampirise sans répit. Photo Ed Miller/Netflix
Dans une mise en scène asphyxiante faite de plans serrés sur les visages et sans profondeur de champ, le malaise sourd graduellement – l’épisode 4 est l’un des plus crus et violents qu’il a récemment été donné de voir. Jusqu’à donner à comprendre que, si Donny laisse le pire arriver sans moufter et se rend coupable à son tour, c’est à cause d’un engrenage traumatique.
Rares sont les miniséries qui recèlent autant de strates. Épisode après épisode, la vie de Donny effeuille ses drames constitutifs : des viols répétés par un homme de pouvoir, la consommation excessive de drogues, le refoulement de sa sexualité. Richard Gadd ne hiérarchise pas les douleurs. Il éclaire, dans toute leur complexité, la spirale de vulnérabilité et l’interdépendance des traumatismes qui l’ont conduit là.
Politiquement très incorrects, Gadd et son double de fiction dézinguent les idées préconçues sur la masculinité contemporaine, sondent les relations d’emprise et mettent en images, sans didactisme, les questions touchant à l’intersectionnalité.
À lire aussi :
Les dix meilleures séries françaises de 2023 selon “Télérama”
Série choc réussie, Mon petit renne n’est toutefois pas exempte de potentielles discordances. Quel crédit accorder à ce genre d’autofiction maintes fois remaniée par son auteur et pouvant conduire à une tentative de mea culpa médiatique ? Le choix d’une actrice en situation d’obésité pour incarner un personnage monstrueux ne réactive-t-il pas un imaginaire grossophobe déjà trop présent à l’écran ? Complexe et fascinante, Mon petit renne ne laisse pas indemne.https://www.youtube.com/embed/rh2-zhyNo6M
Série créée par Richard Gadd (Baby Reindeer, Royaume-Uni, 2024). 7 × 30 mn environ. Avec Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau. Sur Netflix.
THE AMERICANS (UNE REDECOUVERTE)

“The Americans” : si vous avez raté cette série SORTIE EN 2018, il est encore temps de s’y mettre !
A voir ou revoir sur Disney +
Parmi les plus grandes séries de tous les temps uste derrière BETTER CALL SAUL, juste avant FRIDAY NIGHT LIGHT.. Même les scènes de sexe, lassantes dans les séries contemporaines qui croient avoir inventé les ilôts de cuisine californienne comme support d’ébats concentrés sur le décrochage de la ceinture, sont, ici, au top.
Mieux qu’une belle série pour un week-end, sous la couette, sans dormir avec son amoureuse et des plateaux repas.l
Je colle ci-dessous un billet de France Culture sur la série
Chaque jour cet été, on refait la généalogie des séries. Cette semaine, les 7 séries d’espionnage qui ont changé le genre. “The Americans” est un modèle : violente, terrifiante et historique. Une série située dans les années 80 sous la présidence de Ronald Reagan.
C’est la série d’espionnage la plus intense et folle jamais réalisée. Violente, familiale et sans concession. Elizabeth et Philip Jennings forment un couple apparemment sans histoire qui vit dans une banlieue pavillonnaire de Washington DC. Ils travaillent dans une agence de voyage. Ils ont deux enfants : Paige et Henry, et adorent préparer des cookies lorsqu’ils reçoivent.
Sauf qu’en fait ils sont espions russes, mariés fictivement par le KGB dans les années 60 en pleine guerre froide. Ils se sont installés aux États-Unis sous une fausse identité, afin de récupérer des données essentielles. La série les retrouve dans les années 80, alors que Ronald Reagan prépare sa “guerre des étoiles” et parle de la Russie comme de l’axe du mal. Leurs enfants parfaitement intégrés avec leurs jeans patte d’élephant ignorent tout. Comme leur voisin, le meilleur ami de Philip, qui travaille justement au FBI.
Mentir toujours et encore, avoir plusieurs identités, ce sont les thèmes de The Americans, une série vertigineuse créée par un ancien agent de la CIA Joe Weisberg, dont les six saisons sont disponibles sur Prime Video et Disney+. En 2010, on vient de démanteler un réseau d’espions russes infiltrés depuis des années. L’auteur trouve cette pratique anachronique et s’interroge : comment peut-on mentir non-stop à ses proches ? Qu’est ce que cela entraîne pour ceux qui mentent et pour leurs enfants, surtout s’ils apprennent un jour la vérité ?
Mais The Americans est aussi un thriller d’une intensité rare. La série dépeint les méthodes des agents secrets soviétiques : les fioles pour écrire avec de l’encre invisible, les déguisements en infirmière, en vétéran du Vietnam, ou en agent du gouvernement américain, etc. Les deux époux assassinent de sang-froid, à la hache pour qu’on ne puisse pas reconnaître une victime, ou par coup de couteau à la gorge. Les perruques et identités sont multiples. Avec ses acteurs convaincants, menés par Keri Russel, aux faux airs de Nicole Kidman, mère de famille, dévouée au KGB et capable des pires cruautés, la série est enfin fresque historique. Tourne-disques et walkman nous plongent dans les années 80. L’ultime saison s’achève au moment où Gorbatchev ouvre l’URSS et qu’au KGB, cette glasnost ne fait pas que des heureux. Une série juste géniale.


Golden Globes : pourquoi “The Americans” est l’une des meilleures séries de la décennie (et mérite sa récompense)
/2021/12/14/61b8b98ca2e9e_elodie-drouard.png?w=840&ssl=1)
Article rédigé par Elodie Drouard
France Télévisions, Publié le 15/09/2018 07:03Mis à jour le 16/04/2019 14:45
En dépit d’audiences confidentielles, la série “The Americans”, qui s’est achevée au printemps, s’est imposée dans le cœur de ses fans comme l’une des meilleures séries dramatiques de ces dernières années. Un prestigieux Golden Globe, remis dimanche 6 janvier, leur donne enfin raison.
“Je n’arrive pas à comprendre que si peu de personnes soient obsédées par cette série. (…) Il y a tout ce que j’aime dedans : de l’espionnage, de la romance, des perruques affreuses et des courses-poursuites rythmées par Fleetwood Mac.” Pour le magazine Vice (en anglais), comme pour la plupart des critiques américains, la faible popularité de The Americans est un mystère. Boudée tant par le grand public que par les Emmy Awards (les Oscars de la télévision), cette série, dont la diffusion s’est achevée au printemps, est pourtant à ranger aux côtés des chefs-d’œuvre du genre, comme Mad Men ou Breaking Bad.
Dimanche 6 janvier, à Los Angeles (Californie), The Americans a enfin été recompensée par le prestigieux Golden Globe de la meilleure série dramatique. Ce prix, amplement mérité, couronne enfin l’une des œuvres majeures de la décennie, qui a su tenir en haleine son public pendant cinq ans – une prouesse à l’ère dubinge watching –, avant de tirer sa révérence dans un series finale (un dernier épisode) magistral.
Une histoire folle (qui s’inspire de l’Histoire)
Pour vous en convaincre, il faut remonter trois ans avant la première diffusion du pilote de la série. En 2010, le FBI révèle avoir démasqué dix “illégaux”, des agents russes du SVR, le service de renseignement russe (anciennement KGB), installés aux Etats-Unis et se faisant passer pour des citoyens américains grâce à de fausses identités. C’est de cette incroyable révélation, et plus particulièrement de l’histoire rocambolesque – racontée par Le Monde (article abonnés) – d’un des couples arrêtés, qu’est née l’idée de The Americans. “Le président de Dreamworks m’a appelé et m’a demandé si je voulais réfléchir à une série qui s’inspirerait de cette histoire”, raconte Joe Weisberg à Télérama. Cet ancien collaborateur de la CIA, reconverti en scénariste, connaît bien le KGB et les méthodes des espions russes. Très vite, il décide de raconter une histoire similaire, mais en la transposant en pleine guerre froide, sous Ronald Reagan, une période “qui reste encore fascinante pour les Américains”, selon lui.
Aidé du scénariste Joel Fields, il invente les Jennings, un couple d’agents dormants, activés au début des années 1980. Nés en URSS, Nadezhda et Mischa ont été, très jeunes, recrutés et entraînés par le KGB, puis envoyés dans les années 1960 sous de fausses identités aux Etats-Unis. Là-bas, ils deviennent Elizabeth et Philip Jennings, un couple d’Américains apparemment ordinaires qui s’installe dans une paisible zone pavillonnaire près de Washington et y fonde une famille. Le jour, ils élèvent leurs deux enfants, Paige et Henry (nés de leur union sur le sol américain pour renforcer leur couverture), tout en dirigeant une agence de voyage. La nuit, ils endossent une de leurs multiples identités.
A coups de perruques et autres accessoires, ils se métamorphosent pour remplir les missions que leur assigne leur agent de liaison. Leur quotidien : collecter des informations, débaucher des taupes, mais également éliminer tous les potentiels ennemis de l’URSS (et ils sont nombreux à avoir trépassé, comme le rappelle Vulture). Pour pimenter cette histoire déjà folle, les scénaristes créent le personnage de Stan Beeman, un agent du FBI qui vient s’installer juste de l’autre côté de la rue où vit le couple, et qui va se lier d’amitié avec les Jennings, en particulier Philip.
Une série d’espionnage, mais pas seulement
Cette étrange dualité des époux, qui surfent entre convocations au collège et assassinats sordides, est une des clés de la réussite de The Americans, mélange parfait entre le thriller d’espionnage et le drame familial. Car, au-delà des missions d’infiltration, la série dépeint les relations d’un couple formé artificiellement, peu à peu confronté aux affres du quotidien et à l’ambivalence de ses sentiments, d’abord dictés par le sens du devoir avant d’évoluer vers un véritable amour.
/2018/09/13/phpelieAX.jpg?w=840&ssl=1)
“Ce qui fait que The Americans est une des grandes séries de l’âge d’or de la télévision, c’est qu’elle ne parle pas juste d’espions. Tout comme Les Soprano n’est pas vraiment une série sur la mafia, Mad Men une série sur la publicité et Six Feet Under une série sur les enterrements. (…) Comme beaucoup d’autres grandes séries dramatiques, The Americans parle de la famille et de la difficulté à s’affirmer en tant qu’individu, surtout lorsque l’on doit sacrifier une part de son identité pour le bien commun”, explique The Guardian (en anglais).
Des déguisements et des hommes
Pour accomplir leur devoir, les époux Jennings ne reculent devant rien. Véritables pros de l’infiltration, ils ont à leur disposition un impressionnant dressing dans lequel ils puisent pour endosser de multiples identités. Leur talent : s’inventer des vies pour en détruire d’autres. Parmi les personnages récurrents incarnés par le couple, on a une tendresse particulière pour Clark, joué par Philip pendant cinq saisons. Pourtant affublé d’une perruque ridicule, il séduit puis “épouse” Martha, une secrétaire de la CIA qu’il convainc d’installer un micro espion dans le bureau de son patron. Twitter manifestera même son empathie pour cette pauvre femme à travers le hashtag #PoorMartha.
/2018/09/13/phpTvLe4i.jpg?w=840&ssl=1)
Ces incroyables panoplies (de la costumière Katie Irish), typiques des années 1980, ont contribué à l’originalité de la série. Cent vingt tenues différentes ont ainsi été créées pour le couple durant les six saisons, rappelle le site Racked (en anglais) tandis que Vulture (en anglais) s’est amusé à recenser toutes les perruques portées dans la première saison. Si le procédé peut sembler un peu grossier, il n’en est pas moins exact : les déguisements sont toujours utilisés par les services secrets du monde entier, avec plus ou moins de succès, comme nous le racontions dans cet article.
/2018/09/13/phpROQSxZ.jpg?w=840&ssl=1)
L’identité au cœur du récit
Cette question de l’identité, matérialisée par des déguisements parfois risibles, est au cœur de la série. Bien qu’ils soient russes, Elizabeth et Philip se sont parfaitement intégrés dans la société américaine. Au fil des saisons, la brutalité des missions qu’on leur impose sans explication remet en question leur engagement pour une nation dont ils se sont éloignés. Moins endoctriné qu’Elizabeth, Philip, tellement largué qu’il se perd un temps dans des conférences de développement personnel, (attention, spoiler) raccroche même à la fin de la cinquième saison pour se consacrer (sans succès) à la direction de son agence de voyage. Le constat est sans appel : s’il a finalement succombé aux sirènes du capitalisme, Philip était plus doué pour espionner que pour gérer une entreprise.
‘The Americans’ nous confronte aux idéaux de ses personnages, aussi bien aux rêves de capitalisme qu’aux rêves de socialisme, et nous aide, peut-être, à réfléchir à un équilibre qui n’a pas encore été trouvé.Joel Fields, scénariste
Quant à leurs enfants, dont on suit plus ou moins l’adolescence, ils ne savent, au moins au début de la série, rien des origines ni des activités parallèles de leurs parents. De lourds secrets qui deviendront de plus en plus difficiles à préserver au fil du temps (les soupçons de Paige, la fille aînée, débutent dès la fin de la première saison).
Toute la force de The Americans est là. Les missions de renseignement, de soutien ou de déstabilisation des Etats-Unis sont finalement accessoires. Elles ne sont que le prétexte à explorer d’autres problématiques, spirituelles, psychologiques, et à provoquer de l’empathie chez le spectateur.
Une histoire d’amour hors normes
Dès le pilote, on comprend en une scène ce qui se joue pour ce couple factice. “Tu es ma femme !” lance Philip à Elizabeth qui le repousse alors qu’il tente de l’embrasser. Cette dernière, cinglante, lui répond un “Vraiment ?” qui brise toute tentative de rapprochement. Au fil des saisons, les époux vont tour à tour s’observer, se rapprocher, s’ouvrir l’un à l’autre, s’éloigner à nouveau mais, surtout, apprendre à s’aimer.
“Le mariage de façade entre Elizabeth et Philip a laissé place à une intimité timide tout en non-dits, sans cesse contrariée par des missions où la séduction des sources est de mise”, décrypte Constance Jamet, spécialiste séries au Figaro. Et pourtant, jamais un couple ne nous aura paru aussi solide et sincère.
Des acteurs éblouissants et un scénario subtil
Cette extraordinaire alchimie entre les deux acteurs principaux, Keri Russell et Matthew Rhys, est évidemment à mettre au crédit de leur talent. Mais le directeur de casting avait sûrement eu le nez creux. Quelques mois après le début de la diffusion de la première saison, l’actrice annonce son divorce avant d’officialiser quelques mois plus tard sa relation avec son partenaire dans The Americans. Le couple, aussi complice à la ville qu’à l’écran, a depuis donné naissance à un enfant.
/2018/09/13/phpBGMpXP.jpg?w=840&ssl=1)
Et si Matthew Rhys (aperçu auparavant dans la sympathique série Brothers and Sisters) incarne à la perfection un Philip plus perméable qu’Elizabeth (certains diront plus humain), submergé régulièrement par le doute, c’est la performance de Keri Russell (surtout connue jusqu’alors pour son rôle dans la série Felicity) qui marque le spectateur dès les premières minutes du pilote. Séductrice diabolique, glaçante et sauvage, elle incarne la parfaite anti-héroïne, la “tough one”, comme elle le déclarait lors d’une conférence au festival d’Austin en juin dernier, rapportée par Variety. Egalement nommée dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique, elle mériterait amplement de succéder à une autre Elisabeth, Moss, récompensée l’an dernier pour son rôle dans The Handmaid’s Tale et encore en lice cette année.
Le jeu extraordinaire des acteurs est, en outre, porté par un scénario d’une rare subtilité. Sans manichéisme, Joe Weisberg et Joel Fields décryptent la guerre froide en y ajoutant le recul apporté par notre époque. Car, comme l’écrit le New York Times (en anglais), “The Americans a toujours baigné dans la mélancolie, en partie à cause de son cadre historique. On sait depuis le début qu’Elizabeth et Philip se battent pour une cause perdue.”
Fleetwood Mac, Peter Gabriel, The Cure…
La bande-son impeccable est pour beaucoup dans cette ambiance si singulière. Deux morceaux fleuves résument l’importance de la musique dans The Americans. Le chamanique Tusk de Fleetwood Mac, qui rythme la première course-poursuite de la série, quelques minutes après le début du pilote. Et le déchirant Brothers In Arms de Dire Straits, au moment où nos anti-héros scellent leur destin lors du splendide series finale.
Entre les deux, c’est le meilleur des années 1980 : quelques morceaux (parmi les moins commerciaux) de Peter Gabriel, Elton John, Phil Collins, The Cure, Bauhaus, Crowded House ou encore Leonard Cohen ont cristallisé les plus belles scènes de la série. Une sélection fidèle à l’esprit exigeant qui a été celui des showrunnerspendant six saisons.
Excellente de bout en bout, The Americans a su, comme d’autres grandes séries avant elle (Six Feet Under, dont le series finale reste légendaire, mais aussi Les Soprano ou Breaking Bad), terminer avec panache. Le 30 mai dernier, l’aventure des Jennings a pris fin de manière aussi éprouvante qu’éblouissante. Après 71 épisodes où l’on a craint pour leur vie ou leur couverture, Elizabeth et Philip ont mis fin au suspense lent dans lequel le spectateur était enveloppé depuis cinq ans.
“Comme beaucoup d’entre vous, The Americans vont me manquer”, écrivait Barack Obama sur Facebook le 16 juin, quelques jours après la diffusion de cet ultime épisode. Faire le deuil d’une grande série n’est jamais chose aisée mais, on doit l’avouer, quelques mois après, pour nous, c’est toujours aussi compliqué.
Sur DISNEY PLUS OU PRIME VIDEO
EXTRAIT TELERAMA
L’une des séries d’espionnage les plus passionnantes de ces dernières années est disponible en intégralité sur Disney+. Et, comme beaucoup, vous ne l’avez sans doute pas regardée ! Cette histoire d’espions qui s’aimaient, officiers du KGB infiltrés dans la société américaine des années 1980, restera pourtant dans les annales sérielles.
Par Sébastien Mauge
Publié le 03 juin 2018 à 13h00
Mis à jour le 02 juin 2022 à 14h59
Jusqu’au bout, The Americans n’aura jamais renié son identité. Cette singularité inédite qui a fait son charme durant cinq ans. Pour une série d’espionnage mettant en scène des (doubles) vies qui fleurissent dans le mensonge, des missions d’infiltration et des réalités déguisées, au propre comme au figuré, c’est un joli paradoxe. En offrant des adieux émouvants et gorgés d’amertume, le show de la chaîne FX, situé en pleine Guerre Froide, au cœur de l’Amérique de Reagan, a réussi sa sortie. C’est assez rare pour être souligné. Etrangement absente (à quelques rares exceptions près) des remises de prix, et drainant des audiences assez faibles (bravo à FX d’avoir soutenu la série malgré tout!), The Americans est rapidement devenue le secret le mieux gardé des séries américaines. Maintenant qu’elle est terminée, et puisque vous êtes peut-être passés à côté, il est enfin temps de la regarder, comme vous y invite le titre de l’ultime épisode, « START » (1).
“The Americans”, la série qui joue au chat et à la sourishttps://www.youtube.com/embed/kOu8jazlA9k
L’irrésistible alchimie des personnages
Elizabeth et Philip Jennings, espions russes dont le mariage a été arrangé par le KGB, vivent avec leurs deux enfants dans la banlieue de Washington, au début des années 80, juste après l’élection de Ronald Reagan. Ils sont « activés » par la Kommandantur et vont devoir accomplir des missions risquées pour leur pays, tout en élevant Paige et Henry, sous l’œil de leur voisin et ami, Stan Beeman… un agent du FBI. L’idée formidable de la série est de faire naître de vrais sentiments au sein de ce tissu de mensonges. Dans les premières saisons, d’abord uniquement réunis par leur « travail », Philip et Elizabeth finissent par s’aimer « pour de vrai ». Une idylle à l’envers, terriblement sensuelle, au sein d’un foyer pourtant déjà établi, qui fait tomber les masques et doit beaucoup à l’alchimie entre Keri Russell et Matthew Rhys. Pour la petite histoire, les deux acteurs ont imité leurs doubles fictionnels : après quelques mois de tournage, ils se sont mis ensemble !
De l’action ludique et politique
Comment évoquer les années de Guerre Froide sans que cela sente le réchauffé ? La mission, loin d’être impossible, est accomplie haut la main. Grâce à quelque chose de tout bête, parfois laissé de côté dans les fictions contemporaines déshumanisées par les nouvelles technologies : le plaisir du jeu. Celui du chat et de la souris, du travestissement, de la dissimulation et du mensonge frontal. Autant de performances ludiques liées à l’enfance. Les perruques de Philip nous ont souvent fait sourire mais c’est pour mieux jouer le jeu avec sérieux, comme lorsque l’on jouait « à la guerre » dans la cour de récréation. Ce rapport à l’enfance se mue, in fine, en une ambition politique, celle de mettre en parallèle, sans parti pris, deux camps finalement très proches, qui jouent de manière absurde avec le monde, comme le dictateur capricieux de Chaplin. De ce point de vue, si l’on pense à l’administration Trump, la Russie de Poutine et la Corée du Nord de Kim Jong-un, The Americans s’avère résolument moderne et nous montre les racines d’une paranoïa qui n’a eu de cesse d’évoluer. FX
L’espionnage, métaphore du couple
Au-delà du jeu, The Americans est avant tout une brillante réflexion métaphorique sur le couple et la parentalité. Vivre ensemble, c’est vivre plus ou moins en harmonie, malgré les secrets de chacun, les non-dits pour protéger les siens, les rancœurs aussi. Parfois on peut avoir le sentiment d’être des étrangers sous le même toit, ce qui est, littéralement, le cas des Jennings. Les enfants ne sont pas au courant du « travail » de leurs parents. En grandissant, l’aînée Paige cherche à comprendre leur comportement, elle espionne malgré elle, et va finir par briser symboliquement l’intimité d’Elizabeth et Philip en les surprenant en pleine relation sexuelle, au milieu de la série. Scène décisive pour son avenir… La vie de famille des Jennings est construite sur un mensonge, jusqu’à ce que la Guerre Froide s’immisce au sein du couple lui-même dans la dernière saison. Leur amour était-il impossible dès le départ ? Non, mais les dommages collatéraux sont énormes et irrémédiables. Comme dans le cas de la relation entre Stan Beeman et l’espionne russe Nina. Le flou des sentiments fait s’évanouir les frontières mais aussi les identités de chacun. C’est lorsque l’histoire d’amour tente désespéramment de prendre le pas sur l’Histoire tout court que la série délivre de sublimes émotions.
Un rythme mélancolique
Que les choses soient claires : The Americans n’est ni 24h Chrono, ni Homeland. Pour faire ressentir les dilemmes des personnages au quotidien, la série a adopté, après une première saison plutôt enlevée, un rythme plus exigeant, mélancolique, fait de temps suspendus, de scènes de dialogues domestiques et de longues et prenantes missions silencieuses. La mise en scène et le montage elliptique — on les voit rarement se déguiser, leurs visages peuvent changer d’un plan à l’autre, ce qui accentue la notion de perte d’identité progressive des personnages – font la part belle aux parallélismes et symétries entre les deux camps, pour brouiller encore plus la binarité initiale. Certains ont pu tiquer sur le sentiment de sur-place donné par la série (surtout dans sa saison 5) mais c’est oublier un peu vite que les séries sont une course de fond. Et avec sa dernière saison audacieuse, balayant certains de ses principes esthétiques et narratifs (accélération de l’action dans une unité de temps plus resserrée, montée progressive de la tension), The Americans a triomphé sur la ligne d’arrivée et récompensé ses fidèles supporters. FX
Une B.O. pertinente
Contrairement à Stranger Things et autres fictions ancrées dans les années 1980, la série de Weisberg refuse les clins d’œil nostalgiques vintages trop évidents, pour ne pas parasiter le réalisme sombre et tragique de son histoire. C’est particulièrement probant lorsque que l’on se penche sur les choix musicaux. On retrouve ainsi beaucoup de groupes peu connus ou oubliés, comme Quarterflash ou Golden Earring. Les artistes à succès sont bien présents, The Cure, Peter Gabriel, Talking Heads, Fleetwood Mac, Roxy Music, Tears for Fears… mais rarement avec leurs hits populaires.
Par exemple, au lieu de choisir le morceau solaire Just Like Heaven de The Cure, la production a préféré l’ambiance poisseuse et nocturne de Siamese Twins (pour la notion de symétrie) issue de l’album dark Pornography. La musique a un sens. Et lorsque la série sort finalement l’artillerie lourde avec le déchirant With or without you de U2, au cours de l’ultime épisode, c’est pour mieux souligner le désarroi insoluble des personnages, définitivement perdus entre deux pays et obligés d’être dépendants l’un de l’autre pour espérer survivre et ne pas rester seuls. Pour nous, les choses sont plus simples. Contrairement aux paroles de Bono (I can’t live with or without you), nous pouvions très bien vivre avec The Americans mais il sera désormais très difficile de vivre sans.
LE PROBLÈME À TROIS CORPS

le blockbuster virtuose des créateurs de “Game of Thrones”
Les créateurs de “Game of Thrones” font d’un monument chinois de la SF une série chorale, agile et attachante, actualisant le propos du livre en conservant sa philosophie vertigineuse.
Par Caroline Veunac
Publié le 21 mars 2024 à 09h13, Mis à jour le 19 septembre 2024 à 14h56
Trois tomes, pas moins de mille six cents pages et une intrigue courant sur… dix-huit millions d’années. Sur le papier, transposer à l’écran Le Problème à trois corps, monumental édifice romanesque de l’écrivain de SF chinois Liu Cixin, relevait du casse-tête. Aguerris aux adaptations périlleuses, les créateurs de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss, auxquels s’est joint le scénariste et producteur de True Blood Alexander Woo, sautent les obstacles avec une agilité grisante.
De l’intrigue originale, le trio conserve l’essence. Dans la Chine de la Révolution culturelle, Ye Wenjie (Zine Tseng), une jeune scientifique envoyée dans un camp de redressement, se retrouve en situation d’envoyer un message cosmique vers une lointaine civilisation. Après cette entrée en matière très fidèle au livre, la première saison s’en écarte quelque peu, en établissant son épicentre de nos jours à Oxford, où une poignée de génies de la physique sont confrontés aux conséquences de cet acte – qui dépassent l’imagination.
“Le Problème à trois corps” : comment les scénaristes de “Game of Thrones” ont adapté l’inadaptable
Alors qu’une série de suicides, peut-être liée à l’utilisation d’un mystérieux casque de réalité virtuelle, endeuille la communauté scientifique, c’est bientôt l’humanité tout entière qui voit son destin vaciller. Globalisée grâce à un (très chouette) casting multiculturel, où brille notamment l’actrice néo-zélandaise d’ascendance chinoise Jess Hong, la série prend ses libertés. Sans toutefois trahir le cœur philosophique d’une saga littéraire où la fugacité de l’aventure humaine fait face à l’incommensurabilité de l’Univers.
Lecteur ou non du roman original, difficile de résister à un tel niveau de savoir-faire. Partant du mélange de polar et de SF qui caractérise le livre, les auteurs du Problème à trois corps parviennent, en huit épisodes, à créer un monde à la fois fantastique et crédible, à façonner des personnages auxquels on s’attache – d’un flic patibulaire (Benedict Wong) à un scientifique en phase terminale qui n’ose pas avouer ses sentiments à celle qu’il aime (Alex Sharp) –, et même à glisser des clins d’œil aux fans de Game of Thrones. Outre la présence de John Bradley et Liam Cunningham dans de nouveaux rôles, on retrouve ici le style choral de Benioff et Weiss, qui savent mieux que personne alterner les scènes de dialogue, pour faire tenir ensemble leurs enjeux, et les grands moments opératiques à couper le souffle – comme la scène du bateau dans l’épisode 5, impressionnante.
Élans du cœur et survie collective
S’il excellait au niveau macro (la survie du genre humain), le roman de Liu Cixin peinait parfois à passer au niveau micro (les affects du commun mortel). À l’inverse, la série articule avec brio la portée métaphysique de son propos et l’intimité des élans du cœur. Elle parvient également à actualiser les interrogations qui traversent le livre : seize ans après sa publication, les menaces de l’IA et de la catastrophe climatique jettent une ombre encore plus angoissante sur cette histoire, qui met en jeu notre survie collective et ce que nous transmettront aux générations d’après.
À lire aussi :
La science nous sauvera-t-elle ou précipitera-t-elle notre perte ? La question peut donner des sueurs froides, et pourtant Le Problème à trois corps se regarde avec plaisir. Alliant réflexion, émotion et humour, la série renoue avec le plaisir des grands feuilletons à concept des années 2000, du type Lost ou Heroes. Un petit côté vintage qui lui permet d’éviter deux écueils de l’époque : le nihilisme et l’esprit de sérieux.https://www.youtube.com/embed/VHWoTxKUxMM
Saison 1, série de SF créée par David Benioff, D.B. Weiss et Alexander Woo, USA (2024), 8 x 50 mn. Avec Jess Hong, Eiza Gonzalez, Jack Rooney, Liam Cunningham. Sur Netflix à partir du 21 mars.
“Ripley”, la série Netflix qui est une merveille, un petit bijou de série.

On connaît les autres films sur Tom Ripley, adaptés du roman de Patricia Highsmith, le premier avec Delon (Plein soleil),de René Clément, un peu trop soleil et lumière d’agence de voyages, le deuxième avec Matt Damon et Jude Law (le talentueux Mr Ripley de Anthony Minghella de 1999) avec beaucoup de caricatures italiennes, notamment de la Dolce vita, qui n’est pas un grand film malgré les deux grands acteurs également caricaturaux.
Celui qu’on vient de voir est une série Netflix qui vient de sortir, dénommée simplement”Ripley”. Une des meilleures qu’il m’ait été donné de voir cette année (voir mon autre site). Les deux films précités font pâle figure devant cette performance. En noir et blanc dénommé “expressionniste” par les critiques, bunuëlien si l’on veut, avec un fulgurant Andrew Scott, vous savez celui qui joue le prêtre désiré par l’actrice (et scénariste) insensée, dont je suis très amoureux, Phoebe Waller-Bridge, dans la série extraordinaire”Fleabag“, qui concurrence “The Bear” pour emporter la palme des séries du semestre, décerné par un jury qui n’est composé que de moi.
La réalisation est épatante, épatante. C’est le mot employé par un critique et je le reprends. La photographie de rêve sans lèché de circonstance pour ébahis crédules. Le scénario sublimissime.
Il est rare de prendre autant de plaisir dans ces 8 épisodes dont certains font plus d’une heure chacun, vus sans discontinuer une nuit entière. Nuit en noir et blanc, nuit à partager.
Épatante cette série. Un tel talent dans la réalisation et le jeu nous rassurent, nous mettent de bonne humeur, il y a de la verve, de la créativité, de l’intellectualité qui traînent chez les nouveaux réalisateurs et directeurs de de la photo, “mieux qu’avant”. L’art, même sur Netflix n’a pas dit son dernier mot. Et le Caravage, également mis en scène et central dans cette série ne saurait, dans sa tombe de criminel avéré en fuite permanente et aux aguets, lui aussi, s’en plaindre.

Un extrait d’une critique de Télérama
Par Émilie Gavoille. Télérama.
Ce n’est pas la première fois que le personnage d’usurpateur meurtrier né sous la plume de Patricia Highsmith tape dans l’œil d’un auteur-réalisateur. Avant Steven Zaillian (coscénariste, entre autres, de The Irishman, de La Liste de Schindler et de Gangs of New York), qui a écrit et dirigé l’intégralité des huit épisodes composant l’épatante minisérie proposée par Netflix, René Clément et Anthony Minghella avait déjà transposé habilement le roman de 1955 à l’écran, dans Plein soleil (1960) et Le Talentueux Mr Ripley (1999).
Rapide rappel des éléments de l’intrigue pour ceux qui l’histoire avec un œil neuf : un jeune Américain fauché, Tom Ripley, est missionné par le père de Dickie Greenleaf, un jeune Américain très riche, pour convaincre son fils, qui se la coule douce en Europe avec sa fiancée Marge, de bien vouloir rentrer aux États-Unis. Rapidement, Ripley se plaît à rêver la vie de Dickie, au point de la faire sienne.
En lieu et place de l’insolente luminosité méditerranéenne sublimée dans les deux longs métrages précités, Steven Zaillian et le directeur de la photographie Robert Elswith (There Will be Blood, Good Night and Good Luck) – qui accomplit ici encore un travail remarquable –, proposent un noir et blanc somptueux, d’inspiration expressionniste, traversé d’ombres et de lumières. Un écrin visuel à la solitude hantée de fantômes de Ripley, antihéros magnifique toujours au bord de l’abîme. La réalisation y fait souvent allusion, en illustrant le vertige du personnage au détour d’un trajet en bus à flanc de falaise, ou en le cadrant dans des intérieurs grandioses qui le fascinent autant qu’ils l’écrasent.
Ce n’est ni l’ambition sociale ni le désir qui animent le Ripley que compose ici le fascinant Andrew Scott, dont la prestation lorgne davantage vers le Moriarty grimaçant qu’il incarnait dans Sherlock que vers l’inoubliable rôle de « hot priest » qu’il a tenu dans Fleabag. Le moteur de cet esthète psychopathe, qui dépense l’argent de celui dont il a usurpé l’identité et la fortune pour vivre la Dolce Vita de Rome à Venise, c’est une quête absolue du beau, course en avant qui justifie tout, y compris le pire. En témoigne le dernier épisode, qui dresse un parallèle édifiant avec Le Caravage, génie du clair-obscur et meurtrier avéré. Même la beauté a sa part de laideur.
.

ET PUIS UN AUTRE EXTRAIT DE LA MÊME CHRONIQUEUSE DE TELERAMA, EN VERVE
La figure fascinante de Tom Ripley en trois adaptations réussies
Opportuniste vénal chez René Clément, faux naïf chez Anthony Minghella et désormais esthète meurtrier dans la formidable série de Steven Zaillian… Trois visions de l’imposteur créé par Patricia Highsmith, en autant d’adaptations de haute volée.
Par Émilie Gavoille
Publié le 07 avril 2024 à 18h02
Voilà un objet d’une élégance et d’une sophistication que n’aurait pas reniées Thomas Ripley si la romancière Patricia Highsmith, qui lui a donné la vie (littéraire) en 1955, avait prêté à son antihéros arriviste une passion cinéphile. Un noir et blanc expressionniste, des jeux d’ombre et de lumière à faire pâlir les grands maîtres de la peinture, un interprète – Andrew Scott – au firmament dans le rôle-titre…
Ce Ripley en huit épisodes, minutieux portrait psychologique écrit et mis en scène par Steven Zaillian pour Netflix, relève superbement le défi de l’adaptation, d’autant plus relevé que deux longs métrages s’y étaient déjà essayés avec brio : Plein Soleil, de René Clément, en 1960, et Le Talentueux Mr Ripley, d’Anthony Minghella, en 1999. Trois œuvres et autant de regards différents sur cette imposture grandeur nature sous le soleil de l’Italie.
Première rencontre avec Tom Ripley
Un flashforward (en bon français, une prolepse) annonce d’emblée la couleur dans Ripley. En guise de présentations, on découvre l’élégant Américain traînant un cadavre au bas des escaliers de l’immeuble romain où il réside, sous le nom de celui dont il a usurpé l’identité, Dickie Greenleaf. Aucune illusion n’est permise.
En le caractérisant comme un opportuniste vénal, René Clément lui accorde de son côté le bénéfice du doute. Sous les traits d’Alain Delon, Ripley assume sans vergogne d’avoir reçu une grosse somme d’argent pour ramener un jeune Américain flambeur (Maurice Ronet) à son riche géniteur. Mais rien ne prédit qu’il finira, en grand fauve carnassier, par lui ôter son bien le plus précieux – la vie.
Celui qui cache le plus son jeu, c’est incontestablement le Tom Ripley que compose avec talent Matt Damon devant la caméra d’Anthony Minghella. Derrière ses lunettes d’élève trop sage, sa maladresse presque émouvante, on lui donnerait le Bon Dieu sans confession…

De haut en bas, trois interprètes de Tom Ripley : Andrew Scott, dans la minisérie de Steven Zaillian. Alain Delon dans « Plein Soleil », de René Clément (1960). Matt Damon dans « Le Talentueux Mr Ripley », d’Anthony Minghella (1999). Photo stefano cristiano montesi/2023 Netflix, Inc. | Pari films | Paramount
Un triangle amoureux ?
Tom Ripley, Dickie Greenleaf (rebaptisé Philippe dans Plein Soleil) et sa petite amie Marge Sherwood. Trois personnages pour combien de possibilités ? Fortement suggérée par Patricia Highsmith (qui affuble pourtant Ripley d’une peu convaincante épouse dans les romans publiés à la suite de Mr Ripley), l’homosexualité du protagoniste est clairement établie par Anthony Minghella. Qui met notamment en scène le désir de ce dernier pour Dickie (et réciproquement) dans une saisissante scène de bain homo-érotique sur fond de partie d’échecs.
Aucune ambiguïté ne transparaît en revanche chez René Clément, où le triangle amoureux est beaucoup plus classique. Avant tout mû par son ambition féroce, l’arriviste incarné par Alain Delon convoite avec une froideur constante tout ce qui fait l’existence de son ami. Y compris sa fiancée, qu’il finira, de fait, par séduire, moins par attirance véritable que par soif de possession.
L’inclination du jeune homme pour celui qui devient sa proie n’est pas un enjeu de premier plan dans les huit épisodes de Steven Zaillian. Le désir y reste tapi dans les regards tour à tour enamourés ou glaçants d’Andrew Scott. Il campe un Ripley esthète, fasciné par Le Caravage, et tiraillé, comme lui, entre Éros et Thanatos — le second finissant toujours par l’emporter sur le premier.
Le vertige de l’ascension sociale
Née dans l’Amérique de la Grande Dépression d’une mère qui ne voulait pas d’elle et d’un père dont elle a renié le nom, Patricia Highsmith (dont le patronyme est celui de son beau-père) en connaissait un rayon sur l’envie de revanche, autant que sur les déceptions inhérentes à cette aspiration. Une expérience mitigée de l’ascension sociale dont la romancière, qui a toujours été davantage reconnue en Europe que sur la scène littéraire américaine, a naturellement investi son personnage fétiche. Anonyme sans le sou aux États-Unis, Ripley vivra comme un prince en Europe.
Le Talentueux Mr Ripley en livre une lecture romantique, quasi fitzgeraldienne. Le jazz est omniprésent, le nihilisme absent, et l’espoir toujours permis. À travers le regard amusé d’un Greenleaf/Ronet pas dupe, qui reconnaît à Ripley d’avoir su saisir sa chance, Plein Soleil vante l’art de savoir forcer son destin – quitte à ce que ce dernier vous rattrape.
UNE CRITIQUE DITHYRAMBIQUE D’UN CINEPHILE SUR YOU TUBE
PS. On m’a demandé ce qu’était un trailer et un teaser. Je reviens donc pour coller les définitions. Il est vrai que ça fait chic ces mots qui sont des “a-bandes annonces, un peu élaborâtes-rés par les snobs qui peuvent avoir leurs mots à dire. Un TEASER est une annonce très courte d’un film pour allécher le spectateur et le faire attendre sans pour autant « présenter » le film. Tandis que le TRAILER (ou bande-annonce), plus complet, tentera de séduire en mettant en évidence les meilleurs moments du film.
UNE RENCONTRE AVEC LES ACTEURS et LE REALISATEUR (en anglais)
ENTRACTE : FILS DE STING …
Dans le film : Freddy Miles, l’androgyne, fils/fille ? de STING

L’épisode 2 signe l’apparition de Freddie Miles, un ami de Dickie Greenleaf. Dans le livre, comme dans les précédentes adaptations – Plein Soleil avec Alain Delon et Le Talentueux Mr. Ripley avec Matt Damon -, ce personnage est un homme bruyant et extravagant avec de l’embonpoint
Un changement cohérent car il s’inscrit dans la dynamique très queer du récit de Ripley, dont le personnage alimente une certaine ambiguïté sur son orientation sexuelle. Par ailleurs, le choix d’Andrew Scott est loin d’être un hasard puisqu’il est l’un des rares acteurs populaires à parler de son homosexualité librement.
Un père très célèbre : STING
Eliot Sumner est apparu dans d’autres projets par le passé, comme dans Mourir peut attendre – où l’acteur joue un garde de Spectre – ou encore le film The Gentlemen de Guy Ritchie. Au-delà des plateaux de tournages, Eliot Sumner fréquente également la scène avec son groupe I Blame Coco. Une vocation qui n’est pas née par hasard puisque son père n’est autre que Sting, le leader du groupe Police – et également acteur à ses heures perdues.
Elio se dit donc “actrice” et Eliot Sumner est ouvertement lesbienne[1] et genderfluid[2], et utilise des pronoms neutres.
UNE CRITIQUE DU HUFFINGTON
La série Netflix « Ripley » avec Andrew Scott n’a pas grand chose en commun avec le film avec Matt Damon
Une nouvelle adaptation de l’histoire de Patricia Highsmith sort le 4 avril sur Netflix. La série « Ripley » avec Andrew Scott propose une version beaucoup plus sombre du roman.
Par Yamina Benchikh

Andrew Scott, Dakota Fanning et Johnny Flynn dans la série « Ripley ».
SÉRIE TÉLÉ – C’est au tour d’Andrew Scott de se glisser dans la peau de Tom Ripley, après Alain Delon et Matt Damon. Publié en 1955, le roman Monsieur Ripley de Patricia Highsmith continue de séduire les cinéastes. Après le film français Plein Soleil de 1960 avec Alain Delon, et Le Talentueux M. Ripley sorti en 1999 avec Matt Damon, Tom Ripley revient cette fois en série. Netflix s’associe à Steven Zaillian (The Night of) pour raconter ce célèbre thriller. Au casting on retrouve notamment Andrew Scott (Sans jamais nous connaître, Sherlock Holmes) et Dakota Fanning (Twilight, Once Upon a Time in Hollywood).
Disponible depuis le 4 avril, la série se passe dans les années 60. Alors qu’il vit à New York, Tom Ripley (Andrew Scott) est envoyé en Italie par le riche Herbert Greenleaf pour ramener son fils Dickie (Johnny Flynn) au pays. C’est le premier pas vers « une vie complexe faite de tromperies, de fraudes et de meurtres » annonce le résumé Netflix de la série.
Tom Ripley n’est pas le héros malheureux de cette histoire
Dans Le Talentueux M. Ripley, Matt Damon incarne un homme amoureux et mal dans sa peau. Malgré ses talents d’escroc, il reste un personnage attachant et maladroit aux airs d’agneau candide.
Ici, l’intrigue nous plonge dans l’esprit à la fois ingénieux et tordu de Tom Ripley. D’entrée de jeu, on comprend qu’il n’est pas le héros de cette histoire. Andrew Scott joue un homme marginal, menteur et calculateur. Tom n’a pas peur de se frotter au monde criminel dont il connaît les rouages. Bien qu’il ne soit pas parfait à ce jeu, il n’en est pas moins doué.
Dans les notes de production de la série Netflix, Andrew Scott a lui-même qualifié son personnage de « très solitaire ». De ce fait, le spectateur en apprend plus sur sa personnalité et devient complice de ses actes. Pour l’acteur irlandais, l’histoire raconte « ce que c’est que d’être Tom Ripley plutôt que ce que c’est que d’être une victime de Tom Ripley ».
Johnny Flynn joue un Dickie Greenleaf loin des clichés
Dans Ripley, Johnny Flynn propose un Dickie Greenleaf très différent de celui du Talentueux M. Ripley. Il est loin du playboy infidèle et immature campé par Jude Law. « Dickie ne veut pas hériter du statut de gosse de riche. Dans son cœur, il est un artiste bohème, un poète » confie Johnny Flynn. Dickie est un homme respectueux, amoureux et surtout fidèle à Marge. S’il est un peu naïf, il reste perspicace face au monde qui l’entoure.
Une interprétation qui a séduit Steven Zaillian. « Johnny a auditionné, comme 120 autres acteurs. Il s’est distingué par la façon dont il a choisi d’incarner Dickie, non pas comme un gosse de riche gâté, mais plutôt avec une sorte de douce naïveté » a-t-il expliqué dans les notes de production.
Sa relation avec Tom est moins fusionnelle, d’autant que ce dernier est davantage séduit par le train de vie Dickie que par l’homme qu’il est. « Je pense que c’est quelqu’un qui aime la vie et quand il vient en Italie et qu’il est exposé à tout cet art, ces paysages, cette beauté et cette nourriture, il adore ça. Mais les gens avec qui il est, je ne suis pas sûre qu’il les aime » explique Andrew Scott.
L’actrice américaine nous offre une Marge Sherwood fière et intelligente, désireuse de protéger son compagnon. Elle n’a pas peur de confronter Tom ou d’affirmer à voix haute qu’elle ne l’aime pas. « J’ai apprécié que Marge ait l’honneur d’être l’une des seules personnes à se méfier de Tom Ripley, ce qui donne lieu à une relation de chat et de souris entre les deux » déclare Dakota Fanning.

Dakota Fanning et Eliot Sumner font face à Andrew Scott
De même pour Freddie Miles, joué par Eliot Sumner. Il n’est en rien semblable au Freddie grossier et vulgaire de Philip Seymour Hoffman. Ici, c’est un ami dévoué, qui, comme Marge, se méfie de l’arrivée de Tom dans la vie de Dickie.

LA RÉSIDENCE

Dieu que c’est intelligent et drôle ! Dieu que c’est bien joué, que la détective Cupp jouée par Uzo Aduba est remarquable. Dieu que cette actrice est géniale ! Bref, un régal que cette série.
Produite par Shonda Rhimes, à qui l’on doit notamment Grey’s Anatomy, Scandal ou encore La Chronique des Bridgerton, un thriller hilarant, extraordinaire (huit épisodes).

Ce thriller comique de huit épisodes nous plonge en plein cœur de la Maison-Blanche, où un dîner d’État est organisé avec des membres importants du gouvernement du monde entier. Mais la célébration vire au drame lorsque le corps d’AB Wynter est découvert au sol. Il a été assassiné. La détective Cordelia Cupp est alors engagée pour élucider ce crime (presque) parfait. Qui a commis le meurtre ? Comment ? Pourquoi ?
Ce thriller comique de huit épisodes nous plonge en plein cœur de la Maison-Blanche, où un dîner d’État est organisé avec des membres importants du gouvernement du monde entier. Mais la célébration vire au drame lorsque le corps d’AB Wynter est découvert au sol. Il a été assassiné. La détective Cordelia Cupp est alors engagée pour élucider ce crime (presque) parfait. Qui a commis le meurtre ? Comment ? Pourquoi ?
VOIR L’article de tvfestival : https://www.tvfestival.com/en/news/la-residence-5-choses-a-savoir-sur-la-nouvelle-serie-netflix/730
DOUGLAS IS CANCELLED

EXTRAIT TELERAMA, Augustin Pietron-Locatelli. 13/03/2025
Un obscur tweet l’accuse. Douglas, présentateur star affable (quoique mollasson, mais finement interprété par Hugh Bonneville), pilote son journal télévisé en duo avec Madeline (Karen Gillian, énigmatique et brillante dans un rôle pas simple). Il aurait lâché une blague sexiste devant témoins. Lui jure, dans un premier temps, n’avoir rien dit de tel, puis ne pas se souvenir de ses propos. Il n’y a donc pas encore d’incident médiatique, mais un cancel (« annulation » en anglais) en puissance : Douglas risque d’être retiré de l’antenne voire viré. D’autant que Madeline retweete à ses deux millions d’abonnés et commente : « Not my co-presenter ! » Pour l’absoudre (« Je le connais, je n’y crois pas ») ou l’enfoncer (« Je ne tolérerai pas de tels propos de sa part ») ?
À l’écriture de cette minisérie, un « vieux » – c’est affectueux, promis – mâle blanc danse sur une corde plus que raide. Le showrunneur Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who) met en scène son quasi-miroir fictionnel, un sexagénaire puissant de la télé britannique… Avait-on envie de connaître son avis sur ce brûlant sujet d’actualité ? Pas tant. Et pourtant. On est vite séduit par l’emballement d’une fantastique mécanique théâtrale. Épisode après épisode (le troisième, sidérant, remet en scène une entrevue harveyweinsteinesque), la minisérie observe le présentateur et son rédacteur en chef paniquer. Elle excelle à circonscrire l’intrigue à une rédaction en crise, mettant Douglas face à lui-même et à sa famille : son épouse, directrice d’un tabloïd qui pourrait le faire tomber, et sa fille « activiste » qui ne lui pardonnerait pas.
Jamais simpliste malgré quelques blagues faciles (certaines incompréhensions du scénariste sur l’époque y transpirent), cette satire instaure le vertige en se concentrant sur l’homme qui perd pied et non sur la figure publique. Tandis qu’en coulisse, un mauvais auteur est embauché pour écrire la fameuse vanne dont Douglas ne se souvient pas. Sur ARTE TV
ADOLESCENCE
Exceptionnel, 4 épisodes en plans-séquences. Un bijou dans la mise en scène, le sujet, le jeu des acteurs. Après Replay, la plus magnifique des mini-séries.

PS. DONC, 4 EPISODES “PLANS-SÉQUENCES”. JE DONNE CI-DESSOUS LE LIEN WIKI QUI EN DONNE, TRES COMPLÈTEMENT LA DÉFINITION.
Suite…”Adolescence ” sur Netflix : la série dont on ne se remet pas

Pourquoi tue-t-on à 13 ans ? C’est la question centrale de cette fiction britannique en quatre épisodes, magistralement filmés et interprétés. Une claque.
Par Violaine de Montclos
Le Point Publié le 18/03/2025 à 14:30
Les caméras de vidéo de surveillance ont tout enregistré : la déambulation du criminel, minute par minute, dans les rues de la petite ville, et le crime lui-même, sept coups de couteau donnés à la jeune Kate, 13 ans, tuée en plein jour sur un parking. Les preuves visuelles, irréfutables et exposées dès le premier épisode, ne laissent donc aucun doute sur l’identité du coupable. Zéro suspense.
Dès lors, d’où viennent cette tension qui ne faiblit jamais, cette angoisse qui contraint à visionner quasiment d’une traite les quatre épisodes de cette minisérie, comme si une réponse, une clé, allait nous être donnée ? Tournée en quatre plans-séquencesépoustouflants, Adolescence impose au spectateur une immersion irrespirable au sein d’une famille, d’une école, d’un commissariat dont les repères se fissurent, une société ordinaire dans laquelle les adultes, égarés, sont happés par un questionnement auquel rien ne les préparait : pourquoi tue-t-on à 13 ans ?
De l’écran au crime
Que n’a-t-on pas vu, pas compris du monde adolescent, du Far West des réseaux sociaux, de la violence du harcèlement qui sévit dans les cours d’école ? Qui sont en vrai ces jeunes garçons, ces toutes jeunes filles qui ont encore des corps et des visages d’enfant mais vivent, matrixés, désinhibés et hypersexualisés par Instagram, Snapchat et TikTok, comme des hordes sauvages ?

Dès les premières secondes, le décalage entre la gravité des faits et la jeunesse de celui qui les a commis s’impose comme une claque. À l’aube, une escouade de policiers surarmés déferle sur le petit pavillon de la famille Miller, défonce la porte au bélier, se répand en criant dans l’escalier, la salle de bains et les chambres comme s’ils venaient appréhender un dangereux terroriste. Mais celui qu’ils viennent chercher a 13 ans, il s’appelle Jamie, c’est un môme à peine pubère dont la chambre est encore tapissée d’étoiles et qui, d’effroi, urine dans son lit comme un tout petit garçon.
Le spectateur a presque envie de soupçonner le père, il associe inconsciemment ce corps baraqué de plombier quinquagénaire et ce pavillon de banlieue à des images subliminales de violences familiales, d’alcoolisme, pourquoi pas d’inceste. Il se trompe, et il le sait. Mais, durant les quatre épisodes, comme tous les adultes de cette histoire, flics, psy, voisins, parents, il bute sur le mystère et la douceur du petit visage de Jamie, attend une explication, un retournement possible, tout mais pas lui, tout mais pas ce monde d’irréalité numérique et d’enfants criminels

Adolescence, magistralement filmée et interprétée, nouvelle petite bombe de la fiction britannique dont on aimerait tant qu’elle inspire un peu nos paresseux créateurs de séries françaises, ne donne pas de réponse. Mais elle fait subtilement écho, malgré un épisode final un peu trop démonstratif, à nombre de drames récents, et réels, impliquant des mineurs. Et distille surtout une tristesse dont on ne se remet pas. Qu’ont fait ou oublié de faire les adultes pour abandonner leurs enfants dans ce monde numérique dont ils n’ont plus les clés ?
Adolescence, série créée par Jack Thorne et Stephen Graham, réalisée par Philip Barantini, avec Stephen Graham, Owen Cooper, Erin Doherty, Jo Hartley, Ashley Walters (RU, 2025, 4 × 52 à 65 min), sur Netflix
LES FILLES DU FERRY

Sur arte TV jusqu’au 10/11/2025
Au Danemark, une journaliste d’investigation enquête sur la disparition de deux jeunes filles dans les années 80. Très vite, sa soif de vérité va la mener au tueur qui guette sa prochaine proie. Thriller intense et glaçant, la série “Fatal Crossing – Les filles du ferry” est adaptée du best-seller de Lone Theils.
EXTRAIT TELERAMA, par Marinne Lévy, 24/03/205;
Rien ne va plus dans la vie de Nora Sand (Marie Sandø Jondal). Correspondante à Londres d’un journal danois, elle se retrouve plongée au cœur d’un scandale. Son tort ? Sa liaison passagère avec l’une de ses sources. Ce qui n’aurait été qu’une péripétie pour un confrère masculin change tout parce qu’elle est une femme, elle en est certaine. Mais son plaidoyer ne convainc pas sa rédaction. Alors, la journaliste est contrainte de faire profil bas. Elle trouve refuge chez son père pour débrancher. Mais elle y reçoit un courrier anonyme qui la met sur la piste d’un cold case : une affaire de jeunes filles disparues. Elle se lance dans l’enquête.
Fatal Crossing : les filles du ferry s’inscrit dans la pure tradition du Nordic Noir. Genre né dans le roman qui a déferlé sur le petit écran et ne s’arrête pas depuis. Une surabondance qui a produit du médiocre comme du bon. Et, ici, du très bon. Car la série ne se limite pas à jouer la carte de paysages stupéfiants capturés de manière hypnotique par la caméra. Elle se concentre sur ses personnages et les blessures qui les déchirent. Montée avec brio, la dramaturgie se déploie entre complexité et tension redoutable. Impossible de ne pas se laisser happer.
FUNNY WOMAN

Extrait de SERIES MANIA; Nous sommes en 1964, on demande aux femmes d’être aguicheuses, fabuleuses et fertiles, personne ne leur demande d’être amusantes. Mais Barbara Parker est différente. Cette comédie dramatique suit Barbara, une jeune femme qui travaille dans une fabrique de sucres d’orge à Blackpool et qui décide de partir pour Londres sans plan précis mais avec un rêve. Elle décide de se réinventer et de s’imposer dans le monde des sitcoms, alors dominé par les hommes. Mais la route qui mène à la gloire est semée d’embûches et elle connaîtra bien des revers avant d’atteindre son but.
Une adaptation du roman de Nick Hornby Funny Girl, interprétée par une Gemma Arterton réjouissante dans la peau d’une Miss de province qui déménage à Londres dans les années 60, où elle va se battre pour devenir actrice et, emportée par l’élan féministe de l’époque, révolutionner la sitcom anglaise.. OCS/ CRÉATION MORWENNA BANKS/SCÉNARIO MORWENNA BANKS/RÉALISATION OLIVER PARKER
AVEC GEMMA ATERTON, TOM BATEMAN, ARSHER ALI, RUPERT EVERETT, DAVID THRELFALL, MATTHEW BEARD, LEO BILL, ALEXA DAVIES, CLARE-HOPE ASHITEY, ALISTAIR PETRIE, MORWENNA BANKS
Evidemment, Télérama, ma revue préférée mais qui n’en loupe pas une dans la caricature journalistique titre : “Funny Woman”, saison 2, continue d’éclairer la marche vers l’égalité des femmes britanniques. De retour pour une nouvelle saison réduite à quatre épisodes, qui lui donne un délicieux air de week-end à Londres, Funny Woman poursuit dans la veine du premier opus. Décors, costumes et surtout BO, elle offre un concentré du Swinging London sixties tel qu’on le fantasme aujourd’hui. Mais, toujours fidèle à l’esprit de Nick Hornby, la scénariste Morwenna Banks ne se contente pas de surfer sur la nostalgie. Tout au contraire, elle radiographie la société de l’époque en orchestrant un combat entre la pudibonderie et la libération des mœurs. Ce faisant, elle continue d’éclairer la longue marche vers l’émancipation des Britanniques. Un voyage dans le temps d’actualité alors que la remise en cause des droits des femmes n’est, pour certains, plus un tabou. Incarnée avec esprit par Gemma Arterton, comédienne très engagée dans le combat pour l’égalité, Sophie Straw mène la lutte !
Donc Deux saisons très agréables à suivre sauf quand on nous gâche le plaisir par des observations de collégiens, en quête de wokisme.
CNRONIQUE ARCTIQUE

Fraiche (c’est le cas de le dire), rafraichissante, et pas gnangna, comme on pourrait le croire dans les premières images.
ENCORE TELERAMA, par Marianne Lévy (encore elle, assez bonne) (QUE VOULEZ-VOUS CE SONT LES MEILLEURS ceux de Télérama, woke exit))
Voir sur Netflix
Au nord du Canada, il y a l’Arctique. Et encore plus au nord, la petite communauté de Ice Cove, Nunavut. C’est là que vit Siaja (lumineuse Anna Lambe), jeune mère au foyer. Enfin, vivre est un grand mot puisque son quotidien est calé sur l’agenda de son mari, un mascu toxique à l’ego gonflé à l’hélium. Dans son sillage, elle étouffe. Et finit par le lui avouer au beau milieu d’une partie de chasse au phoque… Évidemment, il ne le prend pas très bien. Une surréaction de trop pour Siaja qui, sa fille de 7 ans à la main, emménage chez Neevee, sa mère… La filiation compliquée ? Rien de nouveau sous le soleil sériel. Sur le papier (glacé), cette Chronique arctique ressemble à une énième déclinaison du genre comédie gentillette menée par une mère courage.
Bonne surprise, Stacey Aglok MacDonald et Alethea Arnaquq-Baril, ses créatrices, prennent le chemin opposé avec un culot rafraîchissant. Des femmes inuites, elles font leur sujet en connaissance de cause. Avec un burlesque assumé, elles dénoncent les restes du patriarcat qui, dans le Grand Nord comme ailleurs, continuent d’empêcher les femmes. Mais elles pointent aussi les autres entraves que les Inuites doivent surmonter. « Tu te conduis comme une fille blanche qui aurait des options », lance Neevee à Siaja. Car mère célibataire, ce n’est pas non plus simple tous les jours. Elle en sait quelque chose, elle, la grand-mère rebelle, qui veille à ce que sa petite-fille sache faire un doigt d’honneur correctement. Irrévérencieuse, la série se révèle aussi touchante grâce à d’excellentes actrices, dont Maika Harper et Mary Lynn Rajskub (24 heures chrono). Toutes déploient une énergie qui évoque Gilmore Girls. Comme quoi, au sud comme au nord, il ne faut pas se fier à la face visible de l’iceberg !
Classement
Quelles sont les meilleures séries Netflix ?
LA RIVIÈRE DES DISPARUES (long bright river)

Mickey, policière, patrouille dans un quartier de Philadelphie touché par la crise des opioïdes quand une série de meurtres éclate.
Cette série qui flirte avec une autre, mythique (rire) est d’une rare intelligence.
C’est à Philadelphie,ville délabrée, là ou règne la drogue que se démène la policière remplie d’humanité, jouée par Amanda Seyfried, assez exceptionnelle.
Tiré d’un roman que “ESPACE cultural” à Tarbes commente ainsi :
“Le coup de cœur de Espace Cultural Tarbes. Un texte puissant qui floute les lignes connues du polar pour aller vers quelque chose de plus intimiste et psychologique. Porté par une superbe héroïne, l’ensemble s’inscrit dans des problématiques sociétales, telles que la dépendance ou la pauvreté rampante dans une Philadelphie peu reluisante.
Tout est impeccable dans cette série, le jeu, la mise en scène, la retrouvaille de l’humanité, le cadrage, la couleur. L’intelligence se terre désormais chez les réalisateurs, plus qu’avant.
YELLOWSTONE AND THE OTHERS (1883, 1923)

ECLAIREUR FNAC : Si 1883 montrait les sacrifices nécessaires pour poser la première pierre d’un empire, Yellowstone explore la solitude de ceux qui doivent en assurer la pérennité. Là où James Dutton luttait contre la nature et les obstacles physiques, John Dutton combat la paperasse, les arrangements politiques et les trahisons.
1923 est entre les deux, évidemment. Des séries qui vous empêchent de sortir, ce qui n’est pas un mal lorsque le ciel est gris. Mais même un ciel bleu vous cloue sur le fauteuil. Si la meilleure est bien sûr Yellowstone, d’une violence inouïe, les deux autres ne déméritent pas. L’Ouest américain dans sa fabrication.
3 longues séries
YELLOWSTONE : Dans le Montana, la famille Dutton possède le plus grand ranch des États-Unis près du parc national de Yellowstone. Menée par le patriarche John, un homme aux méthodes souvent expéditives, la famille se bat contre des politiciens et des promoteurs immobiliers, pour que l’on n’empiète pas sur ses terres, notamment pour une réserve indienne. Kevin Kostner exceptionnel mais surtout Kelly Reilly, fabuleuse, fabuleuse.

1883 est une mini-série dramatique américaine en dix épisodes d’environ 45 minutes créée par Taylor Sheridan et diffusée entre le 19 décembre 2021 et le 27 février 2022 sur la chaîne Paramount Network.
La série met notamment en vedette Tim McGraw, Faith Hill, Sam Elliott et Isabel May. Elle est une préquelle de la série Yellowstone de Sheridan et détaille l’origine des Dutton devenus propriétaires du terrain qui allait devenir le « Yellowstone Ranch »
La famille Dutton entreprend un voyage vers l’Ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. Ils fuient la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans cette terre promise que représente l’Oregon.
Elle est suivie de la série suite 1923.
1923. En 1923 dans le Montana, une autre génération de la famille Dutton — menée par le patriarche Jacob et son épouse Cara — vit une époque de difficultés en tous genres, avec notamment la sécheresse, les pandémies, la Prohibition et surtout la Grande Dépression.
On n’ajoute rien. C’est de la grande série.

MEURTRES À ÂRE

6 février 2025 (France)Diffuseur : Netflix Genres : Drame, Policier Pays d’origine : Suède
Hanna Ahlander, policière, a été suspendue de son poste à Stockholm et plaquée par son conjoint et part alors s’installer dans la maison de vacances de sa sœur à Åre. Lorsqu’une jeune femme disparaît dans la nuit glaciale de Sainte-Lucie, Hanna ne peut s’empêcher de commencer à enquêter sur l’affaire. Avec une situation familiale difficile et un commissariat en sous-effectif, l’officier de police local Daniel Lindskog doit accepter à contrecœur l’aide d’Hanna. Mais la grande question est de savoir s’ils peuvent se faire confiance l’un à l’autre.
TELERAMA, par Cécile Marchand Ménard, le 7/2/2025 :
Enquêtrice au sein de l’unité violences familiales de la police de Stockholm, « larguée depuis peu et sans appart », Hanna Ahlander aurait vraiment besoin de repos. Sa hiérarchie et sa famille sont d’ailleurs unanimes : quelques jours au vert à Åre, dans l’ouest du pays, lui feraient le plus grand bien.
D’aucuns auraient profité de cette villégiature imposée pour enchaîner les sessions de ski de fond, les chocolats chauds sous un plaid et les siestes au coin de la cheminée. Mais chassez le naturel… Hanna préfère à ce programme douillet une battue organisée afin de retrouver la jeune Amanda. La nuit dernière, l’adolescente devait rentrer à vélo d’une fête organisée chez sa meilleure amie, mais elle demeure introuvable.
Décor hivernal propice au mystère
Depuis 2010, les affaires criminelles imaginées par l’autrice suédoise Viveca Sten s’invitent sur petit écran avec Meurtres à Sandhamn, polar bien troussé mais relativement conventionnel, adapté par Sara Heldt et disponible sur Arte.tv. Les auteurs de Meurtres à Åre s’emparent ici de deux nouvelles intrigues concoctées par l’autrice et les situent, non pas dans une station balnéaire ensoleillée, mais dans une petite communauté suédoise où la neige recouvre le toit des maisons, les routes, mais aussi les secrets. Un décor hivernal propice au mystère, théâtre d’enquêtes à tiroirs convaincantes. Avec fluidité et efficacité, les investigations policières (teintées d’un vague propos social) se mêlent au portrait de Hanna, enquêtrice au passé trouble. Secrétaire ingénue dans Love & Anarchy (également sur Netflix), Carla Sehn campe avec justesse cette policière rigoureuse et entêtée, voire obsessionnelle. Les épisodes les plus réussis sont d’ailleurs ceux qui s’attachent à décrire cette héroïne, ses aspérités et ses zones d’ombre.
Série policière réalisée par Alain Darborg, créée par Karin Gidfors et Jimmy Lindgren (Suède, 5 × 40 mn, 2025).
TRUE DETECTIVE, FARGO : NOUVEAUX OPUS


Ceux qui, un peu comme moi, accordent aux séries bien faites le même satisfecit qu’aux bons films n’ont pu rater les deux mythiques en titre. True détective créée et écrite par Nic Pizzolatto et réalisée par Cary Fukunaga, en 2014, a bouleversé le monde ds séries par son type de réalisation, sa photo, le ton de ses personnages;Elle est devenue anthologie et doré encore plus le blason du producteur HBO.
Ceux qui considèrent les frères Cohen comme d’immenses réalisateurs, qui avec Trantino ont donné un coup de pied rageur dans le cinéma installé connaissent leur film Fargo qui est, par la suite devenu une série magique, dans le ton du film.
Les deux séries s’étaient arrêtés à la saison 3 pour TD et à la saison 4 pour Fargo. On a attendu l’opus 4 et 5; Curieusement, ils viennent, épisode par épisode ce mois de Janvier 2024.
La saison 4 de True détective est enlevée par Jodie Foster, encore une fois géniale, en tous cas dans le premier épisode (on revient aux séries avec épisodes chaque semaine au compte-goute comme avant, ce qui n’est pas mieux. Il faut le dire : les hommes dans cette série sont expulsés : toutes sont des femmes , les réalisatrices, les actrices. Ce qui n’a, évidemment aucune importance mais qui fait la joie des féministes chic. Malheureusement, pour les radins, qui préfèrent payer 30 € un mauvais steak frites, il faut aller payer sur Prime Video et prendre l’option “Pass Warner” à 9 € mois, mais c’est sans engagement, on peut donc résilier après avoir vu les 6 épisodes de cette saison.
Quant à la saison 5 de Fargo, 2 épisodes depuis Jeudi 19 janvier sur Canal; On les a vu. Excellents.
On colle Les 2 critiques :
FARGO
Cette cinquième saison inspirée du film culte des frères Coen est une franche réussite, aux accents féministes et à l’humour noir décapant.
Par Pierre Langlais Télérama
Publié le 18 janvier 2024 à 18h00
Dorothy Lyon, emportée dans une foule hostile, tase par erreur un policier. À peine rentrée de garde à vue, cette femme au foyer du fin fond du Minnesota est kidnappée – non sans difficultés – par deux truands. Pourtant, cette brindille, mère aimante et épouse dévouée, n’a rien d’un gangster…
Comment expliquer cette attaque ? Pourquoi est-elle si nerveuse ? Est-ce lié à sa belle-mère, richissime industrielle aux pratiques douteuses ? Indira Olmstead, une jeune flic locale en mal de reconnaissance, mène l’enquête. Roy Tillman (Jon Hamm), shérif droitier et brutal, s’en mêle aussi.
La série “Fargo” en intégralité sur MyCanal : la recette givrée d’une adaptation réussie
Comme à chaque nouvelle saison, Fargo, anthologie adaptée du film culte des frères Coen (1996), reprend tout de zéro. Ce nouveau récit revient aux fondamentaux : une poignée de personnages naïfs ou vicieux – et souvent les deux à la fois – mettent le doigt dans un engrenage meurtrier glacé et glaçant. Ce cinquième opus, bourré d’humour noir et de scènes d’action explosives, prend peu à peu des accents féministes. Sous la neige du Minnesota et du Dakota du Nord se cache une Amérique réactionnaire, capitaliste et machiste, contre laquelle toutes les forces féminines, bienveillantes ou non, pourraient bien finir par s’unir.
SYNOPSIS; En 2019, Dorothy Lyon, une femme au foyer qui mène une vie tranquille dans le Midwest, est confrontée à une série d’événements inattendus. Alors qu’elle vivait jusque-là un quotidien des plus banals, les forces de l’ordre s’intéressent à elle. Tout ce grabuge n’est pas du goût de sa belle-mère, la fortunée Lorraine, qui se demande ce que lui cache sa belle-fille. Celle-ci se retrouve malgré elle replongée dans un passé qu’elle pensait à jamais derrière elle. La série renoue avec l’atmosphère caractéristique qui a fait son succès dans une cinquième saison portée par les interprétations très justes de Juno Temple et John Hamm.
TRUE DETECTIVE
EXTRAIT ECRAN LARGE. La série True Detective est de retour. Dix ans après la saison 1 avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, devenue instantanément culte, la création de Nic Pizzolatto a droit à une renaissance, mais presque sans lui. Réalisatrice et (co)scénariste des 6 épisodes, Issa López prend le relais pour une saison 4, intitulée Night Country, avec Jodie Foster, Kali Reis, John Hawkes et Finn Bennett. Après l’accueil très tiède réservé aux saisons 2 et 3, ce retour est-il à la hauteur ?
NIGHT DETECTIVE
Tout commence avec une nuit interminable qui tombe sur l’Alaska, des phénomènes inquiétants autour d’une station de recherche, et une chose qui sort des ténèbres pour emporter les scientifiques. Ça ressemble à un bon épisode de X-Files, surtout quand Jodie Foster (qui a prêté sa voix au tatouage tueur de l’épisode Plus jamais, dans la saison 4) débarque pour enquêter sur la disparition de huit hommes, avec comme seul indice une langue coupée. Mais c’est bien True Detective, quasiment revenue d’entre les morts pour une nouvelle vie.
DIX SÉRIES BIEN CACHÉES SUR LES PLATEFORMES
(Par TELERAMA)
Dix séries cultes bien cachées sur les plateformes
Ensevelies sous des centaines de nouveautés, ces œuvres majeures font pourtant la richesse de Netflix, Disney + et consorts. De “NYPD Blues” à “Cheers”, en passant par “X-Files”, “Télérama” vous aide à les retrouver
Par Pierre Langlais, Sébastien Mauge
Publié le 06 août 2023 à 12h3
La sériephilie, ces dernières années, ressemble à un sprint effréné vers les nouveautés. Il faut être à l’heure, au fait des dernières surprises, branché sur un flux de frais déversé non-stop dans nos yeux écarquillés. Pourtant, une des principales raisons de s’abonner aux plateformes, c’est ce qu’on appelle leur « catalogue », censé remplacer au moins en partie les volumineuses intégrales DVD. Au milieu des plaisirs plus ou moins coupables et des authentiques nanars se planquent ainsi une armée de coups de cœur d’hier et d’indispensables classiques. Télérama en a débusqué dix à (re)voir de toute urgence (Urgences, justement, n’en fait malheureusement pas partie : elle est absente des plateformes pour le moment).
“Cheers” (Paramount+)
Un bar, quelques stars en devenir comme Ted Danson et Woody Harrelson, onze saisons : « Cheers », série culte outre-Atlantique, à peine connue chez nous.
C’est une des sitcoms les plus importantes de l’histoire de la télévision américaine… et on ne l’a quasiment jamais vue en France. En onze saisons (de 1982 à 1993), et grâce à un dispositif tout bête – on ne quitte jamais, ou presque, l’intérieur d’un bar de Boston, la série aura offert son lot de tranches de vie drôles et émouvantes, de discussions de comptoir hilarantes et de « cold open » (scènes prégénériques) parmi les meilleurs. On se love dans ce cocon boisé dont on croit sentir les effluves d’alcool, cette capsule intemporelle où chacun peut se confier, refaire le monde, être qui il veut, le temps d’un verre. – S.M.
“Frasier” (Paramount+)
« Frasier », un spin-off de « Cheers », avec Kesley Grammer et David Hyde Pierce en psys si snobs mais si drôles.
Spin-off de Cheers, Frasier reprit le flambeau de 1993 à 2004 (une nouvelle saison est bientôt prévue). Frasier Crane est un ancien pilier du bar de Boston, psychiatre qui part vivre à Seattle après son divorce. Il y anime une émission de radio dans laquelle il donne des conseils aux auditeurs, alors que lui-même a bien du mal à régler ses problèmes. Cet élitiste bougon s’entend très mal avec son père et enchaîne les déceptions amoureuses. Grâce à son humour varié, qui mêle comique de situation et punchlines imparables, et une tendresse cachée sous des dialogues mitraillettes ciselés, le quotidien de Frasier devient rapidement le nôtre. – S.M.
“Friday Night Lights” (OCS et MyCanal)
« Friday Night Lights », le Texas comme vous ne l’avez jamais vu. NBC Universal Television/Imagine Television/Film 44
Le plus récent de ces classiques (2006-2011) est aussi le plus sous-estimé de notre côté de l’Atlantique. Le quotidien d’un bled du Texas passionné par l’équipe de football américain de son lycée semble, il est vrai, un sujet très, très, très américain. Mais FNL est bien plus que ça, une chronique bouleversante et inspirante, une série ado à part et un regard original sur une Amérique très pieuse qu’on serait tenté de caricaturer. Ajoutez à cela une mise en scène hypersensible, une sublime BO post-rock et un casting à tomber, et c’est le touchdown assuré. – P.L.
“NYPD Blue” (Disney+)
Dennis Franz, inoubliable dans le rôle de Andy Sipowicz (à gauche), dans « NYPD Blue ». ABC
Certaines séries ont changé la donne bien avant le dernier âge d’or des séries américaines, celui des Soprano et The Wire. À la suite de Hill Street Blues, NYPD Blue a fait entrer le polar télé américain dans la modernité. Enquêtes imparfaites, crimes complexes, réalisation nerveuse… la série de Steven Bochco marque surtout un tournant grâce à son personnage principal, Andy Sipowicz (Dennis Franz), un flic violent, raciste, chauve et bedonnant, à contre-pied total des héros du genre, sans peurs, sans reproches et sans un cheveu de travers. – P.L.
À lire aussi :
“NYPD Blue” en intégrale sur Disney+ : cinq raisons de voir ou revoir ce classique de la série policière
“Scrubs” (Disney+)
Zach Braff dans « Scrubs ». Buena Vista Television
On se souvient surtout de cette comédie médicale du début des années 2000 comme d’un plaisir coloré, fun, un peu barré. À raison. Mais Scrubs est aussi et surtout une œuvre annonciatrice d’une révolution du genre, qui s’est depuis débarrassée de ses codes pour devenir ce qu’on appelle un peu vite la « dramédie ». Elle est absurde, parodique et méta, mais laisse aussi beaucoup plus de place que les sitcoms traditionnelles à l’évolution des personnages et à leurs émotions. Une recette que Bill Lawrence, son créateur, a renouvelé avec la très tendre Ted Lasso. – P.L.
“Seinfeld” (Netflix)
La joyeuse méchanceté de « Seinfeld », avec Michael Richards, Jerry Seinfeld et Jason Alexander. NBC/Castle Rock Entertainment
S’il ne devait rester qu’une sitcom, ce serait sans doute celle-ci. Ce « show sur rien » est l’œuvre de Larry David et du comédien de stand-up Jerry Seinfeld, qui joue son propre rôle. Seinfeld est un grand enfant incapable de nouer des relations stables, tout comme son meilleur ami pleutre et colérique, son ex envahissante et son voisin complètement cinglé. Ce quatuor magique affronte avec une joyeuse méchanceté un quotidien qu’ils abhorrent, créant des situations impossibles dont ils ressortent souvent perdants. Un régal absolu. – S.M.
À lire aussi :
“23 Hours to Kill” sur Netflix : Jerry fait du pur “Seinfeld”
“Spin City” (Paramount+)
« Spin City », ou les dessous cocasses de la politique américaine, avec Michael J. Fox (tout à droite). Dreamworks SKG/Ubu Productions
Cette série de bureau met en scène le chef de cabinet de la mairie de New York, obligé de gérer un maire hors-sol et une équipe pas loin d’être incompétente. Moins corrosive mais plus attachante que sa descendante, Veep, Spin City raille avec brio les élites administratives et les petites mesquineries inhérentes à tout open space. Si elle est portée par le formidable abattage de Michael J. Fox (qui quittera le show après quatre saisons en raison de la maladie de Parkinson), la série possède aussi une belle brochette de seconds rôles, dont l’irrésistible Barry Bostwick (The Rocky Horror Picture Show) en maire gaffeur irrécupérable. – S.M.
“Star Trek” (Netflix et Paramount+)
« Star Trek », monument de la SF, avec Leonard Nimoy et William Shatner. Paramount TV
Diffusée entre 1966 et 1969, The Original Series, le premier des Star Trek, a pris un coup de vieux avec ses effets spéciaux, ses décors en carton-pâte et ses costumes-pyjamas… Mais il faut prendre un peu de recul, car ce monument de la science-fiction a inventé des technologies aujourd’hui bien réelles, mis en scène le premier baiser interracial de l’histoire du petit écran et livré un joli plaidoyer pour l’entente entre les peuples et la sauvegarde des milieux naturels. Plus de cinquante ans après, la franchise continue de traverser l’espace, « frontière de l’infini »… – P.L.
“The Shield” (MyCanal via 6Play)
« The Shield », avec Michael Chiklis. 20th Century Fox TV
Le polar le plus nerveux de l’Histoire est un shoot d’adrénaline non-stop. Filmé caméra à l’épaule par des cadreurs tombés dans la caféine quand ils étaient petits, ce coup de tête sériel enchaîne les enquêtes explosives tout en creusant méticuleusement la tombe de ses héros ripoux. Mais The Shield n’est pas une bagarre permanente, c’est un drame psychologique à la tension insoutenable, qui pose une question qui ne cesse (à raison) de déranger : faut-il des flics sales pour empêcher les trafics et la violence urbaine de s’étendre ? – P.L.
“X-Files” (Disney+)
David Duchovny et Gillian Anderson, inoubliable duo de « X-FIles ».
Œuvre culte pour toute une génération, la série que les Français ont d’abord appelée Aux frontières du réel est un monument, grâce auquel de nombreux téléspectateurs ont pris goût au genre sériel. Beaucoup de souvenirs se bousculent : le générique sifflé, l’affiche « I Want to Believe », la parfaite alchimie platonique entre Mulder et Scully, l’impressionnant bestiaire, les complots gouvernementaux, sans oublier les petits hommes verts… ou plutôt gris. Bien sûr, les dernières saisons ressemblaient à un chemin de croix. Mais le début de ce fantastique voyage demeurera à jamais en bonne place au panthéon de la sériephilie. – S.M.
LESSONS OF CHEMISTERY :
Du féminisme comme on l’aime, sublime Brie Larson, mise en scène juste, photographie exacte : belle série

Adaptée du best-seller de Bonnie Garmus, Lessons in Chemistry nous conte la vie d’Elizabeth Zott (Brie Larson), une brillante scientifique éprouvée par l’environnement masculin, dans les années 1950. Elle passera derrière les fourneaux, avec un panache extraordinaire.
Interprétée par a magnifique Brie Larson (Captain Marvel), cette chimiste qui peine à se faire une place comme chercheuse à l’université et parvient donc “à donner une dimension politique à une émission culinaire”.
Comment une brillante scientifique comme Elizabeth Zott a-t-elle atterri à la télévision pour faire des bons petits plats ?
LOVE AND DEATH
une anatomie d’un meurtre bien ficelée.

Décembre 2023.
Amérique profonde et épouse modèle, paroissienne assidue, qui veut avoir une aventure avec le mari de sa meilleure amie. Elle y arrive et passe des moments délicieux dans des motels glauques (love)
Et un drame, un meurtre de cette meilleure amie trompé à coups détache. (death). Et un procès que la culpabilité alors que l’on d-sait qui l’a tuée.
EXTRAIT DE TELERAMA : Un fait divers de 1980 : Candy finira par tuer Betty à coups de hache. Cette histoire, décryptée dans plusieurs livres et documentaires, a déjà été romancée dans une série diffusée l’an passé, Candy, avec Jessica Biel dans le rôle-titre. Chapeautée par le stakhanoviste David E. Kelley (Ally McBeal, Big Little Lies), Love & Death applique à la lettre les codes du true crime. Son suspense est prétexte au portrait d’une communauté aussi pieuse qu’hypocrite, d’où se détache une poignée de personnages tourmentés, incarnés par des acteurs irréprochables. Ce thriller intimiste ne renouvelle pas assez un genre à la mode, qui déjà s’essouffle. Mais le public français, qui ignore la conclusion des événements, trouvera suffisamment de raisons de s’y attarder jusqu’au terme de ses sept épisodes. Bernard Langlais
Excellente série, excellente, belle Elisabeth Olsen. MB
THE GOLDEN HOUR

Cette série “cartonne”, parait-il sur Neffix. N° 1. Voir la critique de GQ, ci-dessous. Mais vraiment, rien de sensationnel. Toujours pareil, des armes )à feu, un passé, du terrorisme, de la violence déjà vue, du faux sentimentalisme. Bref tout ce qui fait courir le banal. Regardez si vous voulez. C’est peut-être moi qui suis de mauvaise humeur.
The Golden Hour, la nouvelle série Netflix à regarder
The Golden Hour est signée Simon de Waal, peut-être un inconnu pour vous mais pourtant grand spécialiste des séries et fictions aux Pays-Bas, notamment salué pour la série Sleeperssortie en 2022. Dans The Golden Hour, le créateur propose aux spectateurs de suivre pas à pas le policier Mardik Sardagh dans sa quête anti-terroriste. Le titre de la série fait référence à la première heure cruciale qui suit un incident. En l’occurence, il s’agit d’un attentat terroriste : deux hommes roulent avec un camion dans la grande allée du Marché Est d’Amsterdam renversant tout sur leur passage. Une fois descendue de leur véhicule, ils tirent sur les passants. Très vite, la police locale et le Raid sont dépassés par les événements et Mardik Sardagh décide de se lancer seul dans la traque aux terroristes. Et ce pour une très bonne raison : il est sûr de connaître l’homme à la base de cette attaque. Sauf qu’il y a, bien entendu, un “mais” à sa quête : Mardik est lui-même surveillé de près par la sécurité nationale qui croit voir en lui un… terroriste, en raison d’un passé assez trouble et d’un récent voyage en Afghanistan, pays où il a grandi jusqu’à l’âge de 7 ans.
Il est inutile de vous en dire plus ici. Nous vous conseillons simplement de vous poser dans votre canapé et de regarder les six épisodes d’environ 50 minutes chacun qui composent cette série. Avec un détail important à prendre en compte : ne regardez pas la fin des épisodes 1 à 5 car ils dévoilent des images importantes de l’épisode qui suit. Dès que vous voyez les premières écritures du générique, passez donc directement à la suite.
ESTERNO NOTTE :
L’ENLEVEMENT D’ALDO MORO PAR LES BRIGAGES ROUGES ITALIENNES

Le 16 mars 1978, Aldo Moro, le président de la Démocratie chrétienne, est enlevé par les Brigades rouges. En état de choc, le gouvernement italien se retrouve face à un dilemme : faut-il accepter la négociation avec le groupe terroriste, quitte à mettre en péril la démocratie, ou ne rien céder et prendre le risque de l’exécution de l’un des siens ?
Extrait France Culture :
Un objet culturel passé au crible d’une critique libre et assumée. Aujourd’hui, Esterno notte, la première série de Marco Bellocchio, Ce sont six épisodes d’une heure chacun environ, signés par le grand réalisateur italien Marco Bellocchio, à qui on doit par exemple Le Traître, ce vaste film de procès sur la mafia. Six épisodes qui retracent, dans un dispositif singulier, les quelques jours qui ont précédé et suivi l’enlèvement en mars 1978 du Président de la Démocratie Chrétienne Aldo Moro par les Brigades Rouges, alors qu’en Italie la tension politique est forte, et qu’on discute au sein du parti historiquement majoritaire, de l’opportunité d’une alliance stratégique avec le Parti communiste. Jalon majeur de l’histoire contemporaine italienne, l’enlèvement et l’assassinat de Moro obsèdent semble-t-il Bellocchio, qui en a déjà fait un film il y a vingt ans intitulé Buongiorno, notte. Le voilà donc repris par cette matière, qui fouille et refouille le trauma national.
SAMBRE

Serial violeur. Sambre adapte le récit de la journaliste Alice Géraud, coautrice avec le scénariste Marc Herpoux de son enquête sur Dino Scala, dit « le violeur de la Sambre », qui agressa près de quatre-vingts femmes dans le nord de la France entre 1988 et son arrestation, en 2018. Mise en scène Jean-Xavier de Lestrade. Grâce à la rigueur, Série française. On a préféré “La nuit du 12”, mais la série est acceptable. Il est dommage que comme dans beaucoup de séries françaises, ça cause beaucoup, ça sonne mal, dialogues plus écrits aidé par l’I.A que réels et que ça joue mal. Pas toujours mais souvent. Mais on conseille. Les purs lecteurs de Télérama ont adoré.
UN MEURTRE AU BOUT DU MONDE :
les réalisateurs de The OA, série mythique, récidivent. Captivant.

EXTRAIT TELERAMA
Un meurtre au bout du monde”, sur Disney+ : une minisérie policière fascinante teintée d’éco-anxiété
L’un des neuf convives d’un milliardaire est tué dans sa demeure islandaise. Les créateurs de “The OA” signent un minisérie ample et poétique, qui entremêle enquête policière, délires de l’IA et chaos du climat.
Deux temporalités s’entremêlent au cœur de la nouvelle série de Brit Marling et Zal Batmanglij, le duo créatif de The OA. Dans un avenir proche à l’horizon lugubre, un clone d’Elon Musk invite neuf gloires des arts, des sciences et de l’humanitaire à le rejoindre au fin fond de l’Islande, le temps d’une retraite visant à mettre en commun leur génie dans l’espoir de sauver le monde.
Parmi eux, Darby, une vingtenaire qui vient de publier le récit de ses exploits de détective amatrice, pourfendeuse de féminicides. La lecture de son livre offre en parallèle un flash-back vers un passé pas si lointain, où cette fille de médecin légiste traquait un tueur en série avec son amoureux d’alors, Bill. Dans le luxueux resort high-tech où la jeune femme est accueillie, la mort suspecte d’un premier convive (qui ne sera pas la dernière) va remobiliser ses talents d’enquêtrice tout en ravivant la blessure de cet amour perdu.
Un groupe prisonnier de la base secrète d’un savant fou, la pureté d’un « boy meets girl », la terreur mêlée de fascination face à la puissance de la technologie… Un meurtre au bout du monde (dont le titre original, A Murder at the End of the World, évoque à la fois les antipodes et la catastrophe écologique) rebat les motifs de The OA, sous une forme compacte, plus grand public. Sans doute l’annulation, à la fin de la saison 2, de leur première série, devenue culte mais restée confidentielle en raison même de sa grande singularité, a-t-elle dicté le choix prudent du format minisérie et du genre murder mystery, qui rendent cette nouvelle proposition moins radicale, et donc plus accessible.
Un imaginaire très ouvert
On peut s’amuser à relever toutes les autres œuvres que celle-ci nous évoque plus ou moins fortuitement, du Silence des agneaux à Glass Onion,de Shining à Devs et même Nine Perfect Strangers. Pourtant les codes et références placés là, comme autant de prises pour le spectateur sujet au vertige, n’empêchent pas de reconnaître la patte unique de Brit et Zal.
Comme dans The OA, mais aussi The East, le film qu’ils ont réalisé ensemble, les compagnons d’écriture se saisissent de leur anxiété face au monde avec une énergie poétique. Des étendues glacées où délire un mégalo des algorithmes (campé avec une bouffonnerie un peu trop caricaturale par Clive Owen) à la poussière chaude de l’Ouest américain où sévit un tueur de femmes, capitalisme et patriarcat sont dans le viseur. Pourtant aucun reste de didactisme ne survit à l’imaginaire grand ouvert des deux scénaristes, qui laisse leurs visions offertes à l’interprétation et les questions sans réponse univoque. Comment protéger nos enfants ? Faut-il se déconnecter ? L’IA est-elle un danger ou une solution ? Si la série s’empare de ces sujets brûlants avec acuité, c’est sans se départir d’une grâce rêveuse, reliant chaque idée à sa pelote d’émotions versatiles, qui l’empêche de se figer dans le marbre.
Cette fluidité circule aussi entre Bill et Darby, bouleversant binôme égalitaire et post-genre, où chacun porte sa part mouvante de masculin et de féminin. Emma Corrin, sosie génération Z de Jodie Foster, et l’acteur de Sans filtreHarris Dickinson (qui prouve que, oui, la coupe mulet, ça peut être sexy) offrent une parfaite enveloppe charnelle à la contemporanéité de ces deux justiciers magnifiques. Si la série place ses espoirs dans les femmes et la jeunesse, notamment à travers la relation d’une ancienne hackeuse jouée par Brit Marling et de son petit garçon, elle réinvente aussi le couple romantique pour en faire un autre antidote aux conspirations mortifères. Quitte à faire mentir sa propre BO, où Annie Lennox susurre No More I Love You’s…
THE BEAR
Une merveille, cette série, une merveille

Carmen « Carmy » Berzatto, un ancien chef de restaurant gastronomique hérite après la mort de son frère de sa sandwicherie. Il va tenter d’en faire un point incontournable de la ville de Chicago grâce à son équipe pleine de bonne volonté… mais quelques embûches vont tenter de lui semer le chemin.
UNE SERIE QUI MERITE DE LONGS PASSAGES A LIRE CI-DESSOUS.
EXTRAIT TELERAMA, SAISON 1 (2022)
On croyait avoir soupé des fictions culinaires, déclinées à toutes les sauces depuis le carton de Top Chef et autres téléréalités. Diffusée cet été outre-Atlantique, The Bear, plongée étouffante, passionnante et attachante dans les coulisses d’une sandwicherie de Chicago, réveille nos papilles critiques. Mise en ligne sur Disney + le 5 octobre, cette comédie dramatique s’ouvre sur le retour au bercail de Carmen « Carmy » Berzatto (Jeremy Allen White), surnommé « The Bear », qui a quitté son poste dans un restaurant étoilé pour prendre les commandes du deli familial, après le suicide de son grand frère. Il va tenter, avec l’aide d’une nouvelle employée inexpérimentée mais ambitieuse (Ayo Edebiri), de rembourser les dettes et de redorer le blason de l’établissement.
The Bear n’est, a priori, pas une série novatrice. C’est une histoire classique de lendemain de catastrophe et de reconstruction, un récit au bord du gouffre où les tensions existentielles jettent de l’huile sur le feu d’une situation matérielle désespérante. Le cauchemar en cuisine est bien réel devant les fourneaux du Original Beef of Chicagoland, dont on ne quitte quasiment jamais les cuisines : problèmes sanitaires, coupures de courant, impacts de balles dans la vitrine… Filmée caméra à l’épaule et au ras des casseroles, ce tourbillon dramatique quasi sans temps morts (bombardement de répliques cinglantes, de cris, de rires, de larmes…), fait penser au cinéma en apnée des frères Safdie (Good Times, Uncut Gems). Les sandwichs et plats concoctés par Carmy font saliver, mais le chaos qui règne autour de lui assèche la gorge…
L’authenticité de The Bear, supervisée par le chef canadien Matty Matheson – qui, ironiquement, incarne l’homme à tout faire du restaurant –, n’éclipse pas le véritable enjeu humain de la série. Ses personnages principaux sont des passionnés, des bourreaux de travail à vif, pour qui la bonne cuisson d’une viande est d’autant plus une question de vie ou de mort qu’elle cache une situation tragique.
Le réalisateur Christopher Storer (Ramy), dont c’est le premier scénario, semble avoir laissé ses acteurs improviser tant leurs interactions sont brutes, tendues, crispantes et drôles. Le succès de cette série coup de poêle repose donc aussi sur une troupe de comédiens méconnus, à l’exception d’Ebon Moss-Bachrach (Girls), parfait en gestionnaire intenable, et de Jeremy Allen White (Shameless), impressionnant de fragilité retenue. Huis clos cocotte-minute, The Bear finit par exploser dans un avant-dernier épisode d’une nervosité rarement atteinte sur le petit écran.
EXTRAIT TELERAMA Saison 2
Par Marjolaine Jarry, août 2023 à 06h30
La première saison de The Bear, succès surprise de 2022, nous avait saisis tout crus sur le gril en nous plongeant au cœur de l’enfer frénétique d’une cuisine de restaurant. Cette suite déploie ses ailes, dans le même mouvement que le chef Carmen Berzatto (Jeremy Allen White), déterminé à monter un nouvel établissement, entouré de sa brigade. Une communauté de destins à laquelle la série nous attache, avec une rugosité et une sensibilité bouleversantes, au même titre que certaines grandes références avant elle, de Six Feet Under à Friday Night Lights. La recette, en trois étapes, d’une série qui a le goût des autres.
Faire mijoter la névrose
Quand on rembobine, rien d’étonnant à ce que la toute première scène de The Bear soit un cauchemar. Seul sur un pont, Carmen Berzatto s’approche d’une cage. Il ouvre la porte et délivre un ours qui s’avance, gueule ouverte. Dans la série de Christophe Storer, l’ursidé n’est autre que le surnom de Carmen lui-même, que ses proches appellent « the bear ». C’est aussi l’animal totem de sa famille et le nom du restaurant que voulait ouvrir Michael, son frère décédé, et que le cadet est bien décidé à faire exister. Affronter son héritage, regarder en face les terreurs de l’enfance, soigner ses blessures. Entrée, plat, dessert…https://www.youtube.com/embed/vI7TNW_CLn8
On savait déjà, depuis la première saison, le deuil qui traversait Carmen comme un courant électrique depuis la mort brutale de Michael, la dépression (hyper) active qui était la sienne et ne trouvait sa résolution que dans le coup de feu de son quotidien de chef. Cette saison 2 éclaire brutalement le gouffre sous les pieds du héros, le temps d’un magistral épisode dans la tourmente d’une soirée de Noël, quelques années plus tôt, chez sa mère (Jamie Lee Curtis), explosive et tragique. Une virée cassavetienne au pays des souvenirs encapsulés par le traumatisme, une séquence de train fantôme qui s’arrête sur le regard vide du héros, impuissant devant la folie maternelle, et se referme par un ultime plan sur la pyramide de cannoli, traditionnel dessert sicilien préparé pour l’occasion.Lionel Boyce en pâtissier passionné dans « The Bear » saison 2. Photo Chuck Hodes/Disney+/FX Productions/Super Frog
Loin de toute psychologisation appliquée (la série n’est jamais aussi bavarde que lorsqu’il s’agit de faire l’inventaire du matériel), les forces de l’inconscient se font entendre à l’état brut. Une seule métaphore parcourt The Bear : celle de la nourriture, si prompte à convoquer le kouglof familial et cet arrière-goût qui ne passe pas des enfances amochées. Mais la cuisine se fait aussi lieu de potentielle réinvention. Au sein de la famille que Carmen a recréée autour de lui, Marcus, l’un des membres de sa brigade, décide d’élaborer, pour le menu du restaurant, une version revisitée des cannoli et baptise son plat Michael, du nom du frère disparu.
Oser l’amertume pour réveiller les papilles
Si les ribs caramélisés de The Bear et leur risotto crémeux nous font baver devant l’écran, une autre saveur domine la série : l’amertume. La dépression de Carmen n’est pas une caractérisation du personnage parmi d’autres, elle imprègne son rapport au monde et conditionne le spectateur. On partage son angoisse, à bout de souffle tant l’endeuillé en tablier court toujours plus vite pour doubler l’effroi sur la ligne d’arrivée ; on se cogne fort à son hermétisme — « Je me sens pris au piège parce que je n’arrive pas à décrire ce que je ressens », confirme Carmen. Avec un réalisme exigeant, le créateur Christophe Storer — qui évoque, au détour de de plusieurs interviews, l’atmosphère chaotique de sa propre enfance — ose raconter le mal de vivre comme il est : rarement glamour et laissant peu de place à l’amour…
À lire aussi :
“The Bear”, épisode 7 : un sidérant plan-séquence de vingt minutes dans une cuisine en panique
La réussite inédite de cette chronique heurtée ? Laisser passer la lumière sans escamoter l’âpreté. Avec une audace encore rare, la série saute la case du romantisme pour faire exister d’autres émois moins balisés. Une tendresse sans affèteries, parfois née au cœur du conflit ; une romance platonique et foncièrement émouvante entre Carmen et sa binôme Sydney ; le sentiment d’un bien commun supérieur, partagé par tous ceux qui s’activent pour faire vivre ce bout d’utopie. La famille bricolée (éclopés bienvenus) qu’abrite l’enseigne The Bear nous attache par la façon retorse et obstinée avec laquelle ses membres se témoignent leur amour.
Réunir un casting aux petits oignons

On l’a vu grandir au cœur d’une autre famille dysfonctionnelle, celle de la série Shameless. Avant d’être Carmen, Jeremy Allen White a été, pendant onze ans, l’un des débrouillards rejetons du clan Gallagher, et l’on ne peut s’empêcher de penser qu’il a trimbalé avec lui cette façon d’endosser la détermination plutôt que la séduction. Aux côtés d’Ayo Edebiri, venue du stand-up, qui incarne la sous-cheffe Sydney avec une simplicité aiguisée, ils sont les figures tutélaires d’une équipe dont les membres, incarnés, pour la plupart, par des comédiens peu connus, nous deviennent, au fil du temps, familiers. En contrepoint, l’épisode de Noël est un feu d’artifice (au potentiel explosif) qui nous projette dans une autre dimension, réunissant autour de la table, outre Jamie Lee Curtis, Sarah Paulson, Bob Odenkirk, Will Poulter…
Dans la cuisine de son restaurant, Carmen tient à ce que tout le monde s’appelle « chef », par souci d’horizontalité. Une éthique qui sous-tend jusqu’au casting de la série où chaque individualité est magnifiée, quelle que soit sa notoriété, où de nouveaux visages tiennent les premiers rôles tandis que des stars font des apparitions. Jusqu’à cette séquence inattendue où la patronne d’un restaurant, absorbée, à l’aube, par l’épluchage méticuleux de champignons, s’avère être Olivia Colman. La Queen en cuisine, pour célébrer la grandeur des petits gestes.
Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci.
La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite préalable de Telerama, est strictement interdite.
Pour plus d’informations, consultez nos Conditions Générales d’Utilisation.
Pour toute demande d’autorisation, contactez droitsdauteur@telerama.fr.
Vingt (très) bonnes séries de moins de six heures à engloutir en un week-end
De la magistrale “Adolescence” à l’édifiante “Mr Bates contre le Post Office”, en passant par la puissante “Apples Never Fall”… Notre sélection de miniséries à dévorer en moins de six heures, mise à jour régulièrement.TELERAMA
Par Macha Dussart avec le service série Publié le 28 mars 2025 à 17h5 Mis à jour le 23 avril 2025 à 16h59ris
Vous connaissez ce sentiment ? Une série vous captive totalement, vous dévorez tous les épisodes, et soudain… la frustration, la solitude, le manque. Une attente interminable d’un voire deux ans avant la prochaine saison… Téléramapense à vous et a sélectionné vingt minisérie de moins de six heures. Le temps d’un week-end ou d’une soirée, vous pouvez explorer tout un monde en quelques épisodes. Drame, polar, romcom, gore, comédie noire… il y en a pour tous les goûts, tous les emplois du temps et sur toutes les plateformes, qu’elles soient gratuites ou payantes.
Addictive : “Apples Never Fal
Rien de bien neuf dans cette troisième adaptation en série de l’œuvre de Liane Moriarty, l’autrice de Big Little Lies. Mais tout est réuni pour nous tenir en haleine le temps de sept épisodes.
“Apples Never Fall”, une série simplissime mais addictive, dans laquelle on croque quand même
Chronique sociale : “Nismet”
Nismet, 16 ans, vit avec un beau-père violent et une mère sous emprise. Le cinéaste Philippe Faucon (Fatima) passe à la série télé avec cette chronique d’une éclosion en quatre épisodes dépouillés et irrésistibles.
“Nismet”, le puissant récit d’une émancipation dans une série signée Philippe Faucon
Vertigineuse : “Douglas is cancelled”
Steven Moffat observe un présentateur perdre pied après un tweet l’accusant d’avoir lâché une blague sexiste. Sera-t-il « cancelled » (annulé), comme disent les jeunes ? Réponse en quatre épisodes à théâtralité implacable, vertige en prime.
Histoire vraie : “Mr Bates contre le Post Office”
À cause de mystérieuses irrégularités dans les caisses de leurs bureaux, des receveurs dans l’impossibilité de prouver leur innocence sont poursuivis par le Post Office. Cette série au casting brillant retrace un combat véridique, une lutte à la David contre Goliath.
“Mr Bates contre le Post Office”, sur Arte : l’attachante minisérie sur un scandale qui secoua le Royaume-Uni
Initiatique : “In my skin”
Dans cette série galloise multirécompensée, une lycéenne tente de se préserver des crises de sa mère et de la violence de son père. Un scénario subtil, sublimé par le jeu de Gabrielle Creevy.
r “In My Skin”, sur Arte.tv : portrait sensible et délicat d’une ado anglaise confrontée à l’adversité familiale
Remake féministe : “Présumé innocent”
Le thriller érotisant des années 1980 réalisé par Alan J. Pakula, renaît avec cette série de David E. Kelley, avec Jake Gyllenhaal et Renate Reinsve. Dépourvu du sexisme de l’époque, le récit séduit aujourd’hui par sa fascinante ambiguïté.
r “Présumé innocent” sur Apple TV+, un remake sériel troublement féministe
“Ici la voix…” : “Culte”
Loana dans la piscine, la gueguerre entre M6 et TF1… Loft Story raconté tambour battant. Tout comme l’ascension glorifiée d’Alexia Laroche-Joubert, première a avoir introduit la télé-réalité en France, qui se trouve être aussi… la productrice de la série.
Huis clos : “L’intruse”
Cette série en quatre épisodes s’amuse avec la figure de la nounou maléfique. Frissons de film d’horreur, réflexion sur la maternité et portrait d’une jeune fille avide d’être aimée… Un thriller intelligent et ludique
r “L’Intruse”, sur France 2, une efficace exploration à suspense des tourments domestiques
Galvanisant : “Frotter frotter”
Exploitées et maltraitées, les femmes de chambre d’un hôtel lillois se mettent en grève. Sans rien édulcorer de l’âpreté du réel, cette minisérie donne à voir comment la force du collectif transcende les luttes.
“Frotter frotter” sur France 2 : la révolte des femmes de chambre, une minisérie galvanisante
Prenante : “L’Affaire Kim Wall”
Le 10 août 2017, la journaliste suédoise Kim Wall embarque à bord du sous-marin expérimental de Peter Madsen. Le lendemain, plus aucune trace de la jeune femme… Cérébrale et d’excellente facture, cette minisérie policière retrace l’enquête avec sobriété.
r “L’Affaire Kim Wall” : une minisérie palpitante sur un scandale nordique vertigineux
Virtuose : “Adolescence”
Tournée en quatre plans-séquences, cette minisérie britannique diffusée sur Netflix nous immerge dans une enquête criminelle visant un garçon de 13 ans. Une œuvre cathartique, irriguée de questions contemporaines.
“Adolescence”, sur Netflix : une série magistrale qui sonde en temps réel les racines du mal
Robert De Niro : “Zero Day”
À la suite d’une cyberattaque, les États-Unis sont plongés dans le chaos. Un ancien président est appelé à la rescousse. Un thriller qui brille par son casting, mais manque de finesse.
“Zero Day”, sur Netflix : Robert De Niro, héros tourmenté au chevet de la démocratie américaine
Histoire vraie (bis) : “Toxic Town”
Alertées par les malformations de leurs bébés contaminés par des déchets toxiques, des mères vont mener l’enquête et le combat pour que justice soit faite. Une série sans grand suspense mais captivante.
“Toxic Town”, sur Netflix : des mères face à un scandale sanitaire en Angleterre
Tendue : “À l’aube de l’Amérique”
Au milieu du XIXᵉ, une mère et son fils sont emportés dans la violence du Far West. Cette minisérie, écrite par le scénariste de The Revenant, glace le sang autant qu’elle émeut, malgré une réalisation grossière.
“À l’aube de l’Amérique”, sur Netflix : il était une fois un western à feu et à sang
Caustique : “Apple Cider Vinegar”
L’histoire vraie d’une influenceuse qui prétendait soigner ses cancers au seul moyen de son hygiène de vie. Au-delà de sa causticité, cette série australienne plus nuancée qu’il n’y paraît dresse un constat amer sur notre société.
“Apple Cider Vinegar”, sur Netflix : quand l’arnaque à la guérison miraculeuse fait recette
Glaçante : “Mon petit renne”
Adaptée en série, l’histoire vraie du harcèlement de Richard Gadd (comédien et scénariste écossais (Sex Education, Outlander) qui joue ici son propre rôle. Un épisode traumatique qui a ébranlé sa vingtaine, qui donne un fascinant thriller, poisseux et complexe.
“Mon petit renne”, la série qui vous hante longtemps
Rocky au Mexique : “La maquinà”
Gael García Bernal et Diego Luna, meilleurs amis dans la vie, produisent et interprètent les rôles principaux de cette honnête minisérie mexicaine sur un boxeur dans les cordes face au drame de sa notoriété déclinante.
“La Máquina”, minisérie sur Disney + : un ex-cador de la boxe au cœur d’une sombre machination
Insolente : “Dope Girls”
Dans un Londres post-Première Guerre mondiale, trois femmes luttent pour s’imposer. Cette série se distingue par ses héroïnes fortes, son ton irrévérencieux et une réalisation survoltée… qui peut agacer.
q “Dope Girls”, sur Canal+ : un drame historico-féministe au ton irrévérencieux
Inquiétante : “L’Écho du silence
Autour de Maura plane un mystère insondable. Si les allers-retours dans le temps orchestrés par Simo Halinen peuvent laisser perplexes, le dénouement de son intrigue convainc quant à sa pertinence.
q “L’Écho du silence” : une minisérie nordique haletante, hantée par les fantômes du passé
Plans cul : “Fleur Bleue”
Il y a le mec patriote, le mec inquiet, le mec déconstruit, celui qui l’appelle « frère », etc. Les plans cul de Fleur, c’est très drôle. Des pastilles très écrites mais pas si éloignées de la réalité…
r “Fleur bleue”, sur MyCanal et YouTube : les coups d’un soir, c’est toute une histoire
DREAM ON”
La première série par ceux qui ont fabriqué “Friends”
PAS RECENTE, MAIS UN RETOUR. DOMMAGE PAS DE VOSFR

EXTRAIT TELERAMA.Diffusée sur le câble en France dans les année 1990, la première série de David Crane et Marta Kauffman est un joyau brut de créativité, qui a fait basculer la télévision dans la modernité. Elle est entièrement disponible sur Paramount+.
«Vous qui entrez ici, abandonnez toute niaiserie » : ce pourrait être l’inscription facétieuse au frontispice de Dream On, la première série de David Crane et Marta Kauffman, les créateurs de Friends. Car, avant de confiner le regretté Matthew Perry et Jennifer Aniston dans une crèche aux allures de loft Airbnb, ils écrivaient pour le câble (HBO), et c’était quand même plus pittoresque.
Diffusée en France pour la première fois sur Canal Jimmy en 1992 (en VOST et sans rires préenregistrés, fait inédit à l’époque), Dream On est d’abord le projet fou de John Landis, réalisateur culte des années 1980 (Blues Brothers, Un prince à New York…), qui propose à la Universal de bricoler « je ne sais quoi » avec les archives du studio. Des séries d’anthologie en noir et blanc pour l’essentiel, tels La Quatrième Dimension ou General Electric Theater, où cachetonnaient alors de jeunes acteurs et de vieilles gloires du cinéma, aussi hétéroclites que Joan Fontaine, Bette Davis, James Mason et même John Cassavetes !
Effacemment de la frontière du réel
Crane et Kauffman ont alors une idée de génie, certes pas nouvelle, mais révolutionnaire pour une série : illustrer les pensées du personnage principal au moyen de séquences tirées de ces collections. Dès la première scène, Peter Lorre (M le Maudit, Casablanca), flanqué d’un troisième œil derrière le crâne, fait hurler de frayeur une demoiselle dans Young Couples Only, un épisode de Twilight Zone. Martin Tupper, le héros de la série, se réveille en sursaut, c’était un rêve. Quelques plans plus tard, c’est Joan Crawford qui déclame son amour à… Ronald Reagan : Martin Tupper regrette sa séparation.
Sur les murs du lieu de travail de Tupper, des affiches (en français !) du Mépris, de Godard. Le ton est donné : voilà une série résolument cinéphile, qui crie son amour de la pulsion scopique. C’est surtout le premier mouvement véritablement post-moderne de la télévision : une mise en abyme romanesque (la petite lucarne passe son temps à se recycler), l’effacement de la frontière avec le réel, les personnages rencontrant les acteurs jouant leur rôle, bref, une écriture sérielle qui se déniaise et opère sa mue, achevée peu de temps après avec The Wire notamment ou The Officeplus tard.
Grand bain existentiel puéril et psychanalytique
Mais de quoi ça parle, au juste ? Paramount+ (pour une raison mystérieuse) n’ayant pas jugé bon de proposer le pilote (ou pas pu ?), voici le pitch, aussi fin que du papier à cigarettes : Martin Tupper, quadragénaire new-yorkais salarié d’une maison d’édition de romans à l’eau de rose (parfois « olé-olé »), papillonne depuis que son ex-épouse s’est remariée avec le Dr Richard Stone, un homme écrasant de classe et de perfection (qui sera décrit par une scène hilarante des Évangiles).
Autour de lui gravitent un nombre de conquêtes ahurissant mais surtout, son ex-femme, Judith, talentueuse psychologue pleine de hauteur, avec qui il conserve une belle relation, son meilleur amin Eddie Charles (joué par deux acteurs différents !), présentateur de talk-show (et chaud lapin lui-même), son ado de fils sacrément mature, une secrétaire irascible qui refuse d’exécuter la moindre tâche − ou alors contre des bakchichs − , un ignoble yuppie en guise de patron (Michael McKean, le blond peroxydé de Spinal Tapet grand frère intraitable de Bob Odenkirk dans Better Call Saul, ici au sommet de sa forme). Tout ça dans une sorte de grand bain existentiel puéril et psychanalytique sur l’amour, le sexe et la recherche impossible du bonheur.
Séquences hallucinantes
Le tout en se permettant souvent de folles embardées (pour l’époque), notamment lorsque le père et le fils partagent un joint ou parlent cunnilingus, et des expérimentations scénaristiques hallucinantes : on se souvient encore de ce segment inaugurant la saison 2, où David Bowie himself adapte et dirige la vie de Judith, avec Tom Berenger (!) dans le rôle de son nouvel amant, un anonyme pour jouer Tupper (portraituré en loser), Ricardo Montalbán (le directeur en costume blanc de L’Île fantastique) et surtout Sylvester Stallone dans son propre rôle qui avoue n’avoir qu’un seul regret : celui de ne pas avoir interprété Richard Stone, le nouveau mari parfait de Judith ! L’épisode (réalisé par Landis lui-même) est si génial que même le journal Libération lui avait consacré un article entier en 1995.
Reste que la série prend sûrement trop de libertés. Ainsi, cette obsession de montrer chacune des maîtresses de Tupper dans leur plus simple appareil ressemble à de la grivoiserie forcée, systématique, plus male gaze tu meurs. Une certaine égalité de façade est à l’œuvre : lorsque des actrices apparaissent en soutien-gorge, le comédien qui les côtoie est affublé d’un simple porte-jarretelles ; si Tupper fantasme une enseignante topless, elle ne manquera pas de l’imaginer à poil aussi (l’occasion de voir les fesse – assez plate – de Brian Benben), etc.
Une douceur poétique
Contrairement à Friends, justement accusé de grossophobie ou d’homophobie, la série était paradoxalement assez en avance sur quelques idées progressistes. Par exemple lorsque Tupper pense chaperonner sa sœur, sorte de correspondante et interprète de guerre, on aura vite fait de le ridiculiser, lui, petit éditeur pusillanime. Ou avec l’épisode 6 de la saison 1, entièrement consacré à montrer la monstruosité du masculinisme et de l’idéalisation des femmes en idoles maternantes.
De cette façon, le sexisme un peu vieilli a davantage quelque chose de ringard et candide. Quant au rythme, il est parfois un peu indolent, manquant de causticité. Reste que cette bonhomie a quelque chose de la douceur poétique et ne doit pas faire complètement oublier que le reste du temps, c’est à mourir de rire.
Une petite anecdote pour finir : si vous avez toutes et tous en tête le logo de HBO (celui avec de la neige sur un écran de télévision), c’est à Dream On que vous le devez. C’est le motif du générique de la série, une des premières de la célèbre chaîne câblée. Étonnant, non ?
r Dream On, sitcom créée par Marta Kauffman et David Crane (États-Unis, 119 × 22mn, 1990-1996). Avec Brian Benben, Larry Miller, Wendie Malick. Sur Paramount+.
THE LAST OF US

Quand le monde tel que vous le connaissiez n’existe plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient floue, quand la mort se manifeste au quotidien, jusqu’où iriez-vous pour survivre ? Pour Joel, la survie est une préoccupation quotidienne qu’il gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d’Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va mettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre.
L’adaptation du jeu vidéo The Last Of Us en série.CRIMINAL



Les tensions éclatent dans le huis clos d’une salle d’interrogatoire et le voile se lève sur diverses affaires.
La série s’articule sur douze épisodes divisés et situés dans quatre pays distincts :
La France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Espagne se sont réunis pour Criminal, une série en douze épisodes d’enquêtes distinctes. Trois affaires par pays et trois tours d’interrogatoires en huis clos sont menés par des détectives spécialisés. Le design du titre de Criminal (les lettres i coïncidant avec les contours d’une vitre sans tain)
La meilleure est celle située en Grande-Bretagne.
GEORGE & TAMMY
L’histoire fièvreuse et tragique du couple de deux géants de la country, immenses stars aux États-Unis, rendue avec brio en six épisodes. Où Jessica Chastain et Michael Shannon, admirables

Bande annonce par lien
THE RESORT (saison 1)

En vacances au Mexique pour fêter leurs dix ans de mariage, Emma et Noah trouvent un vieux téléphone qui les précipite dans une aventure rocambolesque. Une comédie fantastique et mélancolique sur la quête du premier regard, parfaite série de l’été.
REPTIL
Avec Benicio del Toro
NETFLIX. Critique T : “Un inspecteur enquête sur la mort d’une femme, pour laquelle tout le voisinage semble suspect. L’acteur, co-crédité au scénario, règne en maître dans ce drôle de film néo-noir qui lorgne sur David Fincher“

Benicio del Toro bidouille sa boucle d’oreille. Elle est là, puis, sur le plan d’après, disparaît. Son personnage l’enlève et la remet, mais pourquoi ? L’inspecteur Tom Nichols est un flic ultra vertueux. Ultra corpo, aussi : dans son commissariat précédent, il a très certainement couvert un collègue corrompu. Pour l’honneur.
Ce personnage éclipse tous les autres, à commencer par celui de Justin Timberlake, un agent immobilier fané. Sa compagne est assassinée, il devient le premier suspect. Viennent ensuite l’ex-mari pas encore divorcé et le voisin bizarre (le revenant Michael Pitt, qui d’autre ?). La moitié du quartier, donc. Heureusement, Tom Nichols s’empare de l’enquête… Et flashe sur le robinet de l’un de ses suspects. Jusqu’à se procurer le même – un superbe modèle à détection de mouvements.
Del Toro (co-crédité au scénario) excelle dans ce rôle de flic hard boiled classique et revenu de tout, mais qui ne résiste pas à un bon mot lâché dans un demi-sourire, ou danse avec son épouse le week-end. Reptile, sorte de néo-noir qui fait plutôt dans le gris, est bâti sur ce genre de contrastes. Pour son premier long métrage de fiction, Grant Singer – rien à voir avec le Bryan de Usual Suspects – livre un film à l’ancienne, tendance 90’s, gentiment « fincherien », où les indices sont partout pour qui veut bien regarder. Sa réalisation est fluide, ample, parfois trop démonstrative.
Ainsi, la résolution de l’enquête est à la fois plus que prévisible dans le texte, mais tout à fait satisfaisante dans la mise en scène, comme la façon dont elle réveille le film et ses personnages – et le spectateur qui, bien que diplômé d’aucune académie de police, a déjà mis la main sur le coupable. C’est une histoire de frisbee et de coups de feu ; côté boucle d’oreille, contrairement à bon nombre de détails, c’était bien une fausse piste.
TINY BEAUTIFUL THINGS

Sugar (Kathryn Hahn), autrice dans l’impasse, est projetée à la tête d’une rubrique de courrier des lecteurs. Créée par Liz Tigelaar d’après une histoire vraie, une minisérie aigre douce où les coups durs tirent vers le haut.
D’après la collection d’essais à succès de Cheryl Strayed, « Tiny Beautiful Things » raconte l’histoire d’une femme dont le mariage est au bord du gouffre, à qui sa fille adresse à peine la parole et dont la carrière d’écrivaine est au point mort. Du coup, quand un ami lui propose de reprendre une rubrique de conseils, elle pense être la personne la moins indiquée pour le poste.. . alors qu’elle pourrait se révéler parfaitement qualifiée.
FUNNY WOMAN
Extrait TELERAMA
Barbara Parker (Gemma Arterton) devrait se contenter d’être jeune, jolie et la nouvelle miss Blackpool. C’est en tout cas la conviction du reporter qui se concentre davantage sur son décolleté que sur ce qu’elle a à dire. Alors sous le regard sidéré de ses concurrentes, elle rend sa nouvelle couronne comme on rend son tablier. Et fuit une existence provinciale, un fiancé insistant et un père aimant pour découvrir le Londres des Swinging Sixties. Rien n’y sera simple pour la jeune femme, mais sa culture de la comédie et son tempérament burlesque finiront par lui ouvrir les portes du show-business.
Adaptée de Funny Girl, le roman de Nick Hornby, paru en 2014, la série est fidèle à la plume caustique, joyeuse et bienveillante d’un romancier qui, livre après livre, prend des nouvelles de la société britannique autant qu’il en donne. Dans Funny Woman (Prix du jury étudiant au dernier festival Séries Mania), la gaieté et la profondeur se côtoient d’emblée sans jamais s’oblitérer grâce au talent de Morvenna Banks, sa créatrice. Au rythme d’une BO irrésistible, l’aventure émancipatrice de Barbara, qui refuse crânement d’être prisonnière de ce que les autres projettent sur sa plastique, est servie par la réalisation enlevée et ultra pop d’Oliver Parker. Si l’ensemble du casting s’en donne à cœur joie, Gemma Arterton, qui s’adonne à un festival de facéties et de mimiques, l’emporte en affirmant que l’humour est la solution à tout dans la vie. Réjouissant !
I’M A VIRGO

sur Prime Video, une série où l’étrange ne connaît pas de frontières;
L’histoire d’un géant
On donne toute la critique bien écrite de “Cineman”

© Amazon Prime Video
Voilà longtemps que l’on n’a pas vu une série aussi originale. Réalisée par Boots Riley, «I’m a Virgo» met en scène un ado de 4 mètres de haut à Oakland. L’occasion d’aborder des questions raciales et d’égratigner le capitalisme.
(Un article de Maria Engler, traduit de l’allemand)
Cootie (interprété par Jharrel Jerome, croisé notamment dans «Moonlight» ou «When «They See Us»), mesure près de quatre mètres. Élevé par sa tante Lafrancine (Carmen Ejogo) férue d’astrologie, et après une enfance sans aucun contact avec le monde extérieur, le jeune homme de 19 ans découvre enfin la vie sous toutes ses facettes : l’amour, l’amitié, la peur, la haine et l’injustice. Débarquée le 23 juin sur Amazon Prime Video, la création du rappeur et activiste Boots Riley (qui passait derrière la caméra pour la première fois en 2018 avec «Sorry to Bother You») est une œuvre à la saveur singulière, unique, original et qui fourmille d’idées. À la télévision, ces œuvres sont rares, alors voici cinq bonnes raisons de se plonger dans «I’m a Virgo».
1 – Cohérent dans sa propre vision

Là où d’autres productions se seraient lâchement reposées sur leur idée de départ, aussi saugrenue soit-elle, «I’m a Virgo», au contraire, en décante tout le potentiel. En effet, la série va encore plus loin que l’amusante et fantastique idée de placer un protagoniste de 4 mètres de haut au centre de l’intrigue.
Cootie n’est pas seulement grand. Il est aussi un adolescent maladroit biberonné à la télévision et fondu de comics. Si énorme, qu’il avait, jadis, fait s’écrouler la maison de ses parents. Ses vêtements sont faits sur-mesure, et il utilise les voitures en guise d’haltères. Oui, mais derrière sa démesure se cache un être sensible. Boots Riley, et son attention pour le détail, donne à cette vie gigantesque une authenticité particulière et les défis qu’il se lance, à lui-même et à son entourage, prennent sensiblement plus de poids. Alors qu’il s’apprête à sortir de son cocon, une question se pose : comment la société réagira-t-elle face à Cootie ?
2 – Un monde inattendu

Un géant cloîtré dans un monde miniature. Sous ses airs de conte, la fantaisie de la série ne s’arrête pas à la taille de son personnage. Le monde dans lequel évolue Cootie semble tout droit sorti de ces bandes dessinées qu’il chérit tant. Au travers des écrans de télévision qui scintillent et les brèves incartades des réseaux sociaux, les créateurs sèment des indices qu’il nous faudra récolter au fur et à mesure. Notons, par exemple, un super-héros volant (Walton Goggins, croisé récemment dans «The Righteous Gemstones») qui opère aux côtés des forces de l’ordre pour réprimer la population africaine-américaine du quartier. Ou encore, la jeune Flora (Olivia Washington, «The Butler»), dotée de quelques étranges pouvoirs, tandis que ses parents semblent travailler sur un complot impliquant des armes à feu futuristes.
3 – Un conte ancré dans le réel

Aussi éloignées puissent-elles paraître, les réalités d’«I’m a Virgo» et celles d’Oakland ont pourtant bien des points communs. L’inventivité de la création de Boots Riley ne fait d’ailleurs que mettre en lumière les problématiques que ces deux mondes partagent. Lorsqu’un super-héros combat bras dessus, bras dessous avec les autorités, les événements s’interprètent à leur avantage, l’image de l’ennemi est violemment erronée et ce sont les minorités qui trinquent. Rappeur et activiste, Boots Riley est un virtuose, nous le savions. «I’m a Virgo» parle avec ingéniosité, et véracité, des luttes des personnes de couleurs aux États-Unis, de la pauvreté, de l’injustice et propose en outre une satire du capitalisme aussi étonnante que cinglante. La chose est pour le moins surprenante dans le cadre d’une production signée Amazon Prime.
4. Une merveille visuelle

Visuellement, «I’m a Virgo» convainc de bout en bout. Les effets sont irréprochables, les scènes stupéfiantes. Elles auront parfois cette agréable sensation d’étrange, surtout lorsque Cootie interagit avec des personnes de taille normale ou lorsqu’il se trouve à l’intérieur où l’étroitesse est insupportable. L’illusion de ce géant fonctionne à merveille. «I’m a Virgo» ne cesse de produire des moments de ravissement visuel. Les nombreux décors, meubles et autres bibelots, construits par le réalisateur lui-même, sont particulièrement réussis et maintiennent une forme d’artisanat dans une mise en scène qui ne s’épuise jamais.
5 – La jungle médiatique

«I’m a Virgo»© Amazon Prime Video
Si l’authenticité d’«I’m a Virgo» étonne, c’est aussi dans sa capacité à dépeindre les médias qui peuplent le monde du protagoniste. Notons les publicités pour hamburgers étrangement sexualisées, des chambres d’hôpital pavées d’affiches, de slogans, des myriades de vidéos sur Internet et ces émissions matinales qui pullulent.
Une jungle médiatique qui semble tout droit sortie de chez nous, et il faudra aussi relever la série «Parking Ticket», que visionnent régulièrement les personnages et dont les produits dérivés apparaissent à peu près partout. Ces dessins animés proposent des personnages extrêmement singuliers, ainsi que des commentaires pointus sur la société et des débordements philosophiques qui, à leur tour, résonnent dans l’intrigue d’«I’m a Virgo».
Les 7 épisodes de «I’m a Virgo» sont à découvrir sur Amazon Prime Video depuis le 21 juin.
DAISY JONES & THE SIX

The Six, un groupe de Pittsburgh mené par le beau Billy Dunne (Sam Claflin), débarque à Los Angeles, où sa rencontre avec une chanteuse et parolière surdouée, Daisy Jones (Riley Keough), va propulser son ascension tout en déchaînant les passions. Imprégné d’une nostalgie communicative pour la Californie de troubadours mythiques, ce drama rétro au casting splendide, tourné in situ et raconté à la première personne sur le mode du faux documentaire, recrée avec force détails la sensation de liberté d’une époque révolue. La grande réussite de la série tient à ses chansons originales : dans les grisantes scènes de concert et de studio, Sam Claflin et Riley Keough forment un duo incandescent, donnant corps à ce moment magique où l’alchimie créative l’emporte sur les enjeux de pouvoir.
DES GENS BIEN
Une comédie burlesque récompensée du Grand Prix de la série au Festival TV de Luchon 2023. Le truculent récit de ce qu’il advient lorsque des gens bien, s’estimant injustement lésés par le système, décident de petits arrangements avec la légalité.

Après “La Trêve”, sur Netflix, les réalisateurs et scénaristes belges Benjamin D’Aoust, Matthieu Donck et Stéphane Bergmans créent un polar ponctué d’effets comiques déconcertants.
Dans la nuit noire, une voiture en flammes illumine une route en lacets, nichée dans la forêt ardennaise. Tom Leroy, policier d’un commissariat situé non loin de la frontière franco-belge, assiste à la scène, sonné. Parmi les sapins se déroule ainsi le crime originel de la nouvelle série du trio belge Benjamin d’Aoust, Matthieu Donck et Stéphane Bergmans, Des gens bien, disponible sur arte.tv et diffusée jeudi 13 avril sur Arte. Un décor naturel, déjà théâtre de deux enquêtes menées par Yoann Peeters, l’agent de la police d’Heiderfeld et héros de La Trêve, précédente série imaginée par les trois acolytes. Des Ardennes mystérieuses, pouvant passer en un instant de la lumière enveloppante à l’ombre menaçante, que le trio érige au fil de ses projets en véritable far west belge.
Mais si les trois hommes d’orchestre continuent, avec Des gens bien, à cultiver cette atmosphère inquiétante, le registre dans lequel ils opèrent a subitement glissé du belge noir à la tragicomédie. Dans ce polar burlesque à l’humour déconcertant, Tom et Linda Leroy, un couple criblé de dettes, tente de s’en sortir en échafaudant une arnaque à l’assurance. Une magouille de truands amateurs qui vire forcément à la catastrophe.
Cette seconde fiction se révèle ainsi un mélange truculent et équilibré d’humour noir et de tension acérée, volontiers inspiré par le cinéma des frères Coen. « Ce qui fait qu’un film comme Fargo fonctionne c’est qu’il s’appuie sur une base dramatique très grave, servie par une direction artistique excellente, avant de nous surprendre avec de la comédie, explique Matthieu Donck. De même, dans notre cas, la consigne de départ, humour ou non, était de faire les choses très sérieusement. » Dans Des gens bien,comme dans La Trêve, une mise en scène soignée, des séquences entrecoupées de vues aériennes sur les Ardennes insondables, participent à poser les fondations d’un thriller des plus minutieux. Bérangère McNeese et Lucas Meister campent quant à eux avec justesse le couple pathétique aux abois, empêtré dans une situation abracadabrantesque, aux côtés de figures résolument burlesques (François Damiens, Corinne Masiero…) qui insufflent du rire dans le drame.
Un duo touchant dépassé par les événements, deux protagonistes « normaux », à l’image des héros ordinaires qui semblent fasciner Donck, Bergmans et D’Aoust. Le couple modeste, incapable de rembourser ses emprunts, succède ainsi au village secoué par le meurtre d’un jeune footballeur d’origine togolaise dans la première saison de La Trêve… « Nous aimons nous intéresser à des protagonistes qui peuvent éclairer le monde dans lequel nous vivons. Les personnages qui n’ont jamais accès à la parole nous touchent », explique Benjamin D’Aoust. Qu’importe le registre, en basant ses intrigues dans de petites communautés rurales, le trio continue de sonder la société contemporaine et la pensée humaine.
THE CONSULTANT

Ses deux héros, Elaine (Brittany O’Grady) et Craig (Nat Wolff), sont les employés d’une start-up californienne de jeux vidéo dont le quotidien est bouleversé par l’arrivée de Regus Patoff (Christoph Waltz, génial et survolté), consultant excentrique prêt à tout pour redresser les finances de la boîte. Quitte à faire vivre un enfer à ses salariés… Elaine et Craig mènent l’enquête sur leur nouveau patron. Après Servant, Tony Basgallop imagine une nouvelle série satirique aux frontières du fantastique, sur fond d’open space et de gestion d’entreprise
THE HORROR OF DOLORES ROACH

Quand elle sort de prison, Dolores ne reconnaît plus sa ville. Et son amant, pour qui elle a pris seize ans, s’est enfui avec ses économies. Mais jusqu’où la mèneront ses désillusions ? Inclassable, la série oscille constamment entre comédie noire et conte horrifique. Tendue comme un bon thriller, elle nous maintient dans une apnée délicieusement insupportable. Mais, au-delà du simple divertissement efficace, ce que l’on retient, c’est un puissant et inattendu portrait de femme
THE DURELLS : A VOIR VITE

En 1935, une famille britannique au bord de la crise de nerfs et fauchée s’installe sur l’île de Corfou pour changer de vie. Louisa et ses quatre enfants vont devoir s’adapter à l’atmosphère méditerranéenne. Série feel good, The Durrells, une famille anglaise à Corfou, nous plonge dans une aventure familiale mouvementée.
Vite, vite, c’est sur Arte et l’on ne sait combien de temps va rester cette série (4 saisons) si fraiche, si fraiche, qui nous change des Kalachnikoff et autres sérial killers, sérial gnangans, serial conneries sur les plateformes. Le lien par un clic sur l’image ou ICI.
INSIDE N° 9)

Arte TV. Les saisons 7 et 8 de cette anthologie anglaise à l’humour très noir débarquent en France. Douze épisodes bourrés d’idées, entre vertige littéraire, traumatisme d’enfance et jeu télé explosif.
C’est le propre des anthologies que d’être inégales. Chacun de leurs épisodes étant une histoire à part entière, dans un nouveau décor, souvent sur une tonalité différente, difficile de tenir le niveau – même si c’est aussi pour ce renouvellement permanent qu’on les aime. Le mastodonte Black Mirror, dépassé par les révolutions technologiques, n’est plus le coup de poing au plexus qu’il fut jadis. Il est donc temps de découvrir sa cousine, Inside no 9. Lancé en 2014 par la BBC, cet autre bijou britannique met en scène les déboires de personnages confrontés à des événements a priori anodins, mais qui prennent une tournure tragique. Des historiettes qui n’ont que deux points communs : elles se déroulent toujours au numéro 9, en huis clos dans une maison, une salle de classe, un pédalo, etc., et sont incarnées par les deux créateurs de la série, Reece Shearsmith et Steve Pemberton.
Arte.tv, après avoir importé chez nous cet objet sériel culte outre-Manche, met en ligne vendredi 7 juillet ses deux dernières saisons en date, les septième et huitième (on regrette d’ailleurs que les précédentes ne soient plus disponibles). On y croise, dans le désordre, un instituteur qui débarque dans une école de campagne, des preneurs d’otage dépassés par les événements, un romancier impitoyable avec ses personnages, un paraskevidékatriaphobe (on vous laisse vérifier le sens de ce mot à rallonge) ou encore une célibataire qui s’inscrit sur un site de rencontre en ligne… Chaque histoire commence en douceur avant de progressivement déraper, pour finir en queue de poisson. En matière de twist final, Inside no 9 n’a rien à envier à Black Mirror ou à M. Night Shyamalan, l’auteur du Sixième Sens. À une exception près, impossible de découvrir le pot aux roses de ces douze nouveaux épisodes.
Mais la principale qualité de la série est ailleurs, dans le plaisir visible que Shearsmith et Pemberton prennent des deux côtés de la caméra. Les deux compères, grimés comme des gosses un jour de carnaval, pervertissent joyeusement les codes d’une foule de genres différents. Polar, horreur, comédie de potes et même jeu télé passent à la moulinette d’un humour noir de noir relevé ici ou là par un délicieux mauvais goût. Leur objectif est moins d’alerter comme Black Mirror sur l’état du monde – il est tout juste question d’écologie – que de jouer avec nos peurs et nos névroses. Certaines histoires attendent jusqu’à leurs ultimes secondes pour prendre sens, mais la plupart restent des pièces ludiques de bout en bout. Les meilleures parviennent, en l’espace de trente minutes, à paraître banales, puis improbables, grotesques, malaisantes, émouvantes et, in fine, glaçantes.
Si vous découvrez Inside no 9 avec ces saisons 7 et 8, commencez par l’ironique Paraskevidékatriaphobie (saison 8), puis passez au plus inquiétant M. Leroy (saison 7) et au mélancolique Ohé Ohé (saison 7) pour finir avec l’improbable 3 par 3 (saison 8). Quoi qu’il en soit, préférez picorer plutot que binger. La noirceur de la série finirait par déteindre sur vous. Consommés avec modération, ces nouveaux épisodes confirment qu’Inside no 9gagnerait à être mieux connue en France.
* POLAR PARK

Un message étrange pousse David Rousseau, un romancier spécialisé dans le polar mais en proie au syndrome de la page blanche, à se rendre à Mouthe. A peine est-il arrivé sur place qu’un meurtre est commis. L’écrivain pense tenir là de quoi s’attaquer enfin à un nouveau livre et entame une enquête qui gêne les investigations menées par l’adjudant Louvetot. Par ailleurs, Rousseau tente d’en apprendre davantage sur ses origines. Les références ne manquent pas dans cette mini-série à la frontière entre thriller et comédie, emmenée par un duo atypique.
(ARTE TV) Critique Télérama : Douze ans après son film Poupoupidou, Gérald Hustache-Mathieu réinvente sacomédie policière loufoque et émouvante. Il développe son univers enneigé, riche en références cinématographiques — une bonne dose de frères Coen, une louche de David Lynch et une pincée de Jacques Tati, le tout assaisonné de polar nordique. Polar Park trouve malgré tout son propre souffle grâce à une intrigue efficace et des personnages drôlement mélancoliques. Jean-Paul Rouve, lunaire mais grave, et Guillaume Gouix, psychorigide mais sensible, forment un duo savoureux. La délicatesse des dialogues et la fantaisie des situations finissent de faire de Polar Park un bel exemple de polar télé capable de sortir des clous.
THE HUNT FOR A KILLER

Arte TV
sur les traces d’un tueur de femmes suédois; À partir d’une série de féminicides perpétrés à partir de 1989 dans la Suède rurale, documentée dans un livre-enquête, la scénariste Helene Lindholm imagine un polar haletant, précis mais jamais sensationnaliste.
EXTRAIT TELERAMA (qu’on le veuille ou nonle meilleur magazine culturel)
La traque aura duré quinze ans. En mars 1989, alors que les jours rallongent à nouveau dans la petite ville de Hörby, au sud de la Suède, Helén Nilsson, 10 ans, sortie rejoindre des amies, disparaît. Une semaine plus tard, son corps sans vie est retrouvé au cœur d’une forêt voisine. Mais ce n’est qu’en 2004 que la police suédoise, grâce aux avancées de la science et de l’identification par l’ADN, retrouve enfin son assassin. À l’issue d’une enquête complexe qui a ébranlé le pays et que le journaliste Tobias Barkman retrace en partie dans son ouvrage Jakten på en mördare (« La Traque du tueur »).
Une matière qu’Helene Lindholm, figure du nordic noir en Suède, décline en fiction dans The Hunt for a Killer, Au fil des six épisodes d’une minisérie haletante, cette dernière retrace avec une approche précise, parfois crue mais jamais sensationnaliste, l’enquête fastidieuse menée par l’inspecteur Per-Åke Åkesson et ses équipes. Dans les années qui suivent le meurtre d’Helén, plusieurs femmes sont assassinées, dont une prostituée aux abords de Malmö. Et toujours – comme le suggèrent de constants et troublants allers-retours dans le temps – l’ombre du meurtre originel non élucidé plane.
Avec sobriété, ce true crime parvient à retranscrire l’atmosphère qui pesait alors. Les coscénaristes Helene Lindholm et Lotta Erikson s’attardent notamment sur les nombreux désaccords au sein de la police suédoise, sans doute à l’origine de la lenteur de l’enquête. Et si elles ne font qu’effleurer le contexte social de ces affaires – à une époque où le concept de « féminicide » n’est pas encore théorisé –, on comprend que les meurtres de ces femmes surviennent dans une province rurale et une société où le patriarcat demeure profondément ancré.
De “Better Caul Saul” à “Lucky Hank”, Bob Odenkirk, acteur équilibriste
** SUCCESSION (4)

TELERAMA ARTICLE COMPLET.
Le premier épisode de la nouvelle saison de Succession arrive en France, ce 27 mars, sur Prime Video (avec le Pass Warner). Nous revoilà plongés au sein de cette famille devenue un peu la nôtre au fil des dernières années. Cette quatrième saison – qui sera aussi la dernière, a annoncé son créateur, Jesse Armstrong – s’ouvre, à nouveau, sur l’anniversaire de l’increvable mogul Logan Roy (Brian Cox). Lors du tout premier épisode de la série, celui-ci profitait de la fête pour annoncer qu’il n’avait finalement pas l’intention de quitter son poste de pdg de Waystar Royco et de laisser sa place à son aîné. Cette fois, même cérémonie cotonneuse-fastueuse, même mine exaspérée du patriarche au moment de la chanson d’anniversaire. Mais, cette fois, il manque des invités à la surprise-party. Comme le lance cousin Greg (Nicholas Braun), génial géant de la gaffe qui appuie là où ça fait mal : « Où sont les enfants ? » Logan Roy ne voit pas de qui il veut parler. Lui, les appelle « les rats » (ou comment plier une bonne fois pour toutes le débat sur l’éducation positive).
Brian Cox, impitoyable Logan Roy dans “Succession” et roi du contre-emploi
Le trio a fait sécession, s’extrayant enfin (pour l’instant tout du moins) du jeu de massacre de l’éternelle rivalité fraternelle. Pour la première fois, Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) et Shiv (Sarah Snook) se sont unis – le coup d’État avait été lancé en fin de saison 3. Leur idéal collectif ? Le parricide. Pour ce faire, ils tentent de monter un site d’information « un putaclic pour intellos », résume Roman. Leur premier objectif de bataille consiste à surenchérir sur l’offre de leur père, à nouveau sur les rangs pour racheter la société de médias de la très wasp Nan Pierce (hiératique Cherry Jones). Cette dernière trouve décidément « abominable » de faire ainsi grimper les enchères mais sacrifie à l’exercice avec une perversité de violette qui vaut bien la fureur de Logan Roy. Lequel, apprenant la combine, hurle à son gendre Tom (Matthew Macfadyen, plus insaisissable que jamais d’énergie contrariée), désormais dans son camp : « Appelle ta connasse de femme. » Ambiance.
À lire aussi :
“Succession” : ils sont affreux, ultra-riches et méchants, alors pourquoi est-on accro ?
Sans rien spoiler, on notera que la haine reste le motif d’union le plus fédérateur au sein de Succession. L’ombre du fascisme plane toujours – l’élection approche, « façon 1933 », rappelle Shiv. Le langage est toujours plus fleuri qu’un tableau de Monet – il est notamment question des « mamelles-omelettes » de Logan Roy que « suçoterait » sa nouvelle jeune compagne – et les répliques plus meurtrières qu’un tir de sniper : « Marcia ? Elle est partie faire du shopping à Milan… à vie », enterre ladite remplaçante. Le bunker familial est aussi bourré à craquer de souffrances que traversé de fébriles moments de loufoquerie – cousin Greg a fait un graveleux « faux pas » (en français dans le texte) avec sa nouvelle petite amie lors de la réception. Celle-ci en paiera les conséquences, l’énamouré renonçant à la défendre (« Je ne veux pas savoir ce qui se passe à Guantánamo ») quand le garde du corps lui apprend qu’elle va devoir partir après vérification de son téléphone portable. Il faut dire qu’elle a osé (avant l’épisode du faux pas en chambre) brandir l’objet sous le nez du magnat Logan pour un selfie…
Capable de tous les décrochages, ce premier épisode réserve aussi un intense moment d’intimité désespéré entre Shiv et Tom. Une scène à l’os, presque atone, à mille lieues des concours d’éloquence auxquels nous a habitués la série.
* BODIES

Il pleut, alors on lance Netflix. Et sur Netflix, à la deuxième place du top 10, il y a Bodies : huit heures plus tard, on est toujours devant Netflix. On n’est pas en sucre, certes, mais le redoutable scénario de cette minisérie londonienne nous a terrassé. Impossible de l’abandonner en cours de route, sans avoir résolu l’un des dix-sept mystères de ce thriller SF adapté du roman graphique de Si Spencer. Les premières réponses n’arrivent que dans l’épisode 5, et, fait rare sur la plateforme, trois épisodes plus tard, la série… se conclut. Aucun dernier doute ou appel d’air ne laisse présager une suite éventuelle en fonction de son succès.
Bodies est calibrée pour briller en one shot. Il n’y a, en fait, qu’un seul body. Enfin, plusieurs fois celui de la même victime, à quatre époques différentes. Un corps découvert dans une ruelle de Whitechapel, « nu comme le jour où il est né » comme disent les Anglais. Et éborgné. Ça fait beaucoup, là, non ? C’est exactement ce que pensent les policiers de la série, chacun de son côté (1890, cliché victorien en toc ; 1941 sous le Blitz, plutôt réussi ; juillet 2023, totale zone de confort ; 2053, ambitieux mais parcimonieux) : c’est louche. Tous les quatre se disputent alors avec leur hiérarchie, qui préférerait étouffer l’affaire. On vous laisse imaginer la tête de la détective de 2023 (Amaka Okafor, excellente) lorsqu’elle découvre dans les archives de la police que le cadavre a déjà été enregistré deux fois.
Sans trop en dire, la série repose sur le décryptage progressif d’une vaste machination qui ferait passer V pour Vendetta pour un exposé de CE1. Avec force rebondissements, twists et autres chevilles de scénario exubérantes qui font avancer ou reculer l’intrigue, notamment les illuminations soudaines des personnages touchés par la grâce du dieu des flics. Pourtant, ils galèrent, chacun à leur manière. L’inspecteur de 1890 est homosexuel, celui de 1941, juif, celle de 2023, trop basanée et trop gentille – on l’a bien compris au bout du troisième suspect qu’elle cherche à sauver plutôt qu’à écrouer. Ils se prennent des répliques pataudes, évangile de la dénonciation des oppressions selon Netflix, mais mieux vaut en sourire. Dehors, il pleut toujours et nous, on a terminé de regarder, hypnotisé.
qBodies, minisérie de Paul Tomalin (GB, 8 × 50 mn, 2023). Adaptée du roman graphique de Si Spencer. Avec Shira Haas, Stephen Graham, Amaka Okafor, Jacob Fortune-Lloyd. Sur Netflix.
* STILL UP

“la comédie romantique qui réveille le genre”
EXTRAIT TELERAMA TTT : Lisa et Danny sont deux Londoniens insomniaques. Ils passent leurs nuits à débattre, en visio, de leurs galères et de leurs histoires d’amour. Deux héros imparfaits parfaits pour l’autre ?
Dany (Craig Roberts), un agoraphobe, cloîtré chez lui… Apple TV+
Par Pierre Langlais, Publié le 24 septembre 2023 à 20h00
Une bonne idée tient parfois à un jeu de mots. Still Up, c’est l’histoire de deux personnages qui ne dorment pas… ensemble. Lisa (Antonia Thomas) et Danny (Craig Roberts) sont deux insomniaques londoniens, inséparables mais à distance. Danny est agoraphobe, cloîtré chez lui. Lisa, elle, passe ses nuits aux quatre coins de la ville. Par écrans interposés, ils refont le monde, plaisantent de tout et de rien, se confient sur leurs vies intimes respectives. Elle est jeune maman, en couple. Il est célibataire, en pleine dépression depuis une séparation douloureuse. Still Up fait de ces deux oiseaux de nuit des âmes sœurs amicales. Tension classique de romcom : leur amitié n’est-elle pas prélude à autre chose ?
Un monde nocturne riche et délicat
La comédie de Steve Burge et Natalie Walter prend un risque en tenant à distance ses deux héros. Il faut pourtant peu de temps pour que Lisa et Danny deviennent irrésistibles. Elle est lumineuse et blagueuse, enchaîne les sorties à la pharmacie de garde, en boîte de nuit, au camping… Il est statique mais plein d’esprit, anxieux et doux. Ils sont imparfaits mais parfaits l’un pour l’autre, il n’y a qu’eux pour ne pas le voir. Sans jamais se croiser, Antonia Thomas (Misfits, Good Doctor) et Craig Roberts (Red Oaks) parviennent à créer une belle alchimie a priori amicale, tout en laissant planer le doute, ici ou là, pour qu’on s’interroge sur leurs sentiments.
Still Up met en scène un monde nocturne riche et délicat. Elle réserve les stéréotypes comiques aux personnages secondaires pour mieux dessiner les contours de ses deux héros, trouve le bon équilibre entre gags énormes et discussions sérieuses. Elle imagine des séquences originales – notamment une épique virée en bus à impériale – et se sort habilement des figures ultra balisées comme le dérapage sous hallucinogènes ou le premier rendez-vous. Mais c’est le fond dramatique de la série qui fait qu’on attend impatiemment l’épisode suivant : les blessures des personnages et le risque qu’ils passent à côté d’une belle relation. Danny se remet doucement d’un traumatisme amoureux, Lisa réalise lentement qu’elle n’est pas heureuse. Leurs trajectoires émotionnelles se croiseront-elles ? Réponse dans huit épisodes.
Still Up, saison 1, comédie romantique créée par Steve Burge et Natalie Walter, Grande-Bretagne, 8 × 30 mn. Trois épisodes depuis le 22 septembre, puis un nouveau chaque vendredi sur Apple TV +.
BANDE ANNONCE
SOUS CONTROLE
SYNOPSIS
Marie Tessier est fraîchement nommée ministre des Affaires étrangères lorsqu’une prise d’otages a lieu au Sahel. Celle-ci crée la discorde au sein du pouvoir. Volontaire et idéaliste, Marie enfreint les règles et tente de montrer que tout est sous contrôle. Elle n’hésite pas, même, à dépasser les limites, quitte à en devenir ridicule. La jeune femme découvre alors toute l’absurdité des codes politiques et du pouvoir en place. Les aventures de Marie Tessier sont présentées sur un ton humoristique et mettent à mal les hommes politiques français. Avec un humour caustique, “Sous contrôle” brocarde efficacement l’exercice de la politique à la française.
Pointure de l’humanitaire, Marie Tessier est aux toilettes quand elle reçoit un appel du président de la République : il la veut au Quai d’Orsay. La scène donne le ton de cette histoire de « poisson hors de l’eau », comme diraient les Anglo-Saxons. Même si la femme de terrain débarque plutôt dans son nouveau cabinet comme un éléphant dans un magasin de porcelaine… Étrangère aux codes du pouvoir et à la pratique des éléments de langage, elle multiplie les incidents diplomatiques, alors même qu’une prise d’otages au Sahel lui tombe sur le dos.
L’exercice du pouvoir est une vaste farce, et le scénariste Charly Delwart en tire une satire qui n’évite pas quelques baisses de régime, mais ne verse jamais dans le nihilisme anti-système. Cousine au second degré de la Selina Meyer de Veep, Marie Tessier croit en la politique plus que la politique ne croit en elle… Un paradoxe qui l’oblige à jauger jusqu’où elle peut faire des compromis — question qui se pose à quiconque veut tenter d’agir dans un monde complexe.
Réalisée par Erwan Le Duc (Perdrix), Sous contrôle orchestre la valse de communicants et autre directeur de cabinet, au milieu desquels un président très en marche (génial Laurent Stocker) passe toujours en coup de vent. On s’amuse du contrechamp sur le business de preneurs d’otages pragmatiques, qui font remplir un questionnaire de satisfaction à leurs détenus. Et on boit comme du petit-lait le talent de Léa Drucker, qui semble ne pas avoir de limites.PLUS D’INFOS
CASTING : Léa Drucker, Marie TeissierSamir, Guesmi, Harold Drassin, Laurent Stocker, Ferdinand Saulnier, Samuel Churin, Marc Bragie
DREAMING WHILST BLACK (saison 1)

EXTRAIT TELERAMA Par Pierre Langlais
Kwabena, la trentaine, costume terne et imposantes dreadlocks, travaille dans une agence d’intérim londonienne. Coincé au milieu de collègues gênants qui ne cessent de le renvoyer à sa couleur de peau et à sa culture jamaïcaine — en se pensant super cool —, il rêve de tout plaquer pour enfin vivre de sa passion, le cinéma. Il conserve dans ses tiroirs un projet de romance sur fond d’immigration qu’un producteur en quête de diversité semble être disposé à lui acheter. Mais l’enfer de l’industrie est pavé de bonnes intentions…
Avec Dreaming Whilst Black (« rêver tout en étant Noir »), Adjani Salmon suit la voie ouverte par Issa Rae (Insecure) et adapte une websérie éponyme, récompensée en 2022 aux Baftas — les Césars britanniques. Il y réinvente son propre parcours dans un mélange détonnant de comédie intimiste et d’ironie cinglante. Derrière les blagues embarrassantes, il épingle la discrimination raciale et son pendant prétendument positif, qui le pousse à faire « un film pour les Blancs » afin de rentrer dans le milieu — dans son cas, un drame où un gamin tombe pour trafic de drogue… Dreaming Whilst Black questionne ainsi la difficulté pour les artistes issus de minorités de s’exprimer pleinement et non de se plier à ce qu’on attend d’eux. Mais cette comédie politique préfère l’absurdité aux grands discours, et en revient toujours à la poisse de son héros charismatique, qui enchaîne les déconvenues hilarantes.
* LES 4 EPISODES DE WES ANDERSON TIRES DES NOUVELLES DE ROALD DAHL
I – LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE HENRY SUGAR

C‘est comme une petite brise chaude et lointaine, puis le gondolement des pages qui se tournent, un « oui » vénérable, comme pour se confirmer que tout est parfaitement agencé dans l’ordre du monde, ou pour le moins dans la cabane d’écrivain qui ouvre le film. Cette bicoque, c’est celle de Roald Dahl (Ralph Fiennes, parfaitement flegmatique), et on n’a jamais ressenti une telle sérénité dans le cinéma précipité, fiévreux, de Wes Anderson, qui adapte en quatre courts métrages autant de nouvelles de l’écrivain britannique. “La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar”, présenté à la Mostra de Venise, arrive aujourd’hui sur Netflix.
« Des cigarettes, du café, du chocolat » : c’est là tout le nécessaire de l’homme de lettres anglais avant de coucher une histoire sur le papier. Mais aussi : un crayon bien taillé, les rognures de gomme qu’on époussette. Ces pelures, on n’en a eu l’idée que parce qu’on a entendu (et vu) Ralph Fiennes en parler, passer la brosse sur l’écritoire. Et ainsi du crayon qu’on a taillé ou de la lumière du jour qui éclaire le bureau après qu’une main anonyme a tiré le rideau : rien de tout ça n’existe autrement que par la grâce de la projection.
En douceur, sans outrance
C’est là l’introduction malicieuse et discrète de ce récit fantastique (et gigogne) autour de l’empire du faux, métaphore du cinéma, prenant prétexte de suivre un forain indien (Ben Kingsley) et un dandy britannique (Benedict Cumberbatch) ayant tous deux réussi à maîtriser l’art yogi de voir « sans les yeux », autrement dit par l’esprit. De là, la faculté d’assurer des tours de divination pour l’un, de tricher aux cartes et s’enrichir pour le second. Leur méthode : « Oublier les milliers de détails, apprendre à ne visualiser qu’une chose, une seule. » Ironique pour l’amateur du cinéma de Wes Anderson…
À lire aussi :
On a classé tous les films de Wes Anderson, du plus décevant au plus délicieux
Baladés d’un décor à l’autre, d’une bibliothèque à la forêt luxuriante du Douanier Rousseau, ont-ils seulement existé ? Peu importe puisqu’on les a vus, et bien vus : sans les yeux. Comme si Roald Dahl répondait au Petit Prince de Saint-Exupéry, un sourire aux lèvres. Dans ses contes pour enfants, le romancier britannique se faisait volontiers cruel et caustique, c’est ici plutôt la douceur qui l’emporte : on évite soigneusement tout retournement spectaculaire, la critique de la société de consommation est sans outrance, et le finale a des allures de délicat crépuscule, comme pour se confirmer que tout est parfaitement agencé dans l’ordre du monde, ou pour le moins, dans le cinéma de Wes Anderson.
II- LE CYGNE

EXTRAIT TELERAMA Un jour, un Roald Dahl adapté par Wes Anderson pour Netflix. Ce magnifique deuxième court métrage sur le harcèlement emboîte avec brio le pas à son grand frère “La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar”.
Par Augustin Pietron-Locatelli
Combien d’intrigues dans Asteroid City ? Wes Anderson, depuis quelque temps, se plaît à orchestrer des récits morcelés, qui embrassent touche par touche un monde sans doute trop grand pour un seul film. Logique, donc, d’adapter un recueil de Roald Dahl, La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar et six autres nouvelles en quatre courts pour Netflix.
Père Castor, raconte-nous l’histoire du Cygne : ici, en ouverture, point de Ralph Fiennes (olympien interprète de Roald Dahl) mais le narrateur (Rupert Friend) qui présente sans détour un trauma de sa jeunesse. Comment deux brutes, lasses de maltraiter les oiseaux, s’en sont prises à lui.
Pour transposer une nouvelle qui repose essentiellement sur la stichomythie (succession rapide de courtes répliques théâtrales), Wes Anderson met en place un jeu de questions-réponses. Le Peter âgé joue les dialogues, tandis que le Peter jeune et les deux butors les incarnent. Chaque détail du court relève de la mise en scène tandis que la caméra se déplace dans toutes les directions possibles – gauche, droite, en avant, en arrière, case par case, comme la reine aux échecs.
r “La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar”, sur Netflix : Wes Anderson adapte Roald Dahl avec malice
L’histoire est déchirante, le ton zéphyrien. On assiste, poings serrés, au passage d’un train sur le jeune Peter. Qui d’autre que Wes Anderson pour en faire un geste poétique, leçon d’absurde et de mise en scène ? Le minimalisme fait loi. Rien à voir avec les luxuriants décors de Henry Sugar qui occupent tout l’espace, ici, tout ornement est avant tout une idée : un labyrinthe de haies puis de blé, des jumelles et des portes camouflées…
Que penser de cet horizon laiteux : est-ce le mur du studio, la matrice de Netflix ou les synapses de l’auteur britannique ? Ce blanc perçant interroge tout en recentrant notre attention sur le brio du texte. Mais on ne fera pas dire à Roald Dahl ce qu’il n’a pas dit : non, le harcèlement ne donne pas d’ailes.
r Le Cygne, fable de Wes Anderson (The Swan, États-Unis, 0h17, 2023). Scénario : Wes Anderson, d’après Roald Dahl. Avec Ralph Fiennes, Rupert Friend, Asa Jennings. Sur Netflix.
III – LE PRENEUR DE RATS

Pour notre plus grand plaisir, Wes Anderson poursuit son exploration de l’œuvre de Roald Dahl avec ce troisième court métrage, aussi réussi que les précédents. Une fable horrifique sur le pouvoir de l’imaginaire et l’art de la narration.
Et de trois ! Après La Merveilleuse Histoire de Henry Sugar, mis en ligne mercredi sur Netflix, et Le Cygne, disponible depuis hier, la plateforme dévoile aujourd’hui Le Preneur de rats, avant-dernier des quatre courts métrages réalisés par Wes Anderson d’après des nouvelles de Roald Dahl – en attendant Venin demain. Dans ce feu d’artifice(s) dépourvu de musique, le narrateur continue d’occuper le terrain sonore : ici, un journaliste prolixe (Richard Ayoade) tient cet emploi face caméra. À gauche de l’image, son bureau, bizarrement posé devant la vitrine du quotidien local d’un village anglais ; à droite, la station-service de Claud (Rupert Friend) ; en face, un champ où s’élève une meule de foin, paraît-il infestée de rats. Surgit l’homme providentiel, le dératiseur (Ralph Fiennes), personnage répugnant aussitôt surnommé « Rat Man » – sa longue chevelure grise, ses griffes sales et ses incisives de rongeur donnant un double sens au raccourci.
À lire aussi :
On a classé tous les films de Wes Anderson, du plus décevant au plus délicieux
Écrite dans les années 1940, alors que Dahl résidait à Amersham, au nord-ouest de Londres, la nouvelle appartient à la veine la plus noire de son œuvre et décrit l’étrange mimétisme entre le tueur et sa proie, ainsi que le dégoûtant spectacle de la cruauté humaine. Anderson en tire logiquement un film d’horreur, poursuivant sa passionnante recherche formelle (c’est un festival de plans-séquences et de conventions brisées, explosion du quatrième mur, intrusion des accessoiristes, changements à vue…).
S’il s’agissait pour Henry Sugar de réussir à voir sans les yeux, par la seule force de l’esprit, le défi consiste cette fois à regarder l’invisible. Dans l’une des scènes les plus marquantes de ce bref exercice de style, l’homme-rat extrait ainsi de sa poche un gaspard imaginaire, puis de l’autre un furet inexistant. Imperceptible (et se déroulant de toute façon sous la chemise du bonhomme, à même sa peau, beurk), le duel à mort entre les deux bestioles n’en possède pas moins une terrible force évocatrice, hommage combiné au hors-champ et au pouvoir créateur, infini, de la lecture.
r Le Preneur de rats, fable de Wes Anderson (The Ratcatcher, Etats-Unis, 0h17, 2023). Scénario : Wes Anderson, d’après Roald Dahl. Avec Ralph Fiennes, Rupert Friend, Richard Ayoade.
IV – POISON

Pour le dernier des quatre courts métrages tirés des nouvelles de Roald Dahl, Wes Anderson se frotte en virtuose à une intrigue plus sombre, au suspense très efficace, déjà adaptée par Alfred Hitchcock en 1958.
Ces quatre courts métrages que Wes Anderson a réalisés pour Netflix en hommage à Roald Dahl, Venin est, sans doute, le plus angoissant. En Inde, le narrateur, Timber Woods (Dev Patel) rend visite de nuit à son ami Harry Pope (Benedict Cumberbatch). Il le trouve alité, immobile, chuchotant des mots à peine intelligibles. Et pour cause : sur le ventre de Pope, dissimulé sous le drap, se promène un bongare, un petit serpent dont la morsure est mortelle. Timber fait alors venir un médecin indien, le docteur Ganderbai (Ben Kingsley), pour qu’il administre à Pope un sérum préventif et endorme le redoutable reptile…
Comme pour La merveilleuse histoire d’Henry Sugar, Le cygne et Le preneur de rats, le réalisateur texan use en virtuose de tous les artifices de la représentation cinématographique, picturale mais, aussi, théâtrale (avec, en prime, le commentaire de Roald Dahl incarné par Ralph Fiennes en robe de chambre et pantoufles !), pour développer cette intrigue au suspense très efficace. Le maître en la matière, Alfred Hitchcock, avait d’ailleurs adapté la même nouvelle de Roald Dahl dans Poison (1958), un épisode fameux de sa série Alfred Hitchcock présente. En bon pervers, « Hitch » avait présenté les deux protagonistes comme des rivaux amoureux, Woods prenant un plaisir sadique à torturer son « ami » en tardant à appeler les secours, avant un épilogue d’un humour noir ravageur. Wes Anderson, lui, est resté fidèle à la lettre comme à l’esprit de Roald Dahl. Jusque dans l’expression à mots très crus du racisme du personnage de Pope.
BABYLON BERLIN

CANAL +
La saison 4 de la série la plus chère produite par la télévision allemande entre dans les années trente et voit la montée du péril brun.
31 décembre 1930. Dans les rues de Berlin, les effets de la crise économique de 1929 se font amèrement sentir. Chômage massif, famine, misère… La nuit, comme cette soirée de la Saint-Sylvestre, ceux qui le peuvent encore dansent jusqu’à l’épuisement, pour oublier un temps les malheurs du jour et rêver à des lendemains meilleurs… Lesquels n’arriveront pas de sitôt : Hitler n’a pas encore été élu chancelier, mais déjà la peste brune gagne du terrain dans toutes les strates de la société. Auprès des plus jeunes, chez les plus riches industriels du pays, et jusque dans les rangs de la police…
Dans cette quatrième saison, la série la plus chère jamais produite à la télévision allemande continue de dépeindre avec la même acuité, sans œillères, les multiples visages d’une république de Weimar désormais crépusculaire, et qui sert ici de toile de fond à un nombre record d’intrigues. Trahisons et espionnage, chantage et assassinats, enlèvements et vol de diamant : les férus de rebondissements tous azimuts en auront pour leur abonnement à Canal+. Les amateurs de reconstitutions précises et somptueuses aussi : Babylon Berlin a, on l’a dit, les moyens de ses ambitions, et ils sont toujours aussi judicieusement alloués.
Mais au-delà des décors rutilants, de la bande-son tonitruante, de la finesse historique, la plus grande réussite de la série (qui connaîtra prochainement une cinquième saison) réside sans aucun doute dans la passionnante complexité de ses personnages. Gereon Rath, bien sûr, ex-soldat devenu commissaire de police, mais resté traumatisé par l’expérience des tranchées — il s’essaye, cette saison, à l’expérimentale pervitine (1) pour tenter d’apaiser ses troubles. Mais aussi Charlotte Ritter, son assistante sans peur et sans reproches, qu’on a vue gravir patiemment les échelons et qui, approchant enfin de son but, va voir une nouvelle fois le destin se mettre en travers de son chemin.
* THE UNDECLARED WAR

une saisissante série dystopique au royaume des cyberattaques
En 2024, les services secrets britanniques tentent de déjouer une offensive russe contre le système électoral du Royaume-Uni… Une fiction palpitante, par le vétéran Peter Kosminsky.
Et si ? De cette toute petite question, Peter Kosminsky (Warriors) a fait une minisérie prophétique d’une précision documentaire glaçante. Plus politique que jamais, le créateur britannique revient au petit écran avec The Undeclared War, en investissant cette fois l’univers d’Internet. Il y met en scène une guerre « non déclarée » entre la Russie et le Royaume-Uni, prolongation hypothétique des visées expansionnistes de Vladimir Poutine en Ukraine.
Tout débute à Cheltenham, dans le sud de l’Angleterre, à quelques semaines des élections législatives de… 2024. Au QG du renseignement britannique, le GCHQ, une équipe d’analystes dirigée par Danny Patrick (Simon Pegg), flegmatique chef des opérations, fait face à une cyberattaque d’une envergure inédite. Ultra performants, ses membres réagissent sans pour autant saisir immédiatement le degré de sophistication du piège qui leur est tendu. C’est Saara, une codeuse stagiaire fraîchement débarquée dans ce département, incarnée avec une intensité bouleversante par Hannah Khalique-Brown, qui parvient à comprendre le modus operandi de l’ennemi.
Usine à trolls
La force de la jeune femme ? Sa double différence. Née dans une famille d’immigrés, elle incarne un métissage culturel douloureux à porter au quotidien mais qui lui permet de penser autrement dans cet univers majoritairement masculin et blanc. Peu à l’aise en matière de relations sociales, Saara est en revanche surdouée dès qu’elle se met au clavier d’un ordinateur. Talent qui l’amène à se déplacer avec une dextérité remarquable dans les lignes de code qu’elle traduit aussi facilement que si elle sautait dans les cases de la marelle d’une cour de récré. Outsider, idéaliste et obsessionnelle, elle irrite ses collègues mais gagne la confiance de sa hiérarchie grâce à ses fulgurances. Elle devient centrale dans la gestion d’une crise qui prend un tournant effrayant lorsque Andrew Makinde (Adrian Lester), le Premier ministre conservateur en proie aux difficultés économiques du pays, se lance dans une surenchère imprudente à des fins politiciennes.
De l’autre côté des écrans, une jeune journaliste et un étudiant russes, employés dans une usine à trolls, tentent d’enrayer l’engrenage. Le jeu de chat et de souris devient alors un addictif jeu de miroir porté par une réalisation subtile et tendue. Kosminsky prend bien soin de dessiner des personnages complexes et évite ainsi l’écueil du manichéisme simpliste dans lequel le sujet pouvait l’entraîner.
Les clés de l’avenir à la jeunesse
Comme dans Le Serment (2011), sa série sur la responsabilité anglaise dans le conflit israélo-palestinien, ou The State (2017), centrée sur des adolescents britanniques qui partent faire le djihad en Syrie, c’est à travers le regard de la jeune génération que l’ex-reporter et documentariste questionne la possibilité d’un monde meilleur dans The Undeclared War. Un monde rendu plus vulnérable par la révolution numérique et la généralisation des fake news comme armes de propagande d’une puissance dévastatrice.
À lire aussi :
“A Spy Among Friends” sur OCS Max : les bons espions font de mauvais amis
Jusque-là, Kosminsky oscillait brillamment entre l’œuvre de mémoire et la fiction pédagogique. Cette fois, après de longues années de recherches, il enfile la casquette de lanceur d’alerte cathodique : « Je veux alerter les gens sur les dangers bien réels qui nous menacent en tant que pays et comme civilisation. J’ai aussi voulu éclairer la guerre de l’information qui sévit. Nous y avons été confrontés pendant la campagne pour le référendum sur le Brexit ou l’élection présidentielle américaine. Les réseaux sociaux peuvent être détournés pour influencer les opinions publiques et nous entraîner vers des objectifs définis par des cerveaux qui n’ont pas nos meilleurs intérêts à cœur. » Au terme de ces six épisodes, il confie, à 67 ans, les clés de l’avenir à la jeunesse. Un vote de confiance sériel, en somme
BANDE ANNONCE
UN PANACHÉ DE SERIES ANNÉES 2020
ACHARNES (BEEF)
sur Netflix : Télérama “une vendetta furieuse et vibrante qui tient bien la route“
Un clash en voiture, et deux existences qui partent en vrille. Existentielle et cartoonesque, cette série irriguée de colère percute la question du libre arbitre et ose une émotion déroutante.
SYNOPSIS : Un presqu’accident dans le parc de stationnement d’un magasin de bricolage transforme deux inconnus en ennemis et les mène à une escalade d’actes de vengeance. En parallèle, Amy et Danny découvrent l’identité et la famille de l’autre et s’impliquent de plus en plus dans la vie de chacun.
Par Marjolaine Jarry, Télérama, Publié le 09 avril 2023 à 18h00
Sur un parking de supermarché, au volant de son pick-up fatigué, Danny recule sans prendre garde. Un SUV d’un blanc éblouissant le klaxonne longuement, sur le ton de l’exaspération chargée de mépris. Danny rétorque. La vitre du SUV s’abaisse pour laisser apparaître un très affirmé doigt d’honneur. Le sang de Danny ne fait qu’un tour : le voilà lancé sur les avenues de Los Angeles, pourchassant le rutilant véhicule, dont le conducteur se dissimule derrière ses vitres fumées, jusque sur les pelouses d’une banlieue cossue, plus lynchienne tu meurs…
Le crash est évité (à un cheveu près), mais la guerre de Troie aura bien lieu : cet affrontement originel n’est que le premier d’une longue série, le déclencheur d’une picaresque vendetta entre Danny et son adversaire – qui s’avère être une conductrice et non un conducteur : la très minimaliste chic Amy, à la tête d’une florissante start-up de plantes vertes.
Un accrochage et c’est la sortie de route. Fous de colère, ces nouveaux meilleurs ennemis (le fébrile Steven Yeun et l’aiguisée Ali Wong) enchaînent uppercut du droit et revers du gauche, élaborent les stratagèmes les plus vicieux comme les revanches les plus potaches et mettent en pièces, au passage, la prétendue impassibilité asiatique. Créée par le scénariste-réalisateur Lee Sung-jin, né en Corée du Sud, et portée par la déjà culte société A24 (à l’origine du vibrionnant Everything Everywhere All at Once qui a raflé la moitié des Oscars cette année), Acharnés (Beef, en VO) cogne avec entrain. Entre lutte des classes – Danny patauge dans la galère, Amy dort dans la soie – et escalade cartoonesque, c’est à qui viendra déposer la plus grosse bombe sur le paillasson de l’autre.
Si les échafaudages ubuesques du scénario amusent par leur virtuosité (dont l’effervescence a pour contrepartie l’abandon un peu trop rapide de certaines pistes), on ne voit pas tout de suite venir le vrai choc que contient la série. Celui qui nous laisse K.-O. debout au fil du récit poignant de deux ultra modernes solitudes qui ont failli se percuter sur la route et le font, in fine, dans la vie. Danny se démène, avec sa brinquebalante entreprise de construction, dans l’espoir d’offrir une vie meilleure à ses parents rentrés en Corée après la perte de leur motel, et avec, sous son aile, un frère cadet dont il a bien du mal à se séparer. Amy se consume au travail pour amasser une richesse qui l’oppresse et entretenir son mari artiste qui lui conseille, alors qu’elle est en burn-out dès le petit déj, de se pencher un peu plus souvent sur son cahier de gratitude…
Dans ce monde libéral sans pitié, le duo de belligérants a la rage en partage et quelques autres points communs, dont celui de connaître le poids de la réussite qui incombe aux enfants d’immigrés. Mais aussi, ce mauvais esprit qui leur fait vomir les maximes de développement personnel et leur donne envie d’écrire des insanités dans leur cahier de gratitude… Si ces deux-là ne peuvent arrêter de se chercher, c’est qu’ils adorent se détester et espèrent tant trouver quelqu’un qui leur ressemble.
« Tout ça, c’est à cause de lui ? » questionne, effaré, l’époux d’Amy au sujet de Danny, à l’un des points culminants d’une crise en forme de chaîne himalayenne. « Pas lui en soi… », tente d’expliquer Amy, soudain consciente de la puissance des forces souterraines qui l’animent. Quelle est la source de cette fureur qui emporte tout sur son passage ? Peut-on déjouer son enfance et les assignations familiales pour vivre sa vie ? Qui peut vraiment prétendre être au volant de son existence ? Freud aurait souri de cette version à quatre roues du « ça »-cheval qui embarque au galop le « moi »-cavalier. « La psychanalyse ne marche pas sur les esprits asiatiques », affirme Danny pour enfoncer le clou, dans un ultime épisode – dont le titre, Imaginer la lumière, est inspiré d’une citation de… Jung.
Pour rester sur le terrain de l’interprétation, on ne résiste pas à se pencher sur le percutant titre originel, Beef, qui signifie, en argot américain, « conflit ». Si ce dernier est ici servi saignant, cette image de barbaque offre aussi une belle occasion, alors que des flash-back font surgir les images pouponnes de Danny et Amy bébés, de rappeler de quelle chair tendre nous sommes faits. L’émotion emporte la partie, submergeant une série qui a décidément la rage au cœur
Acharnés, série créée par Lee Sung-jin (Beef, États-Unis, 10×30 mn, 2023). Avec Steven Yeun, Ali Wong, Patti Yasutake. Sur Netflix.
T. En adaptant en neuf épisodes le manga d’Aiko Koyama, le réalisateur d’Une affaire de famille livre un récit quasi documentaire sur l’univers des maisons de geishas, à travers l’extraordinaire récit d’apprentissage de deux adolescentes. Fabuleux.
*** MAKANAI, DANS LA CUISINE DES MAKO

NETFLIX. En adaptant en neuf épisodes le manga d’Aiko Koyama, le réalisateur d’Une affaire de famille livre un récit quasi documentaire sur l’univers des maisons de geishas, à travers l’extraordinaire récit d’apprentissage de deux adolescentes. Fabuleux.
En été, le bon peigne est le maki, en hiver, le tsunami. Si on se trompe, eh bien… ça n’est pas grave, mais tout de même : on reconnaîtra bien vite l’apprentie geisha à ce qu’elle choisit le mauvais. C’est ainsi pour les maiko, qui entrent dans leur okiya (maison de geishas) comme on entre au couvent. Et c’est à peu près le plus haut degré de dramaturgie que vous observerez au fil des neuf épisodes de Makanai, dans la cuisine des maiko, qui s’écoulent avec la grâce de l’anecdote. Car dans cette série de Hirokazu Kore-eda (Nobody Knows, Une affaire de famille), il n’y a ni suspense ni dénouement. Rien que la vie à l’encre blanche – celle qui irrigue les films d’Ozu ou un haïku – et deux trois notes de harpe pour transpercer le cœur.Un univers enfantin, bienveillant, imperméable aux bouleversements du monde. Courtesy Netflix
Parler de rien, c’était déjà le projet derrière Seinfeld. Et quand on parle de rien on parle de tout, mais mieux. Il y avait pourtant matière à se perdre dans un de ces récits aux antagonismes banals : deux adolescentes inséparables, l’une, Sumire, précise, ambitieuse, et l’autre, Kiyo, plus vague, plus gauche, chacune plongée dans le grand bain de la compétition, loin de chez elles, dans cette grande maison coincée dans une ruelle de Kyoto. Il n’en est rien, car Kiyo est bien incapable de maîtriser l’art du mai (la danse traditionnelle des geishas) ou l’ikebana. Au départ, on pense la renvoyer chez elle, à Aomori, mais par chance c’est un vrai cordon-bleu et la cuisinière officielle se fait porter pâle.
Alors la gamine reprend le flambeau, elle sera makanai. Rarissime à son âge mais l’essentiel, c’est qu’elle ait trouvé sa voie – il y a quelque chose de platonicien chez Kore-eda, où chacun doit trouver sa place dans l’harmonie du monde. La cuisine est un don, le repas une communion. Dans cet environnement corseté, codifié, chaque plat de Kiyo agit comme un onguent, lorsqu’il y a des tracas, des doutes : tofu soyeux, oyakodon, pain perdu et udon se lovent dans la grande marmite des affects, et révèlent aux âmes les plus bornées leur sympathie cachée.
Un havre pour les femmes

Ainsi, ce huis clos satiné aux allures de petit théâtre d’opérette, trop kawaii,trop enfantin, trop bienveillant, pourrait prêter le flanc à beaucoup de cynisme. C’est en effet un lieu presque hors du temps, poudré, délicat, où tout n’est qu’entraide – la jalousie y étouffe sous les sourires forcés, les chagrins semblent dérisoires. Il y a certes Ryoko, l’ado solitaire, qui surgit au hasard tel un fantôme sardonique et lucide et qui n’en peut plus de tant de niaiserie – on apprendra plus tard les raisons de son amertume. Il y a l’excentrique Yuko, ancienne maiko, qui fuit une vie maritale qui l’ennuie. Ou Momoko, la geisha star revenue de tout, passionnée de films de zombies. Il faut dire que la rectitude de ces vies de maiko ressemble à un chemin tout tracé dont on voudrait se défaire : ont-elles fait le bon choix ? Le temps des regrets viendra-t-il ?Kiyo se retrouve derrière les fourneaux et devient « makanai » : dans la série, la cuisine agit comme un baume sur les corps et les âmes. Courtesy Netflix
Kore-eda (avec la collaboration de trois jeunes réalisateurs japonais) a trouvé dans l’adaptation du roman graphique d’Aiko Koyama la quintessence de son cinéma, où la famille officielle a toujours moins d’importance que celle qu’on choisit. En un temps post- #MeToo, voilà un havre où les femmes peuvent trouver refuge, où la sororité protège et l’art rend souverain. Car, contrairement à un mythe tenace, les geishas ne s’adonnent pas à la prostitution, ce sont des artistes indépendantes, souvent bien plus libres que les femmes mariées.
Sous l’okiya donc, il y a d’un côté les « mères », qui font office de professeures ; de l’autre, des jeunes filles aux yeux constamment brillants. Tout ceci paraîtra peut-être banal, naïf. Pourtant, dans la platitude d’une croûte de pain frite à l’huile, dans le pli souple de ces tissus cintrés, dans ces gestes répétés et immémoriaux, tout, chez Kore-eda, concourt à la beauté du monde. Et c’est bouleversant.
LA DIPLOMATE

T : “La Diplomate”, sur Netflix : une habile série géopolitique dans la lignée d’“À la Maison-Blanche”
En suivant les débuts houleux de la nouvelle ambassadrice américaine à Londres (Keri Russell), la showrunneuse Debora Cahn trouve le parfait équilibre entre tension, rhétorique et comédie.

BACK TO LIFE, SAISON 1 ET 2

La scénariste et comédienne Daisy Haggard, habituée des rôles comiques, nous touche en plein cœur avec cette série drôle et émouvante au sujet d’une femme qui réapprend à vivre après dix-huit ans derrière les barreaux.
our Miranda « Miri » Matteson (Daisy Haggard), l’avenir s’annonce compliqué. Elle sort de prison après avoir purgé dix-huit ans de réclusion. De retour dans sa chambre d’ado chez ses parents Caroline (Geraldine James) et Oscar (Richard Durden), elle doit affronter l’hostilité mâtinée de bêtise crasse de la communauté de Hythe, petite station balnéaire du Kent, où tout se sait et où personne n’a oublié le motif qui a conduit à sa condamnation, le meurtre de l’une de ses copines, pourtant survenu dans des circonstances obscures. Et surtout, elle doit tout (ré)apprendre pour se construire une nouvelle vie. Rien ne sera facile pour Miri, constamment rappelée à son passé et réduite à son statut d’ex-détenue.
EMMA, MINI-SERIE BBC

ARTE. T : Emma, l’entremetteuse imaginée par Jane Austen, révèle toutes ses nuances dans cette belle adaptation produite par la BBC à la fin des années 2000. Un raffinement exquis et un verbe piquant.
Dans le petit bourg de Highbury, dans le Surrey, les rencontres et les romances ne doivent rien au hasard. Emma, jolie jeune femme de la haute société, ne cesse d’y perfectionner ses talents d’entremetteuse, orchestrant dans l’ombre d’improbables rapprochements entre ses voisins et amis. Une tyrannie du mariage à laquelle Emma compte bien échapper : rien ni personne, s’imagine-t-elle, ne pourrait l’éloigner de son père adoré, le soucieux M. Woodhouse.
Entre la BBC et Jane Austen, c’est une passion qui résiste au temps, comme le rappelle cette énième adaptation, réalisée en 2009. Quatre épisodes d’une heure permettent d’affiner chaque personnage, de nuancer le portrait d’Emma, d’abord perçue comme une grande enfant qui « manipule les êtres comme des poupées »… Sous l’art maîtrisé — et vachard — de la conversation et les tourments sentimentaux, l’adaptation de Sandy Welch restitue la mélancolie, souvent oubliée, du roman d’apprentissage, en composant une délicate chronique de la perte et de la séparation. Des paysages bucoliques aux costumes d’un raffinement exquis, Emma distille un charme assez irrésistible, sans oublier d’être piquante.
THE LAST SOCIALIST ARTEFACT

ARTE. T : Une petite ville croate désertée depuis la guerre des Balkans reprend vie après la réouverture de l’usine locale. Un drame intimiste et subtil
THE RESORT

CANAL. En vacances au Mexique pour fêter leurs dix ans de mariage, Emma et Noah trouvent un vieux téléphone qui les précipite dans une aventure rocambolesque. Une comédie fantastique et mélancolique sur la quête du premier regard, parfaite série de l’été
THE ENGLISH

Célébré pour ses thrillers politiques, l’Anglais Hugo Blick s’attaque au plus américain des genres, le western. Et le dynamite, en mettant au premier plan une femme et un Amérindien. Le scénariste explique la genèse de cette série baroque et hallucinée.
Un western ? Ce n’est pas là qu’on attendait Hugo Blick. Depuis le sombre polar The Shadow Line en 2011, cet auteur britannique s’était plutôt distingué dans le drama contemporain à regarder sourcils froncés. Dans la série d’espionnage The Honourable Woman (2014), il sondait les répercussions en Grande-Bretagne du conflit israélo-palestinien. Dans le thriller géopolitique Black Earth Rising (2018), il se penchait sur les cicatrices du génocide rwandais. The English, sa nouvelle minisérie, fait un pas de côté. Loin de la Tamise, du XXe siècle et du réalisme de ses œuvres précédentes, elle nous propulse dans un Far West fantasmé, où le scénariste de 58 ans, également réalisateur de toutes ses séries, s’amuse à déconstruire le genre.
Sous des ciels immenses à la John Ford, il donne le beau rôle à une femme, Cornelia Locke (l’intrépide Emily Blunt), lady anglaise en quête de vengeance, et à un Amérindien, Eli Whipp (Chaske Spencer, une révélation), vétéran de l’armée américaine qui veut rejoindre le Wyoming pour y réclamer un lopin de terre. Deux outsiders hantés par leurs morts, qui vont s’aider et s’aimer. Déplaçant le centre de gravité du cow-boy à l’Indien, des dominants aux dominés, The English peut rappeler la démarche d’autres néowesterns récents, comme La Dernière Piste (2010) ou The Power of the Dog (2021).
HELLO, TOMORROW

Dans une Amérique des années 1950 fantasmée où circulent robots et voitures volantes, un VRP et ses collègues tentent péniblement de fourguer des maisons sur la Lune. Le portrait mélancolique d’une équipe de losers courant désespérément après le succès
THE LAST OF US

Craig Mazin (Chernobyl) et Neil Druckmann, créateur du jeu culte, l’adaptent dans un road-trip post-apocalyptique diffusé dès ce lundi. Après deux épisodes timides, la série déjoue nos attentes et nous emporte grâce à deux personnages attachants.
FUNNY WOMAN

OCS. La comédie comme remède à tout ? Une conviction qui conduira la talentueuse Miss Blackpool au firmament de la comédie britannique. Adaptation réjouissante du Funny Girl de Nick Hornby, la série a reçu le Prix des étudiants au dernier festival Séries Mania
BOSH, LEGACY

“Bosch : Legacy” (Prime Video)
Après sept saisons et soixante-huit épisodes, le détective Harry Bosch (Titus Welliver) a pris sa retraite de la police de Los Angeles. Pas des séries. Cette suite de Bosch renoue avec le flic mélomane, désormais détective privé. Pour le reste, on retrouve une partie des personnages, une Californie à deux visages, entre luxe et misère, et tout ce qui faisait le charme de cette adaptation des romans de Michael Connelly par Eric Overmyer (The Wire, Treme) : une intrigue aux multiples ramifications, un casting impeccable, une attachante mélancolie et un sens du récit qui a tendance à se perdre dans les séries modernes. Un polar old school au meilleur sens du terme. P.L. Télérama TTT/ PRIME VIDEO
AS WE SEE IT

PRIME VIDEO
Le quotidien d’un trio de jeunes autistes, entre apprentissage et galères de boulot et de cœur. Avec ses acteurs eux-mêmes neuroatypiques et son écriture vive, cette adaptation de l’israélienne “On the Spectrum” convainc.
Rick Glassman, Sue Ann Pien, Albert Rutecki dans « As we see it ». Photo Ali Goldstein / Amazon Studios
Par Marjolaine Jarry (TELERAMA)
Trois copains sur un canapé : l’affiche de la série américaine As We See It appartient à cette catégorie d’images allégoriques qui désignent immédiatement la série de potes. De celles qui donnent envie de caler un bout de fesse sur le sofa et de passer un bout de vie avec eux, à l’abri de l’amitié. Ces trois-là ont une particularité (parmi bien d’autres) : ils sont autistes et partagent un appartement thérapeutique. Dans le sillage de la brillante série israélienne On the Spectrum, grand prix du festival Séries Mania en 2018, dont elle est adaptée, As We See It donne résolument le premier rôle à ces trois jeunes adultes, sans pathos ni héroïsation. On est loin de l’imagerie Rain Man avec cette chronique du quotidien, dont nous avons pu voir les quatre premiers épisodes. Au fil des jours, la série s’attache à développer des enjeux ordinaires – se dégoter un boulot ou un amoureux, trouver un programme télé qui fasse l’unanimité pour la soirée – et évoque avec délicatesse les liens en construction du trio.
Il y a Jack (Rick Glassman) et ses démêlés au travail, où son efficacité n’a d’égal que cet irrépressible besoin d’authenticité qui lui impose de partager avec son chef le constat de l’« intelligence basse » de ce dernier ; Harrison (Albert Rutecki), son hypersensibilité au bruit, sa phobie du monde extérieur ; et Violet (Sue Ann Pien), son désir revendiqué de connaître les joies du sexe avec un type « normal » rencontré sur une application ad hoc, sa déception inconsolable quand ses collègues ne viennent pas à son anniversaire… Sans escamoter la souffrance, l’intensité des crises d’angoisse ni le désespoir qui submerge, le scénariste Jason Katims (ancien pilier de l’écriture de Friday Night Lights) brosse, par petites touches vives et mobiles, le portrait d’individus à part entière, irréductibles à un diagnostic.
La créatrice israélienne Dana Idisis avait écrit On the Spectrum en pensant à son frère autiste ; Jason Katims, lui, a un fils atteint du même trouble. Pour incarner les trois héros de As We See It, il a fait le choix – qui n’était pas celui de la version israélienne – de confier les rôles à des personnes elles-mêmes neuroatypiques. Rick Glassman, Sue Ann Pien et Albert Rutecki (les deux premiers sont comédiens, le troisième a fait ses premiers pas sur un plateau avec la série) ont en commun la connaissance intime de la différence autistique et la volonté d’incarner à l’écran « des êtres singuliers, analyse Albert Rutecki dans les colonnes de The Independent, qu’on ne peut pas assimiler les uns aux autres sous prétexte qu’ils auraient un dénominateur commun ».
THE BOYS

des super “super-héros”
Dans un monde où les super-héros sont partout, une équipe spéciale de la CIA surveille les activités illégales et déviantes de certains d’entre eux. On les appelle les Boys et la diplomatie n’est pas leur truc. Vous en avez marre des super-héros? Eux aussi! Sens critique
Irrévérencieux, noir et intelligent : the boys.
A force de sauver l’humanité, les superhéros ont pris la grosse tête. Pire, ils travaillent pour une toute-puissante industrie, qui monnaye grassement leurs services, de Hollywood au Pentagone, exploitant leur image pour protéger au prix fort les rues d’Amérique, et vendre films, pubs et autres produits dérivés. Adaptée d’un comic de Garth Ennis (Preacher) et Darick Robertson, The Boys, disponible depuis juillet sur Amazon Prime Video, met en scène le face-à-face entre ces Avengers sociopathiques, corrompus, violents et harceleurs, et une équipe de mercenaires brutaux, bien décidés à révéler au public la superarnaque. Une satire explosive du genre cinématographique dominant, bijou pop sanglant qui décapite les Etats-Unis de Trump.
Deux personnages nous aident à rentrer dans l’univers faussement familier de The Boys. Hughie Campbell (Jack Quaid, fils de Dennis Quaid et Meg Ryan) est un jeune New-Yorkais sans histoire, fan (comme tout le monde) des « Sept », les plus populaires et les plus puissants des superhéros américains. Quand sa petite amie se fait pulvériser, plus ou moins par inadvertance, par l’un d’entre eux, il rejoint « The Boys », un groupe de hors-la-loi qui rêve de mettre à terre l’industrie superhéroïque, mené par Billy Butcher (Karl Urban), un agent spécial franc-tireur britannique. On découvre le monde des superhéros de l’intérieur grâce à Annie January, alias Starlight (Erin Moriarty), la nouvelle recrue idéaliste des Sept… qui va réaliser que son rêve de gamine n’est qu’une façade, et que sous les beaux costumes et les sourires Ultra Brite se cache un système infecte.
N’en disons pas plus, pour ne pas gâcher les nombreuses surprises des premiers épisodes (certaines sidérantes), qui viennent dynamiter un récit a priori classique. Ce n’est en effet pas la première fois qu’une série se passe dans un monde où les surhommes et les « surfemmes » (encore un terme qui manque à la langue française) se baladent dans les rues à visages découverts – on pense notamment à l’inégale Powers. Le coup de maître de The Boys, c’est de construire un décor familier, de faire des Sept des copies de célèbres héros (un pseudo Superman, Homelander, dirige une équipe composée de pseudo-Wonder Woman, Flash, Aquaman, etc.) pour mieux exploser les codes. Ces sauveurs sont en fait des sociopathes en puissance, des cas psychiatriques d’autant plus dangereux qu’ils sont quasi invincibles.
La série oscille, avec une énergie renversante, entre jeu de massacre jubilatoire, parfois gore jusqu’au grotesque – âmes sensibles, s’abstenir – et satire sociétale et politique. Les Sept sont un « boys club » où le droit de cuissage est pratiqué et les (rares) superhéroïnes sans cesse harcelées par des hommes complètement immatures, qui pensent que leurs petits fantasmes sont des ordres ou des réalités (l’homme invisible passe sa journée dans les toilettes des femmes…).Télérama, Pierre Langlais
HOMECOMING

La nouvelle série du créateur de “Mr Robot” pour Amazon Prime Video est tellement prenante qu’elle se regarde d’une traite. Julia Roberts y campe une psychologue qui, quatre ans après avoir travaillé dans un camp de réinsertion pour militaires, ne se souvient plus de rien. Suspense…
Par Pierre Langlais (télerama)
La psychologue Heidi Bergman (Julia Roberts) est en charge des patients de Homecoming, un centre de réinsertion pour militaires fraîchement ouvert par une entreprise privée « pour essayer quelque chose de nouveau ». Dans son bureau aux airs de lounge, elle reçoit de jeunes soldats américains tout juste revenus du Moyen-Orient, et obéit aux ordres d’un patron absent (Bobby Cannavale). Quatre ans plus tard, elle est devenue serveuse et ne se souvient de rien. L’expérience a-t-elle mal tournée ? Un agent du gouvernement mène l’enquête… Homecoming, la nouvelle série du créateur de Mr Robot, Sam Esmail, est l’adaptation d’un podcast éponyme diffusé l’an passé, « une pièce radiophonique où la tension dépend de la psychologie des personnages, pas de l’action », explique le réalisateur. « Cela m’a rappelé ces moments où, enfant, on écoute quelqu’un nous lire une histoire, et l’on imagine ce à quoi elle ressemblerait si nous en étions le héros », s’enthousiasme Julia Roberts. https://www.youtube.com/embed/SIpOgEVvDI4
Homecoming est une étrange série, hyper stylisée. Un drame court aux épisodes d’à peine trente minutes, au récit déstructuré (avec des sauts incessants dans le temps) et à la mise en scène expérimentale, où Sam Esmail multiplie les plans-séquences et les cadrages inattendus — par exemple, dans les scènes situées « quatre ans plus tard », la taille de l’écran est réduite de moitié. « Cette coupe métaphorique symbolise l’enfermement d’Heidi dans une vision réductrice d’elle-même et le fait qu’elle ne perçoive plus les contours de sa propre existence », analyse-t-il. Une modernité visuelle soulignée par un impressionnant travail sonore, compilation de bruitages troublants, basses et vibrations oppressantes, « parce que le son est encore plus important que l’image pour s’immiscer dans la tête des spectateurs et créer un sentiment inconfortable », poursuit-il.
Huis clos psychologique, Homecoming joue, comme Mr Robot, sur les limites de la perception et les effets des psychotropes — on inflige aux soldats du centre un mystérieux traitement. Il rappelle aussi Oz et sa prison, le village du Prisonnier et les sessions d’En Analyse. Mais cette série riche en références s’inspire surtout des thrillers d’Hitchcock, De Palma ou Pakula, à qui Sam Esmail rend hommage dans sa BO, intégralement constituée d’airs de Pino Donaggia, Michael Small, et autres compositeurs qui ont accompagné la carrières de ces maîtres du suspense. Il pousse même le vice à choisir un extrait de la musique de Carrie pour l’apparition de la mère d’Heidi, interprétée par Sissy Spacek ! Rythmée, ludique, Homecoming semble avoir été conçue pour être « bingée », consommée d’une traite. Elle se regarde comme un jeu de piste paranoïaque, une énigme aussi confuse que son héroïne, « une femme qui ne sait jamais trop où elle en est et dont on ne peut lire les pensées », résume Julia Roberts.
LES GENIALES
EXTRAORDINARY ATTORNEY WOO
Magnifique série. On attend avec impatience la suite en 2024

WIKI: synopsis : La série raconte l’histoire de Woo Young-woo (Park Eun-bin), une avocate autiste, sur le spectre des troubles du spectre autistique (TSA), qui travaille dans un grand cabinet d’avocats. De plus, elle a un QI de 164, une mémoire exceptionnelle et une façon de penser créative. Cependant elle a une faible capacité de gestion de ses émotions et des compétences sociales classiques limités, mais son sens de l’observation lui permet de compenser et de comprendre ses clients3.
Les affaires judiciaires de la série soulèvent parfois des problèmes éthiques difficiles à résoudre. Woo Young-woo se distingue souvent par une approche unique de la question qui impressionne ses pairs.
Un autre thème récurrent est la passion de Woo Young-woo pour les baleines, et les cétacés de manière générale. Cette passion génère souvent de l’incompréhension, voire de l’agacement dans son entourage. Elle parvient régulièrement à résoudre des problèmes de sa vie privée et sa vie professionnelle grâce à des analogies avec le comportement des mammifères marins, lors de moments d’illumination.
extrait de “sens critique“
C’est la révélation de l’année. Extraordinary Attorney Woo est solaire. Park Eun-bin vue récemment dans The king’s affection, drama historique pour laquelle elle raflait de nombreux prix pour son interprétation d’une jeune femme devant se faire passer pour un prince héritier. Un personnage élégant et racé mais froid. Dans Extraordinary Attorney Woo c’est une révélation tant elle incarne l’extraordinaire avocate Woo. Elle qui dans un premier temps avait refusé le rôle à cause de la difficultés et des risques lié à ce type d’interprétation, crée ici un personnage iconique. Si la série, agréable et bien réalisée et dispose du savoir faire coréen en la matière, c’est avant tout les scènes avec Park Eu Bin que l’on veut voir et revoir. Pourquoi ? Parce qu’elle illumine l’écran. Parce qu’elle dégage un charisme et un charme étonnant. Parce que elle apporte une énergie incroyable et une féminité émouvante. Une douceur cachée sous une détermination fébrile. Un jeu d’acteur fait de moments silencieux à des monologues rapides et hachés et passionnés. Tout est d’une subtilité millimétrée que ce soit dans ses gestes, dans sa démarche chahutée mais élégante,ou dans ses attachantes hésitations. Park Eun-bin fait de l’avocate Woo un être magique, touchant. Une personne qu’on aimerait connaitre tant elle exhale de belles choses.
De plus, la série apporte une vision intéressante. “Le syndrome d’Asperger est souvent utilisé comme un ressort narratif, dans des séries policières ou médicales, pour brosser des personnages socialement inadaptés mais brillants, qui vont avoir un rôle majeur dans la résolution d’enquêtes par exemple. Il est aussi utilisé comme un ressort dans les comédies, où l’intelligence hors norme du personnage contraste violemment avec son inadaptabilité sociale et donnant lieu à des situations ou à des dialogues comiques”. L’autiste apparait souvent comme un personnage candide, un Fish out of water, qui par opposition fait ressortir nature humaine. De nombreux films et séries ont donc utilisé ce type de personnage avec un trait parfois forcé. Cependant, notre société évolue globalement et favorablement vers la reconnaissance des différences et des minorités. Un contexte qui permet une création plus réaliste et moins caricaturales à l’instar de dramas récents comme It’s oK not to be ok et Move to heaven. Extraordinary attorney Woo amène un traitement frais, léger et bienveillant qui connait à juste titre un énorme succès avec des gimmicks déja repris par les stars coréennes dont le salut entre Woo young Woo et sa meilleure amie. Iconique sans aucun doute. Suite prévue en 2024. A voir sans modération.
BETTER CALL SAUL
LA MEILLEURE SÉRIE DE TOUS LES TEMPS ?

Certains, dont moi, ont pu considérer que cette série est la meilleure de tous les temps. Spin off (dérivée) de “Breaking bad”
Synopsis wiki.
James McGill (Bob Odenkirk), dit « Jimmy », est un ancien escroc devenu avocat sous l’influence de son frère Charles McGill (Michael McKean), dit « Chuck », lui-même avocat renommé et partenaire cofondateur du cabinet Hamlin, Hamlin et McGill (HHM). Au sein de HHM travaille Kim Wexler (Rhea Seehorn), compagne de Jimmy qu’il a rencontrée du temps où il travaillait au service du courrier.
Face aux difficultés qu’il a à faire décoller sa carrière en tant qu’avocat, Jimmy se résout à recourir à des méthodes proches de celles utilisées lors de son passé répréhensible, notamment celles qui lui avaient valu le surnom de « Casse-gueule Jimmy » (Slippin’ Jimmy). Ses manigances, dans lesquelles il entraîne Kim de plus en plus au fil de la série, exacerberont son conflit personnel avec Chuck et monteront jusqu’à un point de non-retour. Elles le mèneront aussi à s’associer au milieu criminel, et notamment celui du trafic de drogue, impliquant en particulier d’autres personnages présents ou mentionnés dans la série Breaking Bad : Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), Nacho Varga (Michael Mando), Gus Fring (Giancarlo Esposito) et Lalo Salamanca (Tony Dalton).
Au cours de la série, Jimmy endosse le pseudonyme « Saul Goodman », jeu de mots anglophone (ce nom évoque l’expression anglaise It’s all good, man!) auquel il était accoutumé lors de son passé d’escroc. Les évènements évoluent jusqu’à connecter ceux narrés dans Breaking Bad, c’est-à-dire lors de la rencontre de Jimmy avec Walter White et Jesse Pinkman13.
La plupart des épisodes comportent une introduction préfigurant le dénouement final, postérieur à celui de la série Breaking Bad. Cette narration, présentée en noir et blanc, devient prépondérante vers la fin de la série.

EXTRAIT DE TELERAMA
Pourquoi “Better Call Saul” est une série d’anthologie
Le spin-off de “Breaking Bad” a pris fin ce mardi 16 août, sur une sixième saison aussi remarquable que les autres. Retour sur une série exceptionnelle qui, jusqu’à la fin, a su chérir sa différence.
Par Michel Bezbakh, Publié le 16 août 2022 à 18h09
Pendant six saisons, l’histoire de James McGill, alias Saul Goodman, ce drôle d’avocat meilleur en escroquerie qu’en plaidoirie, est restée passionnante de bout en bout. Un petit miracle rendu possible par le talent des scénaristes Vince Gilligan et Peter Gould, qui ont à la fois maintenu le lien avec la série d’origine Breaking Bad, tout en multipliant les ruptures quand cela était nécessaire. On en est devenu accro.
À lire aussi :
“Better Call Saul”, sur Netflix : une passionnante fin de saison 6 en clair-obscur
Des personnages à l’intérieur des personnages
L’idée principale de Breaking Bad reposait sur une revanche : un prof de chimie sans histoire et vieillissant, vaguement méprisé par les seules personnes qui pourraient éventuellement l’admirer (ses élèves), finit par endosser le rôle d’un baron de la drogue sanguinaire, craint et respecté par les pires mafieux du coin. Walter White (Bryan Cranston) s’est réinventé en se créant un personnage. Dans Better Call Saul, on apprend que son avocat, James McGill (Bob Odenkirk), a un peu voulu faire la même chose.
Le drame, c’est qu’il en a tout un éventail. Jimmy la glisse : l’escroc. Jimmy McGill : l’employé de bureau. Saul Goodman : l’avocat. Gene Takavic : le pâtissier. Et que toutes ces personnalités entrent parfois en collision ! À la fin de la saison 6, Gene Takavic, redevenu Jimmy la glisse, s’appuie ainsi sur ce qu’éprouve James (en bout de course, sans famille ni amis) pour tromper un policier et réussir son escroquerie. Quand on arrive à un tel niveau de schizophrénie, ça sent le roussi.
La mise en scène… mise en abyme
Si Jimmy est capable de passer d’une personnalité à l’autre, c’est parce qu’il est… metteur en scène. Il faut le voir dans la peau de Jimmy la glisse, ce roi de l’arnaque qui montait de véritables pièces de théâtre, avec son acolyte Marco, pour escroquer des inconnus. Un goût pour les coups montés qui, hélas pour lui, ne va jamais le quitter. On touche peut-être à l’aspect le plus passionnant de la série : observer comment la mise en scène des auteurs rejoint celle des personnages. Vince Gilligan est un scénariste hors pair, mais il se demande aussi en permanence quelle est la meilleure façon de montrer ses histoires. Ce que Michael Slovis, le chef opérateur principal de Breaking Bad, résume ainsi : « On raconte en posant des questions. » (1) Better Call Saul s’inscrit dans cette tradition. Chaque plan est sublime, et pose une question. Jusqu’aux gestes les plus banals, scrutés avec une telle attention que l’on se dit qu’ils doivent cacher un truc. C’est un monde où il est passionnant de regarder quelqu’un passer l’aspirateur ou se faire un café.Bob Odenkirk dans la saison 3 de « Better Call Saul ». Netflix
Saul, “a good man”?
Jimmy quittant son rôle de Jimmy la glisse ? « C’est comme si Miles Davis abandonnait la trompette », s’indigne son vieux pote Marco, qu’il abandonne à Chicago pour tenter sa chance au Nouveau-Mexique dans le droit. Dans le droit ! À voir sa façon de défendre une bande d’étudiants coupables d’avoir violé un cadavre (saison 1, épisode 1), on se dit que Miles Davis doit reprendre sa trompette de toute urgence. Jimmy est un escroc, un arnaqueur, c’est sa vocation, il est fait pour ça. Mais il veut être bon. Un mec bien. Il veut devenir a good man, quitte à ne plus être lui-même. L’inverse de Walter White.Image extraite de la saison 1. Netflix
La valse des sentiments
Si Jimmy veut être avocat, c’est pour obtenir de son frère, à défaut d’amour, au moins un peu de respect. Chuck est une sommité, l’un des plus grands attorneys des États-Unis. Mais en obtenant son diplôme par correspondance à l’université des Samoa, Jimmy n’a récolté qu’un peu de mépris supplémentaire. C’est le premier coup de boutoir qui lui fait quitter le droit chemin. Le second, mais il ne faut pas trop en dire, viendra de Kim, sa femme. En fait, Jimmy est un sentimental. Et c’est une autre différence essentielle avec Breaking Bad. Alors qu’au fil de la série, on a de moins en moins de compassion pour Walter White, on en éprouve de plus en plus pour ce bon vieux Jimmy.
Des introductions en guise de conclusions
Comment ne pas ressentir un peu de tendresse pour cet homme que l’on a retrouvé, au tout début, dans la peau de Gene Takavic, gérant moustachu de la pâtisserie d’un centre commercial du Nebraska ? Car les premières minutes de cette série censée se dérouler avant Breaking Bad montrent Saul Goodman… après Breaking Bad. Ces petits clips de cinq minutes, en noir et blanc, serviront d’introduction aux cinq premières saisons de Better Call Saul. Et de conclusion à la sixième : les quatre derniers épisodes se déroulent après Breaking Bad, sous la neige du Nebraska. Sans spoiler, on peut dire que c’est une façon pour Vince Gilligan et Peter Gould de sceller l’histoire entre Jimmy et Kim (Rhea Seehorn), un personnage qui n’apparaissait pas dans Breaking Bad. Et de rendre ainsi les deux séries quasiment indépendantes.Saison 6
Le western au bureau
Better Call Saul est donc d’une tout autre couleur que Breaking Bad, placé sous influence du western et de Sergio Leone. Visuellement, les épisodes de la dernière saison sont même très sombres ; certains se déroulent entièrement de nuit. On n’est plus tout à fait sous le soleil d’Il était une fois dans l’ouest, ni sur une terre vierge et sauvage où la seule loi est celle du pistolet chargé. Plusieurs saisons de Better Call Saul abordent des questions ardues de droit bien étrangères à Breaking Bad. Mais si le bois massif des salles de réunion a remplacé la poussière du désert, on se demande si Jimmy, avec ses costumes trop larges, sa voiture rouillée, son accent du Midwest, ses répliques qui claquent comme des coups de revolver, ne doit pas être pris pour un cow-boy égaré dans un monde qui n’est pas le sien.
(1) À lire dans l’anthologie Breaking Bad éditée par So Film et Capricci.
FRIDAY NIGHT LIGHTS
EXCELLENTE SERIE. LE FOOTBALL AMERICAIN (AU DEMEURANT PAS ININTERESSANT), QUI N’EST PAS LE FOOTBALL, NE DEVRAIT PAS EMPECHER L’EUROPEEN DE REGARDER. LA VIE TEXANE ET CELLE DES ADOS EST REMARQUABLEMENT DONNÉE


Synopsis wiki.
Dans la petite ville (fictive) de Dillon au Texas, une nuit compte dans la vie de ses habitants, celle du vendredi, soir de match pour les équipes de football américain du lycée… Eric Taylor, nouvel entraîneur de l’équipe de football américain du lycée de Dillon, doit gérer la pression que tout le monde met sur lui ; et tout cela pour un seul et unique but : que son équipe, les Panthers, soit la meilleure du championnat.
EXTRAIT TELERAMA. Le plus récent de ces classiques (2006-2011) est aussi le plus sous-estimé de notre côté de l’Atlantique. Le quotidien d’un bled du Texas passionné par l’équipe de football américain de son lycée semble, il est vrai, un sujet très, très, très américain. Mais FNL est bien plus que ça, une chronique bouleversante et inspirante, une série ado à part et un regard original sur une Amérique très pieuse qu’on serait tenté de caricaturer. Ajoutez à cela une mise en scène hypersensible, une sublime BO post-rock et un casting à tomber, et c’est le touchdown assuré. – P.L.
UNE BELLE CRITIQUE DE LA SERIE ICI PAR CLIC P(AR LE BLEU DU MIROIR)
FOR ALL MANKIND
L’INTELLIGENCE DE CETTE SERIE EST EXCEPTIONNELLE.

For all mankind, 4 saisons, Série sur la conquête de l’espace qui mêle science, suspense et amours, y compris illégitimes. Remarquable, vraiment remarquable. MB.
Par Emilie Gavoille (Télérama) Publié le 14 novembre 2019 à 19h00, Mis à jour le 27 juin 2023 à 15h25
Des salons de l’Amérique profonde aux bars du Texas, jusqu’à la salle de contrôle de la Nasa : derrière leurs téléviseurs, tous l’observent, les yeux écarquillés, cet astre lunaire qui semble désormais à portée de l’humanité. D’un moment à l’autre, c’est sûr, la bannière étoilée flottera au-dessus de la mer de la Tranquillité. Sur les petits écrans, une silhouette en combinaison blanche apparaît, et prend la parole… en russe. Patatras ! Les Américains se sont fait damer le pion par les Soviétiques, premiers à poser le pied sur la Lune !
Telle est l’idée de départ, très futée, de la nouvelle série de Ronald D. Moore (Star Trek, Battlestar Galactica) pour Apple TV+, la plateforme de streaming récemment lancée par la firme à la pomme. Une uchronie spatiale et sixties, qui réinvente le cours de l’histoire de la course aux étoiles en subvertissant intelligemment la réalité, truffée d’apports fictionnels souvent très vraisemblables. Ed Baldwin, l’astronaute de la Nasa que l’on rencontre dès le premier épisode ? Il n’existe pas. En revanche, ce qui va lui arriver… Deke Slayton (interprété par Chris Bauer, souvent vu chez David Simon) ? À l’image de Wernher von Braun, le père des fusées Saturn V, ou encore de John Glenn, premier Américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre, lui a réellement existé. En revanche, ce qui va lui arriver…
Car dès la fin du deuxième épisode, For All Mankind enfonce définitivement le clou de l’uchronie en introduisant dans le récit un élément détonateur (que nous tairons ici pour ménager le suspense) qui nous emmène résolument du côté d’une savoureuse fiction féministe, en immersion dans les coulisses de la Nasa. Si le casting n’affiche pas de visages très connus, la production s’avère rutilante à d’autres égards. En premier lieu du point de vue du rendu visuel, éclatant, précis, presque trop beau pour être vrai (les images de la Lune sont par exemple bizarrement immaculées). Mais aussi du côté de la musique : des Stones à Janis Joplin, beaucoup de stars de l’époque s’incrustent au fil des épisodes. Un peu comme dans Mad Men, référence évidente de la série.
For All Mankind, sur Apple TV+.
YOUNG SHELDON

Young Sheldon, une série dérivée, un spin off, pour faire chic de la série “BIG BAND THEORY“ dans lequel Sheldon est d’une extravagance désopilante.
MAY IT PLEASE THE COURT

“May it please the court“, série coréenne, policière et amoureuse. Les acteurs sont magnifiques et l’intrigue et la mise en scène remarquables.
FIN DE SERIES, L’EMISSION ET LES PODCASTS DE FRANCE INTER
CETTE EMISSION S’EST TERMINEE,, EN 07/2019
CLIC SUR L’IMAGE ACCEDER

SERIES MANIAQUES
LES CLASSEMENTS
LES 50 MEILLEURES SERIES DE TOUS LES TEMPS, SELON TELERAMA
LES 5 MEILLEURES SERIES DES 25 DERNIERES ANNEES, SELON “PRESSE-CITRON”
LES 25 MEILLEURES SERIES DES 25 DERNIERES ANNEES, SELON “GQ MAGAZINE”
https://www.gqmagazine.fr/article/les-25-meilleures-series-des-25-dernieres-annees
LES 20 MEILLEURES SERIES DE LA DECENNIE, SELON “LES ECHOS”
https://www.lesechos.fr/weekend/cinema-series/les-20-meilleures-series-de-la-decennie-1213401
LES 100 MEILLEURES SERIES DU 21ème SIECE SELON “RADIO FRANCE”
LES MEILLEURES SERIES DE TOUS LES TEMPS, SELON “CNET”
LES 10 MEILLEURES SERIES NETFLIX, SELON “LES NUMERIQUES”
LES MYTHIQUES
*** BREAKING BAD (2008)

UN PODCAST FRANCE INTER : Retour sur la création de la série Breaking bad, l’écriture des personnages de Vince Gilligan, le casting phénoménal de cette série portée par Bryan Cranston et Aaron Paul… En quoi cette corruption filmée a-t-elle su séduire le public ? En gros, pourquoi Breaking Bad est un chef d’œuvre?

UN ARTICLE (KONBINI)
Quand Vince Gilligan pitche sa série à Bryan Cranston, l’acteur qu’il souhaite recruter dans le rôle de Walter White, il lui dit “C’est Mr. Chips qui rencontre Scarface” (en référence au film Au revoir Mr. Chips, 1939).
Scénariste pour la télévision depuis les années 1990, l’homme a une idée en tête. Il veut démonter le modèle du protagoniste principal qui n’évolue pas, et surtout pas en mal. Il arrive au bon moment : depuis Les Soprano, la figure de l’antihéros en pleine crise existentielle a la cote. Mais personne n’a encore pensé à créer une série où le héros devient un vrai bad guy, du genre qui fait froid dans le dos.
Le deuxième parti pris audacieux et malin, c’est d’imaginer que le héros a un cancer du poumon en phase terminale. Un peu comme pour Titanic, les chances que la série finisse bien sont minces. L’ambiance, posée en saison 1, est de toute façon sombre, très sombre. L’humour est noir, ou jaune. Walter White, ce timide prof de chimie qui se lance dans la préparation de meth bleue quasi pure (99,1 %) pour laisser assez d’argent à sa famille quand il mourra, va faire équipe avec Jesse Pinkman (Aaron Paul). Dès le deuxième épisode, ils se retrouvent à devoir faire disparaître un corps à l’acide hydrofluorique.
Cinéma + série ⇢ Breaking Bad²
Les séries ont toujours eu ce complexe d’infériorité par rapport au cinéma. Créées pour accompagner des espaces de publicité, elles se sont peu à peu affranchies de leur utilité première pour devenir des objets d’art à part entière. Vince Gilligan connaît bien le milieu télé et les codes de narration de la série : il a œuvré comme scénariste pour X-Files pendant sept ans. Lui qui souhaitait travailler dans le cinéma à ses débuts va pouvoir fusionner les formats série et ciné avec Breaking Bad, sans trahir l’esprit de l’un ou de l’autre.
Le point de départ de Breaking Bad est certes intrigant, mais le pitch tient dans un mouchoir de poche. Toute la réussite du show dépend de son exécution : en bon scénariste de série, Vince Gilligan a appris à coller aux basques de ses personnages, à commencer par celles de Walter White, l’homme qui va mal tourner. Pour interpréter ce prof random, père de famille aimant qui va se laisser griser par le pouvoir et l’argent, il fallait toute l’humanité d’un Bryan Cranston, acteur qui avait tapé dans l’œil de Vince Gilligan depuis un épisode de X-Files.
Sa transformation au fil des cinq saisons, autant physique que psychologique, est aussi précise que stupéfiante. Si Bryan Cranston, que le showrunner a eu du mal à imposer car il sortait d’un rôle très comique (Hal dans Malcolm), tient en grande partie la série sur ses épaules (en témoigne ses quatre Emmys et son Golden Globe du meilleur acteur), il n’est évidemment pas le seul à briller.
Son “partner in crime”, Jesse Pinkman, va permettre à Aaron Paul de devenir une star, doublée d’une icône pop avec ses fameux “Yo, bitch!”. Un sacré exploit sachant que Vince Gilligan prévoyait de tuer le personnage à la fin de la première saison. Mais si le showrunner a un plan bien précis en tête (cinq saisons, pas plus, on part d’un point A pour aller vers un point B), il sait aussi accueillir les bonnes surprises.
Jesse et Walt, une relation complexe
Plus Walt avance vers le côté obscur de la force, plus Jesse s’humanise, au point de devenir le baromètre émotionnel de la série. Ce fils spirituel représente bien souvent la conséquence des actes de son mentor. La première scène vraiment dérangeante – qui témoigne d’un début de perte de la notion du bien et du mal chez l’ex-prof de chimie –concerne Jane, la petite amie toxico de Jesse. Alors, certes, elle a une mauvaise influence sur le jeune homme, mais Walt recourt à une méthode pour le moins radicale pour régler le souci : il laisse la jeune femme mourir, étouffée par son propre vomi (saison 2, épisode 12). Cette scène a marqué à jamais son interprète, qui en parlait récemment les larmes aux yeux dans un talk show.
Cet acte de “non-assistance à personne en danger” aura des conséquences lourdes, d’abord sur Jesse, anéanti par cette perte, mais aussi sur bien d’autres personnes innocentes : le père de Jane, contrôleur aérien, tout aussi dévasté par cette perte, provoquera un crash d’avion à la suite d’une erreur d’inattention. Walter découvrira des débris de l’avion dans sa piscine.
Plus tard, en saison 4, il ira jusqu’à empoisonner le jeune fils d’une amie à Jesse, Brock, pour donner une bonne raison à son complice de s’en prendre à Gus Fring. Cette intrigue va dévaster une nouvelle fois le jeune homme émotionnellement fragile, qui suspecte Walt, avant de se raviser, puis de découvrir le pot aux roses. D’autres seconds rôles dramatiques, notamment du côté de la famille (son fils handicapé Walter White Jr., sa femme Skyler, son beau-frère Hank) auront un impact important, voire déterminant sur le show. Ils reflètent, chacun à leur manière, la descente aux enfers de Walt.
Car derrière ses atours badass et ses répliques cultes, BB parle de sens moral, de crise existentielle (surtout celle du mâle blanc cinquantenaire mais pas que), de la responsabilité de nos actes, de leurs conséquences, ou encore de l’importance du noyau familial.
Sous influence ciné
À cette profondeur de la narration propre aux séries s’ajoute l’amour de Vince Gilligan pour le septième art. La réalisation ultra-soignée regorge de trouvailles (cet épisode qui s’ouvre sur ce que voit un aspirateur robot) et a plus à voir avec un film qu’une série où, traditionnellement, le script prime. Les scènes d’action sont souvent courtes (l’attaque des cousins Salamanca contre Hank, la fin de Gus Fring, l’explosion en fin de saison 1, la dernière scène façon McGyver où Walt vient sauver Jesse avec une voiture mitrailleuse) mais explosives et d’une redoutable efficacité.
Le parcours criminel de Heisenberg est jalonné de méchants d’anthologie tarantinesques : big up à Hector Salamanco, à Gus Fring et sa mort incroyable, et finalement à Heisenberg himself. On pense à Reservoir Dogs et plus encore à Pulp Fiction (avec des hommages plan par plan de Vince Gilligan).
Breaking Bad convoque le souvenir d’autres chefs-d’œuvre du grand écran tels que Le Parrain (pour le parcours de Michael Corleone comparable à celui de Walter White), Il était une fois dans l’Ouest (la série a des airs de western moderne jusque dans le soleil écrasant d’Albuquerque, Nouveau-Mexique) et autres films signés Sergio Leone, Une nuit en enfer ou Casablanca pour l’ambiance film noir.
La scène culte
Difficile de n’en choisir qu’une tant la série enchaîne les morceaux de bravoure. Certains épisodes, comme “Fly” (une mouche dans le labo rend dingue Walt),”Face Off” (la fin de Gus) ou “Ozymandias” sont inoubliables. On aurait pu opter pour l’iconique scène “Say my name“, mais le fameux “I’m not in danger, I’m the danger” (saison 4, épisode 6) adressé lors d’une conversation animée avec sa femme, Skyler (Anna Gunn), qui a peur et propose de se rendre à la police, est un must.
La scène exprime à merveille toute la thématique de la série : Skyler décrit le Walt des débuts (“un prof atteint d’un cancer, prêt à tout pour gagner de l’argent”) en imaginant ce qu’ils pourraient dire à la police. Mais l’homme qui se tient devant elle n’est plus le gentil prof de chimie. Non, c’est un criminel aguerri, qui n’est pas en danger, mais le crée. Il se charge de l’expliquer à sa femme, qui réalise alors à quel point l’homme qu’elle a épousé n’est plus celui qui lui fait face.
Plus tard, à la toute fin de la série, c’est encore à Skyler que Walt avoue : “Toutes les choses que j’ai faites, je les ai faites pour moi. J’y ai pris du plaisir. J’étais vivant.”
Phénomène pop
Breaking Bad n’est pas la première série à devenir un phénomène de pop culture : Friends, Lost, Mad Menou Les Simpson sont là pour le prouver. Il n’empêche, l’amour des fans pour la série semble se bonifier avec le temps. Un laboratoire à cocktails façon van de Breaking Bad sillonne l’Europe, un coffee shop a ouvert à Brooklyn, et même les braqueurs se griment en Heisenberg et son iconique couvre-chef. Les fans du show cassent leur tirelire pour se payer un tour des lieux de tournage à Albuquerque et balancer une pizza sur la maison qui a servi de décor à cette fameuse scène.

La série est citée dans des films (le couple de Nos pires voisins déguise son enfant en Heisenberg), les répliques cultes (“Say my name”, “Yo, bitch!” a eu son appli, “I’m the danger”…) ne cessent d’être reprises ici et là. Le pop art s’est emparé du phénomène. Au passage, Aaron Paul et Bryan Cranston ont gagné des fans fidèles qui les suivent dans leurs nouvelles aventures ciné ou sérielles.
Au moment de la diffusion du show, l’engouement populaire a aussi été marquant. En général, une série voit ses audiences baisser au fil de sa vie. Seules les grandes montent. Le pilote de Breaking Bad avait attiré 1,41 million de curieux lors de sa diffusion le 20 janvier 2008. Ils seront 10,3 millions d’accros à suivre le series finale le 29 septembre 2013.
Son arrivée sur le catalogue Netflix quelque temps plus tard, carrément saluée par Vince Gilligan, permet depuis à de nombreux spectateurs de (re)découvrir la série, d’échanger sur des points d’intrigue, des petits indices méta, d’analyser la symbolique de Breaking Bad, bref de continuer de faire vivre le show bien après sa fin.
Les héritiers
Si Breaking Bad a pu être comparée à d’autres séries comme Les Soprano, son mélange d’influences ciné et d’écriture sérielle est si singulier et si propre à son créateur, Vince Gilligan, qu’on ne voit pas vraiment qui mieux que lui peut faire perdurer l’esprit BB.
On notera que la réalisation, aussi inventive et soignée que celle d’un film, a influencé la production sérielle des années suivantes, de True Detective au récent The Night Of.
On pense logiquement au spin-off de BB, Better Call Saul, qui a vu le jour sur AMC (et Netflix chez nous) en 2015 et se penche sur le personnage de Saul Goodman (Bob Odenkirk) avant qu’il ne devienne cet avocat aussi drôle que véreux et amoral. Encore une trajectoire de mâle en pleine crise qui va perdre un peu de son âme.
On identifie d’emblée quelques marottes propres à Vince Gilligan (un héros sympathique bientôt capable du pire, des problèmes de famille, une fine psychologie, une réal aux petits oignons, une intrigue qui prend son temps et s’accélère d’un coup, une palette de couleurs bien précise…), mais BCS est plus lumineuse et légère que Breaking Bad. Pour le moment du moins.
La série qui a peut-être le plus de Breaking Bad en elle, c’est Fargo, son humour grinçant, ses personnages a priori banals et sa superbe réalisation. On détecte un peu de Walter White chez Lester, le petit gars sympa de la première saison de Fargo, interprété par un autre acteur caméléon, Martin Freeman.
Achevée en 2013, Breaking Bad reste une série très récente. Elle n’a probablement pas fini d’inspirer les futurs scénaristes. Mais le show appartient aussi à cette époque déjà presque révolue, du règne de l’antihéros débuté avec Tony Soprano, poursuivi par Don Draper et achevé par Walter White.
** MAD MEN (2007)

Synopsis
Créée par Matthew Weiner, Mad Men est une série américaine de la chaîne AMC diffusée depuis le 19 juillet 2007. En France, après l’avoir suivi sur TPS Star, les téléspectateurs peuvent la retrouver sur Canal+ depuis le 2 novembre 2008 et sur Série Club depuis le 2 septembre 2012.A l’instar de ce qui avait été fait pour Breaking Bad, la septième et dernière saison de Mad Men est diffusée par AMC en deux parties. Les sept premiers épisodes de cette ultime saison sont diffusés entre le 13 avril et le 25 mai 2014 tandis que les sept derniers épisodes de la série sont attendus pour le début de l’année 2015.SynopsisLes “fous” de Madison Avenue (le “mad” de Mad Men) ne sont pas des tendres : ni avec les professionnels, ni avec les femmes. L’univers de la publicité, dans le New York des années 1960, est en mutation : la société de consommation a pris un nouveau virage que les publicistes ne doivent pas rater.A commencer par Don Draper, l’un des plus brillants de sa génération. A la tête du cabinet publicitaire Sterling Cooper, ce personnage cynique est un véritable requin, un homme prêt à tout pour imposer ses vues et se faire une place en or. Sans faux semblant, il mène son petit monde à la baguette, forcé de montrer les crocs devant les jeunes ambitieux, à l’image de Pete Campbell. Mais saura-t-il tenir le choc ?Production et receptionLa série compte au total 92 épisodes de 46 minutes répartis sur 7 saisons. Si au départ la série a eu du mal à s’imposer, AMC a bien fait de lui laisser sa chance puisqu’au fil de ses saisons, Mad Men a su s’imposer comme une série phare des années 2010.Elle a ainsi remporté 4 Golden Globes de la meilleure série dramatique (2008, 2009, 2010 et 2011) et a valu à Jon Hamm un Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique (2008). Mais Mad Men a également remporté des prix au Festival de télévision de Monte-Carlo, aux Directors Guild of America Awards et aux BAFTA.CastingAvec Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, Christina Hendricks, John Slattery, January Jones, Michael Gladis, Kiernan Shipka, Jared Harris, Robert Morse, Rich Sommer, Aaron Staton, Alison Brie, Christopher Stanley, Matt Long et Jessica Paré.

UN ARTICLE DE VL MEDIA PAR Fanny Lombard Allegra
En 2007, nous faisions la connaissance de Don Draper, le héros de Mad Men. Une série acclamée par la critique, qui a durablement marqué les esprits et qui arrive sur Amazon.
C’est quoi, Mad Men ? Au début des années 1960 à Manhattan, les grandes agences de publicité se concentrent sur Madison Avenue, ce qui vaut aux créatifs le surnom de Mad Men.. Cadre de l’agence Sterling Cooper, le génial Don Draper (Jon Hamm) tente tant bien que mal de concilier vie professionnelle et vie privée, tout en préservant un lourd secret lié à son mystérieux passé. De son côté, Peggy Olson (Elizabeth Moss) débute comme simple secrétaire, mais elle a d’autres ambitions et compte bien faire carrière malgré le machisme ambiant. Mais l’époque est marquée par des bouleversements sociaux et économiques, et Don et son entourage doivent s’adapter aux évolutions de la société.
A écouter aussi : Retour sur l’aventure Mad Men dans La loi des séries

Lorsque s’achève Les Soprano, où il a travaillé aux côtés de David Chase en tant que scénariste et producteur, Matthew Weiner tente de vendre son nouveau projet, Mad Men, aux chaînes du câble. Aucune ne donne suite, à l’exception de AMC qui souhaite désormais produire ses propres séries. Diffusé en Juillet 2007, le pilote réalise une audience assez modeste, bien que supérieure à celles généralement réalisées par la chaîne. Toutefois, la série retient d’emblée l’attention des médias, notamment séduits par son esthétisme. Ce sera une constante: sans jamais réaliser des cartons d’audience aux États-Unis, la série bénéficiera toujours de critiques dithyrambiques et sera couronnée d’une pluie de récompenses. A l’instar de The Wire, Mad Men devient une série de prestige, une série-culte couverte d’éloges et suivie par un petit groupe de fidèles.

Mad Men, c’est d’abord l’histoire de Don Draper, magnifiquement interprété par Jon Hamm, dont on suit les déboires professionnels et les crises conjugales. Draper, c’est un séducteur qui sent bon le tabac et la testostérone, une caricature de mode à la Cary Grant qui envoûte ses clients et les femmes. Un self-made man au passé obscur, devenu publicitaire par hasard, au sein de l’agence Sterling Cooper. Et un créatif de génie, qui vous sort ses meilleurs slogans au terme d’un processus créatif qui consiste le plus souvent à s’allonger sur un canapé, un old fashioned dans une main et une cigarette dans l’autre, en attendant que survienne une idée géniale… En privé, c’est une autre histoire. Installé dans une maison de banlieue, il est marié à une ancien mannequin, Betty. Parfaite mère de famille, elle s’occupe de leurs deux enfants et prépare le dîner, en attendant que son mari rentre du travail, entre deux contrats et deux relations extra-conjugales. Bien qu’il aime ses enfants et sans doute aussi sa femme (même s’il se montre souvent méprisant envers elle), Don est un père de famille défaillant et absent. Et pour cause : Don Draper n’est pas celui qu’on croit. Cultivant le secret et le mystère, il est hanté par un passé obscur et des démons intérieurs qui l’empêchent de s’épanouir et de s’attacher.
On pourrait s’appesantir sur le sujet, déterminant dans l’histoire relatée par la série ; mais comme il s’agit du rebondissement principal (et même s’il survient en saison 1), nous vous ferons grâce du spoiler… En tous cas, ses zones d’ombre, ses doutes et ses failles font de Don Draper un personnage fascinant. Moins violent que Tony Soprano par exemple, il reste un anti-héros tout aussi sombre et torturé, un homme égoïste, cynique et prétentieux pour lequel il est difficile de ressentir de la sympathie. Au fur et à mesure qu’il est rattrapé par son passé, Don Draper va perdre pied, dans une chute inexorable telle que l’illustre le superbe générique de Mad Men.

L’action se déroule essentiellement au siège de l’agence Sterling Cooper, sorte de microcosme où Draper dirige une équipe de créatifs et soumet ses idées à ses clients. Il y noue des relations avec ses supérieurs et les autres employés de l’agence, ces rapports évoluant entre conflits, rivalités, amitié et respect, au fil des événements et au gré des changements qui surviennent dans l’agence avec l’arrivée de nouveaux actionnaires ou de nouveaux propriétaires.
Aux cotés de Don évoluent ainsi toute une galerie de personnages. Pour ne citer que les principaux, on retiendra Peggy Olson (Elizabeth Moss), jeune secrétaire en proie au harcèlement sexuel et à la condescendance de ses collègues masculins, qui parvient à force d’obstination à briser le plafond de verre pour devenir la première femme publicitaire de l’agence. Ou encore la plantureuse Joan (la flamboyante Christina Hendriks) qui cherche à concilier sa vie professionnelle et sa vie sentimentale, et se sert de tous ses atouts (notamment physiques) pour arriver à ses fins. Du côté des hommes, nous avons les deux associés de l’agence, Roger Sterling (John Slattery), homme à femmes et mentor de Draper, et l’excentrique vétéran Bertram Cooper (Robert Morse), ou par exemple Pete Campbell (Vincent Kartheiser), jeune publicitaire prometteur et ambitieux. Enfin, Betty Draper (la blonde January Jones, très Grace Kelly), ex-mannequin piégée dans un rôle de femme au foyer dont elle hésite à s’affranchir. Autant de personnages, tous parfaitement interprétés, qui gravitent dans l’orbite de Draper et dont on suit l’évolution dans des intrigues annexes plus ou moins indépendantes.

En lui-même, le scénario de Mad Men suffit déjà à en faire une série intéressante. Mais soyons honnêtes : ce n’est pas ce qui a fait le succès de la série. Dès le départ, Mad Men a été unanimement saluée pour son esthétisme,son ambiance glamour dénuée de vulgarité, sa mise en image recherchée et raffinée, et surtout pour la manière dont elle retranscrivait à l’écran les années 1960. Lorsqu’on évoque une série d’époque, on insiste souvent sur la qualité de la reconstruction, à travers les décors et les costumes. Dans le cas de Mad Men, cet aspect a acquis une dimension inédite, jusqu’à en faire un phénomène de société. Rapidement, les magazines et les médias se sont emparés de la série-culte pour illustrer le retour à la mode et au design des années 60. Les tenues vintage, les coiffures, le maquillage, le mobilier d’époque et le papier peint kitsch sont devenus des musts. Au point que le New York Magazine, par exemple, a dédié une rubrique hebdomadaire au look des héroïnes, expliquant à ses lectrices comment s’habiller comme Joan ou Betty Draper… L’influence de la série sur la mode ne s’est pas arrêtée au papier glacé : le style Mad Men a inspiré des marques aussi diverses que Jil Sander, Prada, Top Shop ou Zara, et Banana Republic lui a même consacré plusieurs collections. Jupes à godet, robes de pin-up, stilettos, pulls jacquards, costumes croisés, foulards, imprimés vintage, colliers de perle, sacs bowiling, ballerines, pantalons 7/8… C’est toute une mode, élégante et glamour, qui a déferlé sur les podiums, dans les magasins et dans la rue.

Cela pourrait sembler anecdotique. En réalité, l’influence évidente de Mad Men sur la mode n’est qu’un des aspects de l’impact qu’à eu la série. Les personnages fument comme des pompiers, boivent comme des trous, et les hommes couchent à droite et à gauche. Entre pression patriarcale et aspirations personnelles, les femmes commencent à s’émanciper et à sortir du rôle de jolies poupées auquel elles sont cantonnées. John Fitzgerald Kennedy est président, l’homme marche sur la lune, et les stars s’appellent Marilyn Monroe ou James Steward. L’économie est en plein boom, on assiste à la naissance d’une société de consommation portée par de nouveaux produits, la notion d’obsolescence programmée, celle de cible marketing, l’importance du marché de l’automobile, l’émergence de nouveaux médias comme la télévision… et, bien sûr, de la publicité. En 2007, alors que nous sommes englués dans les crises politiques, économiques et sanitaires, entre subprimes, défiance envers les dirigeants et principe de précaution érigé en norme, Mad Men fait souffler un vent de nostalgie en mettant en lumière des années 60 fantasmées.
Mais dans le même temps, la série entre aussi en résonance avec nos doutes et nos angoisses : les 60s deMad Men, ce sont aussi celles de la fin d’une époque… et du début d’une nouvelle ère. Au-delà des costumes et des décors, Mad Men a su recréer toute une atmosphère, intégrant au récit des faits historiques vécus par les personnages, et qui font entièrement partie de l’histoire. Le suicide de Marilyn Monroe, l’assassinat de Kennedy, la menace de la guerre froide, l’émancipation féminine, la remise en cause de la domination masculine et, partant, la réaction des héros face à ces bouleversements : tous ces éléments soulignent l’évolution de la société. Certains restent monolithiques, sclérosés dans leur mode de pensée (Pete Campbell ou Betty Draper par exemple), quand d’autres suivent le mouvement et s’adaptent au changement. A ce titre, le personnage le plus emblématique est certainement Peggy, qui parvient à s’imposer en tant que femme dans un monde d’hommes – au prix de sa vie familiale.

Mad Men est-elle un chef d’œuvre indispensable, comme on le dit souvent ? Ça se discute… Elle l’est, si l’on se borne à considérer son impact culturel et social. Mais en tant que série à proprement parler, on ne saurait être aussi catégorique – beaucoup de spectateurs sont restés hermétiques à Mad Men. L’intrigue ne s’appuie pas sur l’action ou sur des cliffhangers spectaculaires ; elle repose sur de brillants dialogues, l’ambiguïté des situations et la complexité des relations. Mais certains épisodes ou intrigues secondaires sont moins réussis, et on peut trouver l’ensemble ennuyeux… Il faut laisser du temps à Mad Men, mais aussi passer outre une certaine froideur. Le soin extrême voire maniaque apporté à l’arrière-plan frôle souvent l’affectation, donnant à la série un côté clinique qui rend difficile l’immersion du spectateur. Mad Men est donc une série qui peut paraître difficile d’accès, et ce n’est pas une série que l’on regarde d’une traite ou dont on attend impatiemment l’épisode suivant. Non : pour les amateurs, elle se savoure, elle se déguste comme un bon whisky…
Il y aurait beaucoup à dire sur Mad Men. D’ailleurs, la série a fait couler beaucoup d’encre et a même fait l’objet de très sérieuses études universitaires. A travers le parcours de son héros, le magistral Don Draper, Mad Men reflète à la perfection les changements survenus dans la société des années 60. Souvent présentée comme l’une des meilleures séries de ces dernières années (voire de l’Histoire de la télévision), elle peut pourtant rebuter certains spectateurs, réfractaires à sa lenteur et à la froideur de son atmosphère. Elle s’est pourtant imposée comme une série-culte, ne serait-ce que pour l’impact et l’écho qu’elle a rencontrés. C’est ce qui fait encore de Mad Men, 10 ans après, une série incontournable.
Mad Men (AMC)
2007-2012.
7 saisons de 92 épisodes.
Traductrice et chroniqueuse, fille spirituelle de Tony Soprano et de Gemma Teller, Fanny Lombard Allegra a développé une addiction quasi-pathologique aux séries. Maîtrisant le maniement du glaive (grâce à Rome), capable de diagnostiquer un lupus (merci Dr House) et de combattre toutes les créatures surnaturelles (vive les frères Winchester), elle n’a toujours rien compris à la fin de Lost et souffre d’un syndrome de stress post-Breaking Bad
*** LES SOPRANO (1999)
Pourquoi Les Soprano est la meilleure série de tous les temps

FNAC 04 novembre 2021 Par Lisa Muratore
Plusieurs fois récompensée, Les Soprano, s’est imposée dès 1999 comme une série emblématique du petit écran. Entre révolution et hommage aux sagas mafieuses, elle est devenue une œuvre indétrônable.
Après avoir marqué l’univers de la télévision, Les Soprano sont de retour au cinéma, avec le prequel Many Saints of Newark : Une Histoire des Soprano. Sorti le mercredi 3 novembre dans les salles obscures françaises, le long-métrage réalisé par Alan Taylor retrace l’ascension de Dickie Moltisanti. Ce dernier est l’oncle du célèbre Tony Soprano, à qui Michael Gandolfini prêtera ses traits après que son père, le regretté James Gandolfini, ait campé ce rôle dans le show. Une occasion rêvée de replonger dans l’univers de cette famille aussi passionnante que dysfonctionnelle sur fond de mafia crapuleuse. L’occasion aussi de comprendre comment la série créée par David Chase a su s’imposer comme l’une des meilleures de tous les temps. À ce jour, le programme produit par HBO a récolté plus de 200 nominations et 100 récompenses lors de plusieurs cérémonies comme les Emmys Awards, les Golden Globes ou encore les Television Critics Association. La sortie du film était un bon prétexte pour revenir sur les aventures du Parrain ultime du petit écran.
La recette d’une série culte : entre renouveau et hommage à l’univers des gangsters
Avant, les récits sur les gangsters appartenaient au cinéma. Sergio Leone, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian de Palma ou encore Henri Verneuil ont fait de ces criminels les personnages centraux de leurs histoires. Au fil du temps, les films de mafieux se sont diversifiés. Les costumes trois pièces et les borsalinos ont laissé place à des adaptations plus modernes. Le format a également changé et les règlements de comptes se sont invités du côté des séries. D’abord en 1984 avec le feuilleton La Mafia puis plus récemment avec Boardwalk Empire ou des shows populaires comme Peaky Blinders et Narcos. De New York à Mexico en passant par Birmingham, les aventures de ces hors la loi ont passionné plusieurs millions de téléspectateurs et abonnés aux plateformes de VoD.
Difficile d’évoquer les films et les séries de gangsters sans faire référence à son vivier principal : la mafia italienne. Depuis deux décennies, les vendettas et les magouilles de ces protagonistes aussi captivants que violents n’ont cessé de fleurir sur nos écrans. Une omniprésence en grande partie justifiée par l’impact des Soprano, qui a revisité les codes de la saga mafieuse, notamment à travers son personnage phare : Tony Soprano.

À lui seul (ou presque), il représente l’essence de la série. À travers une ambivalence aussi charismatique qu’attachante, James Gandolfini est parvenu à offrir une interprétation magistrale du baron de la mafia. Là où cette figure emblématique du septième-art a toujours été représentée comme un adversaire redoutable, David Chase a redistribué les cartes en choisissant de raconter le parcours d’un mafieux au bord de la crise de nerfs. Le créateur de la série a fait évoluer l’image du criminel, en lui offrant notamment une (certaine) moralité et en faisant de lui un père de famille, mais aussi celle de l’anti-héros en lui offrant davantage de profondeur. La sensibilité de Tony est souvent contrastée par la violence que l’on attend de ce chef de gang, notre héros étant ainsi le reflet d’une dualité passionnante.
Ce constat s’applique également à tous les personnages des Soprano, que ce soit Carmela, l’Oncle Junior ou Christopher Moltisanti. La série apparaît comme le format idéal pour offrir une appréhension travaillée des personnages. Elle a par ailleurs su le faire avec une élégance frôlant la perfection en filmant une galerie de protagonistes remplis de contradictions, de faiblesses et de névroses.

Pour autant, Les Soprano n’oublie pas de conserver les codes des œuvres mafieuses érigées avant elle. Les fusillades, les règlements de comptes ou encore la menace du FBI sont monnaie courante. Si les scènes d’action sont aussi surprenantes qu’éphémères, elles n’en sont pas moins jouissives et rappellent les bons vieux classiques du genre.
Le programme s’invite dans notre quotidien et dans celui de nos séries modernes. Ces dernières ont considérablement évolué sous l’influence de ces personnages emblématiques mais aussi grâce à une mise en scène unique. Là où la plupart des shows faisaient monter la tension en se concluant sur des cliffhangers haletants, Les Soprano préfère terminer sur des notes absurdes et anodines. Un repas de famille, Tony isolé ou encore la vie courante de ses soldats… Tout est finalement prétexte à dénouement. La série a également fait du format 45 minutes – 1 heure celui de nombreuses productions, sans parler du budget colossal alloué désormais aux tournages des épisodes.
Un succès qui attire les superstars d’Hollywood
Que ce soit devant ou derrière la caméra, de nombreux artistes reconnus ont contribué au succès de la série. On se souvient notamment de Steve Buscemi, l’acteur de Reservoir Dogs qui a prêté ses traits au cousin de Tony Soprano, mais aussi Lorraine Bracco, Michael Imperioli ou encore Tony Sirico, ces derniers ayant évolué auparavant aux côtés de Martin Scorsese pour Les Affranchis. En coulisses, Les Soprano est orchestrée par un David Chase bien inspiré, qui a également pu compter sur les talents d’un clan de scénaristes prometteurs parmi lesquels on retrouve Matthew Weiner, le créateur de Mad Men et Terence Winter, l’auteur à qui l’on doit Boardwalk Empire.
Perçue comme un personnage unique de la série, la bande-originale a également été saluée à travers les six saisons. Chaque morceau a été choisi avec soin par David Chase aux côtés du producteur Martin Bruestle et de la responsable de la musique, Kathryn Dayak. Les styles sont variés, chaque générique dévoile une nouvelle chanson et certaines scènes ont été pensées et tournées uniquement pour accompagner un morceau choisi au préalable.

L’onde de choc des Soprano à travers le temps
Au moment de sa diffusion, Les Soprano se nourrit de la pop culture. L’exemple le plus parlant reste Silvio Dante (Steven Van Zandt), une copie assumée et amusante d’Al Pacino dans Scarface. Or, ce qu’on ne réalise pas encore au moment du series premiere, c’est que le show est sur le point de devenir un objet de pop culture à lui tout seul. Les Simpson, American Dad, SNL et même Coca Cola vont réutiliser les codes des Soprano et plus particulièrement son générique bercé par les notes de « Woke Up This Morning » d’Alabama 3. Le clan de Tony n’est plus seulement une famille du petit-écran : il est un modèle à suivre dans le paysage audiovisuel.
Les Soprano est le reflet d’une certaine société. David Chase dépeint l’Amérique à la fin du XXe siècle à travers les yeux de la communauté italo-américaine. Leur héritage culturel tient une place majeure dans la série. Les personnages tentent de se construire, tiraillés entre la nostalgie de leur Italie natale et leur place dans une Amérique républicaine. Les Soprano met en scène les limites du rêve américain et le rejet d’une génération qui n’arrive pas à se positionner dans la société. Des problématiques encore actuelles et qui nous rappellent à quel point le show porté par James Gandolfini est intemporel.

Les Soprano a renversé l’univers des séries autrefois dominé par les sitcoms. Elle est encore aujourd’hui considérée comme un élément incontournable de la culture du divertissement. Son casting multi récompensé et son analyse psychologique, sociétale parfois métaphysique en ont fait une œuvre fondamentale. La série mafieuse est devenue une véritable session de thérapie pour ses personnages mais aussi pour son public.
** THE WIRE
CLIC SUR L’IMAGE POUR ECOUTER

EXTRAIT RADIO FRANCE. La ville de Baltimore sous toutes ses coutures ou presque. C’est le tour de force réalisé par l’immense David Simon, qui signe avec The Wire l’une des meilleurs séries de tous les temps.
Quand la série débute en 2002, on pense d’abord avoir affaire à une assez classique enquête policière sur le démantèlement d’un gang de trafiquants de drogue. Mais les téléspectateurs vont vite se rendre compte que The Wire est bien plus que ça.
Bien sûr, on s’intéresse ici aux gangsters des quartiers noirs de Baltimore, et on découvre aussi le quotidien des policiers de la ville.
Certains sont racistes et volontiers bagarreurs, d’autres sont démotivés ou corrompus, d’autres enfin, tentent de faire bouger les choses, et malgré les faibles salaires, travaillent jour et nuit sur leurs enquêtes.
Mais, très vite, le panorama s’élargit et on plonge aussi dans l’univers des juges, des dockers du port de Baltimore, des politiciens, des enfants, des professeurs, des journalistes et des toxicomanes, qui n’ont aucun mal à trouver de l’héroïne, tant certains quartiers de la ville sont gangrenés par le trafic.
Le tout avec un impressionnant souci du détail. Le réalisme de The Wire transparaît notamment dans les dialogues, qui font la part belle à l’argot du Maryland.
C’est un ancien journaliste et écrivain qui a créé “The Wire”
Il s’appelle David Simon. Pendant 12 ans, c’est lui qui était chargé de la rubrique faits divers auBaltimore Sun. Et David Simon a très bien réussi sa reconversion puisqu’avec The Wire, puis Treme et The Deuce, il est devenu l’un des auteurs les plus prestigieux du monde de la fiction télé !
Ici, en compagnie d’Ed Burns, un ancien policier et professeur de Baltimore, Simon construit une œuvre complète et complexe.
“The Wire” est la fois très réaliste, quasi documentaire même, et totalement romanesque
Une mise en scène très sobre, très épurée, une utilisation parcimonieuse de la musique, une lenteur assumée, un récit éclaté… l’intransigeance de David Simon, et ses choix artistiques fortscontribuent à faire de The Wire une oeuvre de tout premier plan. Et comme dans toutes les grandes séries, il y a ici des scènes cultes.
Par exemple celle où le duo de policiers Bunk Moreland et McNulty prononcent un seul et unique mot, pendant 5 vraies minutes… Le f-word, comme on dit pudiquement aux Etats-Unis
Cette scène, parmi tant d’autres, prouve la singularité, mais aussi la radicalité de la série.
Cette série est très politique, très engagée, à l’image de son créateur David Simon. The Wire parle sans doute avant tout du système américain qui pèse de tout son poids sur la vie des citoyens, et notamment les plus pauvres d’entre eux. Et contrairement à la plupart de ses consœurs, cette série n’a pas de héros, pas de personnages principaux.
Ici, c’est une ville, Baltimore en l’occurrence, qui est au cœur de l’intrigue
Après 60 épisodes tout pile, The Wire a tiré sa révérence.
Cinq saisons devenues mythiques, qui continuent à passionner des millions de fans, partout dans le monde, plus de 10 ans après.
Des personnages, aussi, sont devenus mythiques. On pense, au sénateur Clay Davis, à Bubbles, Snoop, et bien sûr Omar.
On reste quand même un peu déçu par la dernière saison, celle consacrée notamment aux journalistes, qui est moins convaincante.
Mais malgré cette relative baisse de régime, The Wire est une série d’exception, l’une des toutes meilleures de l’histoire. Elle peut prétendre à la première place du podium, tout comme une autre série HBO, les Soprano.
* SIX FEET UNDER (2001)
SIX FEET UNDER ou SIX PIEDS SOUS TERRE. À Los Angeles, la famille Fisher est à la tête d’une société de pompes funèbres Fisher & Fils, fondée par le père de famille, Nathaniel Fisher (Richard Jenkins). À la mort de ce dernier, ses deux fils, Nathaniel Jr. (Peter Krause), qui a toujours dit ne jamais vouloir prendre la suite de son père, et David (Michael C. Hall), l’introverti, reprennent l’entreprise familiale dont ils viennent d’hériter. Leur mère Ruth (Frances Conroy), doit assumer son rôle de femme. Claire (Lauren Ambrose), la benjamine de la famille, s’efforce de trouver sa voie.



EXTRAIT ECRAN LARGE Geoffrey Crété | 7 novembre 2023 – MAJ : 07/11/2023 Oui, Six Feet Under, la série HBO d’Alan Ball, est un chef-d’œuvre. Et oui, c’est l’une des meilleures fins de série de tous les temps.
DComment créer un débat-baston ? Demander quelles sont les meilleures fins de série. Parmi les évidences à peu près validées par toutes les personnes de bon goût (ou qui prétendent l’être) : Les Soprano, Breaking Bad, The Leftovers, Mad Men, Fleabag, The Shield, Mr. Robot… et Six Feet Under, évidemment.
Créée par Alan Ball (scénariste oscarisé d’American Beauty), diffusée sur HBO entre 2001 et 2005, Six Feet Under s’est terminée après cinq saisons et 63 épisodes avec l’épisode Tout le monde attend (Everyone’s Waiting). Toutes les personnes qui l’ont vu auront immédiatement en tête la musique de Sia, Breathe Me, ainsi que le tourbillon d’émotions de ce final à peu près parfait, qui conclut admirablement la série en plus d’aller au bout de l’idée même d’une fin d’histoire.
EXTRAIT SUD OUEST
S’il est une série à voir avant de mourir, c’est bien celle-ci, « Six Feet Under ». Outre la plaisanterie, de nombreux témoignages de téléspectateurs racontent l’impact de cette œuvre sur la façon dont ils abordent aujourd’hui la mort et le deuil.
Et c’est donc le 3 juin 2001 que la chaîne HBO, après avoir lancé sa série familiale et mafieuse « Les Soprano », avec le succès que l’on connaît, enfonçait le clou avec ce tout nouveau clan, les Fisher.
L’histoire débute, comme tous les épisodes d’ailleurs, par un décès. Ici, il s’agit du propriétaire de l’entreprise de pompes funèbres, « Fisher & Sons », Nathaniel Fisher (Richard Jenkins), le patriarche, qui se tue au volant d’un corbillard flambant neuf. Ses deux fils se retrouvent malgré eux à la tête de cette société : David (Michael C. Hall), un gay refoulé, qui s’est préparé depuis longtemps à cette carrière, et Nate (Peter Krause) qui a juré ne jamais devenir croque-mort. La veuve, Ruth (Frances Conroy), qui est en pleine renaissance sexuelle mais veut pleinement jouer son rôle de mère et Claire (Lauren Amborse), sa fille, qui fait ses débuts dans la vie d’adulte, clôturent cette tribu.
Tous vont devoir trouver leur place après ce chamboulement à travers des relations conflictuelles entre eux. Et c’est justement ce qui les rend très attachants et fait que l’on a envie de suivre leurs aventures.Mais rassurez-vous, cette série n’est pas lugubre et la mise en scène jamais glauque, loin de là. Même si le thème de départ n’est pas des plus réjouissant, « Six Feet Under » est à la fois drôle et bouleversante. Ironie féroce, humour grinçant, sexualité sont au rendez-vous. Et tout le monde peut se reconnaître dans cette famille
** TWIN PEAKS

*** LE BUREAU DES LEGENDES

THE CROWN

WEST WING (A LA MAISON BLANCHE)

LE PRISONNIER

SUCCESSION

GAME OF THRONES

FRIENDS

FLEABAG (2016)



Dieu que cette actrice est splendide, éblouissante. Dieu que la série est intelligente. Dieu qu’il est dommage qu’elle ne comporte que 2 saisons de 6 courts épisodes.
EXTRAIT DE TELERAMA
Sébastien Mauge
La rocambolesque vie sociale, familiale, sentimentale et sexuelle d’une jeune trentenaire surnommée Fleabag (« sac à puces »). Le pitch est maigre et inversement proportionnel au foisonnement d’idées, d’humour, d’intelligence et d’émotions qui innerve ce petit bijou. Phoebe Waller-Bridge a adapté sa propre pièce de théâtre pour créer et écrire leur série en se donnant le rôle principal. La jeune femme n’hésite pas à briser le fameux « quatrième mur » pour s’adresser directement aux téléspectateurs. Une connivence loin d’être superficielle, qui nous immerge dans un torrent de rires et de larmes, avec une bonne dose d’autodépréciation, morale et physique, une liberté de ton, de l’humour trash et surtout la féroce envie de prôner un féminisme libéré… du féminisme, en faisant voler en éclats les carcans dogmatiques.
Fleabag est une londonienne déprimée. On le devine petit à petit. On pense d’abord que c’est dû à son boulot de gérante d’un café où les rares clients consomment surtout de l’électricité pour recharger tablettes et portables. Ou c’est peut-être à cause de son petit ami, qui la quitte régulièrement — la dernière fois parce qu’il l’a surprise en train de se masturber devant un discours de Barack Obama ! A moins que ce ne soit le fait de côtoyer sa sœur coincée ou son père distant. On s’en amuse, finissant par se dire que c’est tout cela à la fois, jusqu’à ce que la vérité éclate à l’arrière d’un taxi, sans prévenir, dans une scène aussi douce que brutale…
Waller-Bridge a certainement lâché dans la série beaucoup d’éléments personnels. Après tout, Fleabag est son surnom familial. Mais son portrait de femme insaisissable, à la fois familière et mystérieuse, donnant l’impression de prendre sa vie en main avant de s’écrouler pour mieux se relever l’instant d’après, semble être aussi et surtout le résultat d’une fine observation des névroses contemporaines.
Phoebe Waller-Bridge est une voix unique qui n’a pas fini de résonner et avec laquelle il va falloir compter.
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR


COLUMBO

24 H CHRONO

DOWNTON ABBEY

FRIDAY NIGHT LIGHTS


TRUE DETECTIVE

MINDHUNTER

FARGO


SHERLOCK





