
INTRODUCTION : LES LIVRES QUI CHANGENT LE MONDE
France Culture, la radio, que le monde entier nous envie, a rassemblé par un seul « lien podcast » tous les épisodes de son émission magnifique dénommée « la culture change le monde » : les livres qui le changent, les films, les manifestes, les oeuvres d’art. ET DONC DES LIVRES QU ONT CHANGE LE MONDE. Comment peut-on s’ennuyer ? On propose le lien ci-dessous, par un clic sur l’image ou sur le lien. Pour tous les épisodes, cliquer au bas de la page France Culture « voir plus d’épisodes« . Le graphiste de FC ne l’a pas mis assez « en avant ».

27 PREMIERES PAGES DE 27 LIVRES
Les premières pages de quelques livres. C’est là, parait-il, que le talent se révèle. Victor Hugo nous disait que “tout grand écrivain frappe la prose à son effigie“. Le premier coup doit être le bon. Et si ces pages donnent envie d’aller voir plus loin dans un livre, on en serait, évidemment ravi. On a donc fabriqué une “land page” (il suffit de descendre dans les pages, sans menu) dans laquelle figurent les 27 premières pages des livres que j’ai aimés. Pas tous. Il s’agit de romans qui peuvent avoir “changé le monde”, parmi les plus grands. C’est ailleurs qu’on proposera les pépites moins connues. On me pose toujours la question de mes préférés, comme je la pose toujours. Je réponds instantanément que la question ne devrait pas être posée. C’est k’humeur, le temps d’une vie, qui guide nos préférences. Dans tous les champs. Mais si on insiste je dis que Flaubert est immense et que Philip Roth et Ian Mc Ewan sont les plus grands du depuis le fin du 20ème siècle, particulièrement “La tache” pour l’un et “Samedi” pour l’autre.
CLIC ICI OU SUR L’IMAGE CI-DESSOUS POUR ACCEDER AUX “PREMIERES PAGES”.
Pessoa (« Le livre de l’intranquillité ») Roth (“Indignation”, “La Tache”). Singer (“La famille Moskat”) Gary («”Les cerfs-volants”) Lessing (“Le Carnet d’or”). Steinbeck, (« Les raisins de la colère») Hammett (« Le faucon de Malte. ») Chandler ( « La grande fenêtre» )Rosset (“La joie est plus profonde que la tristesse”), Kundera (« La plaisanterie. ») Woolf (« Vers le phare. », « Les vagues, « Mrs Dalloway), del Castillo (“La Nuit du Décret”) Borges (« Le Rapport de Brodie.») Dostoievski (« Les Frères Karamazov»)Modiano (« Les boulevards de ceinture ») Loti (« Les Désenchantées») Ishiguro « Les vestiges du jour“, Conrad (« Lord Jim ») Flaubert (« Madame Bovary. ») Cohen (« Mangeclous ») Rolin (« Ormuz»). Chase « Pas d’orchidées pour Miss Blandish. ») Hemingway « Pour qui sonne le glas») Daudet (« Sapho. ») Calvino “Le baron perché”), Déon (« Les Poneys sauvages“),
LES VERRES DE CHANDLER
On ne se lasse jamais de cet extrait d’un roman de Raymond Chandler (“Sur un air de Navaja”)
“Il ouvrit la porte du living-room, et le vacarme des conversations nous submergea. L’ambiance était encore plus bruyante, si possible, qu’avant. Le ton semblait avoir monté de deux verres environ.“
Les 25 chefs-d’œuvre de la littérature mondiale qui vont marquer le XXIᵉ siècle
TELERAMA
PALMARÈS. Quels sont les meilleurs livres depuis l’an 2000 ? Pour le savoir, nous avons demandé à soixante écrivains, éditeurs, libraires, traducteurs, critiques français et internationaux de choisir les cinq ouvrages qui ont imprimé à jamais leur mémoire. Verdict.
Akatre pour Télérama
Par Nathalie Crom (avec Youness Bousenna)
Publié le 22 avril 2025 à 10h15
Quels sont, parmi les livres du premier quart du XXIᵉ siècle, les chefs-d’œuvre qui s’inscriront dans l’histoire de la littérature mondiale ? Pour le savoir, Télérama a demandé à soixante personnalités (écrivains, éditeurs, libraires, traducteurs, critiques universitaires français et internationaux) de choisir les cinq ouvrages qui ont imprimé à jamais leur mémoire de lecteur.
Ces milliers de pages — 12 646 exactement, si on additionne les 25 livres retenus dans ce palmarès – donnent furieusement envie de lire et témoignent d’une création littéraire aussi ambitieuse qu’audacieuse. Le roman n’est pas mort, au contraire, il se joue des frontières et ne cesse d’être réinventé. — Valérie Hurier, directrice de la rédaction
25. “La Carte et le Territoire”, de Michel Houellebecq (2010)
La carte est-elle plus intéressante que le territoire — autrement dit la représentation du réel plus passionnante que le réel lui-même ? C’est notamment autour de cette question que se déploie le cinquième roman de l’écrivain français — qui lui valut le prix Goncourt. Une fiction brillante, tout ensemble ironique et hautement mélancolique, doublée d’un autoportrait extravagant.
Éd. Flammarion.
24. “Une histoire d’amour et de ténèbres”, d’Amos Oz (2002)
L’intime et l’Histoire fusionnent dans les pages de ces sublimes Mémoires du grand écrivain israélien, dont ce récit autobiographique demeurera sans doute le chef d’œuvre. Retour sur son enfance à Jérusalem et sur la naissance concomitante de l’État d’Israël, hommage bouleversant à ses parents et ses aïeux, et à la langue hébraïque qui l’a vu naître écrivain.
À lire aussi :
Traduit de l’hébreu par Sylvie Cohen, éd. Gallimard (2004).
23. “Neige”, d’Orhan Pamuk (2002)
De tous les romans remarquables de l’écrivain turc (Prix Nobel de littérature 2006), Neige est assurément le plus captivant, qui emboîte le pas d’un jeune poète exilé en Allemagne, revenu en Turquie pour s’égarer au fin fond de l’Anatolie. Une odyssée poétique et très politique, jalonnée de sinuosités narratives, scintillante de motifs et de sens, drapée de neige…
Traduit du turc par Jean-François Pérouse, éd. Gallimard (2005).
22. “Les Argonautes”, de Maggie Nelson (2015)
La forme hybride de ces Argonautes, mêlant récit d’une histoire d’amour et réflexions sur le genre, érudition et hypothèses, a érigé l’ouvrage de Maggie Nelson en livre de référence d’une démarche littéraire nouvelle et parfaitement contemporaine. Faisant de l’autrice américaine (née en 1973) une des voix majeures de la non-fiction contemporaine.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Michel Théroux, Éditions du sous-sol (2018).
20. “Purge”, de Sofi Oksanen (2008)
Née d’une mère estonienne et d’un père finlandais, Sofi Oksanen a secoué la planète littéraire avec ce roman éloquent qui embrasse, à travers ses deux personnages féminins, cinquante ans de l’histoire de l’Estonie, des occupations allemande, puis russe, jusqu’à nos jours, passant par l’effondrement de l’URSS. Une tragédie puissante, furieuse — non dénuée de compassion.
Traduit du finnois par Sébastien Cagnoli, éd. Stock (2010).
20 ex-aequo. “La Plus Secrète Mémoire des hommes”, de Mohamed Mbougar Sarr (2021)
Écrit par le jeune auteur sénégalo-français, alors âgé de 31 ans, et placé sous le parrainage des Détectives sauvages de Roberto Bolaño, un beau et brillant roman, « livre-monde » tout ensemble complexe formellement et palpitant, cérébral et doucement ironique, foisonnant de thèmes et de personnages, et fondamentalement enclos sur un insaisissable secret.
Éd. Philippe Rey / Jimsaan.
18. “La Bascule du souffle”, de Herta Müller (2009)
Plongée dans l’univers du goulag, observé à travers les yeux d’un jeune narrateur inspiré par le poète Oskar Pastior, La Bascule du souffle a enfin révélé planétairement la beauté tranchante et spectaculaire de l’écriture de l’autrice, Roumaine germanophone émigrée en Allemagne de l’Ouest au mitan des années 1980, lauréate du prix Nobel de littérature en 2009.
Traduit de l’allemand par Claire de Oliveira, éd. Gallimard (2010).
À lire aussi :
18 ex-aequo. “Underground Railroad”, de Colson Whitehead (2016)
Dans cette éblouissante fiction — sa sixième —, tout ensemble roman d’apprentissage et fable humaniste, l’Américain virtuose se tient aux côtés de Cora, une jeune esclave échappée d’une plantation du Sud, dont il imagine l’odyssée fantastique à travers les États-Unis, jusqu’au nord du pays et l’accès au statut de femme libre.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Serge Chauvin, éd. Albin Michel (2017).
17. “O”, de Miki Liukkonen (2017)
Près de mille pages pour raconter sept journées, au long desquelles se croisent cent personnages souffrant tous d’une psychose : la comète finlandaise Miki Liukkonen (1989-2023), qui mit fin à ses jours à 33 ans, met en œuvre un labyrinthe narratif prodigieux, tout en offrant une méditation aussi hilarante que puissante sur le vertige de la condition humaine.
Traduit du finnois par Sébastien Cagnoli, éd. Le Castor astral (2021).
16. “La Fête au Bouc”, de Mario Vargas Llosa (2000)
Le dictateur Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891-1961), « père de la patrie » dominicaine, et son régime sanglant qui écrasa le pays durant trois décennies sont au cœur de ce magistral roman politique et polyphonique, qui examine de l’intérieur les ressorts de la tyrannie et ceux de sa mise à bas. Assurément le chef d’œuvre du prix Nobel de littérature 2010.
Traduit de l’espagnol (Pérou) par Albert Bensoussan, éd. Gallimard (2002).
15. “La Végétarienne”, de Han Kang (2007)
La Végétarienne, ou l’histoire de Yonghye, la femme qui ne voulait plus ingérer de viande, et qui bientôt souhaita se dépouiller de son corps, s’effacer et devenir végétale… Dix-sept ans avant de recevoir le prix Nobel de littérature, en 2024, l’autrice coréenne livrait, avec cette fable énigmatique, sensuelle et épurée, un diamant noir aux éclats aussi tranchants qu’inquiétants.
Traduit du coréen par Eun-Jin Jeong et Jacques Batilliot, éd. Le Serpent à plumes (2015).
14. “Kafka sur le rivage”, de Haruki Murakami (2002)
Kafka Tamura a 15 ans lorsqu’il s’enfuit de la maison familiale. Ce roman initiatique lui emboîte le pas, ainsi que celui d’un vieillard nommé Nakata. À ces deux fils narratifs, le magicien Murakami suspend une matière romanesque à haut potentiel d’envoûtement. Bâtissant une indémodable fable, tout ensemble triviale et pleine de grâce..
Traduit du japonais par Corinne Atlan, éd. Belfond (2006).
13. “La Maison des feuilles”, de Mark Z. Danielewski (2000)
Une maison dont l’intérieur se dilate en un dédale sans fin, un vieil écrivain aveugle et son mystérieux manuscrit, un jeune intello marginal : voilà pour le décor et les protagonistes majeurs du premier roman de l’Américain Mark Z. Danielewski, vertigineuse quintessence de littérature expérimentale, mais aussi œuvre captivante et de toute beauté.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Claro, éd. Denoël (2002).
12. “Solénoïde”, de Mircea Cartarescu (2015)
Un professeur de roumain de Bucarest, qu’une humiliation fait renoncer à l’écriture, tient un journal pour percer l’énigme de l’existence. Dans ce roman d’une force philosophique et poétique hors du commun, Mircea Cartarescu fait de la plongée hallucinée dans le cerveau d’un homme le point de départ d’une odyssée à travers toutes les connaissances.
Traduit du roumain par Laure Hinckel, éd. Noir sur blanc (2019).
11. “Le Lambeau”, de Philippe Lançon (2018)
Grièvement blessé le 7 janvier 2015, lors de l’attaque terroriste contre l’équipe de Charlie Hebdo, Philippe Lançon a tiré de son expérience de la douleur, physique autant que morale, ce remarquable Lambeau, livre calme et déterminé, empreint d’une grande douceur, dans lequel il s’emploie à sonder jusqu’aux abîmes, sans colère ni culpabilité, « la solitude d’être vivant ».
Éd. Gallimard.
10. “Americanah”, de Chimamanda Ngozi Adichie (2013)
Que d’énergie et d’intelligence rassemblées et concentrées dans ce roman brillantissime qui suit l’itinéraire d’Ifemelu, une jeune femme nigériane arrivée aux États-Unis pour y poursuivre ses études. Y découvrant le racisme — l’un des thèmes majeurs de l’autrice africaine, qui fait ici l’objet d’un exposé lucide, jamais dénué d’humour et très incarné.
Traduit de l’anglais (Nigeria) par Anne Damour, éd. Gallimard (2014).
9. “L’Adversaire”, d’Emmanuel Carrère (2000)
Quel effroyable visage du Mal offre-t-il à contempler, cet accusé jugé et condamné en 1996 pour les froids assassinats de ses deux enfants, son épouse et ses parents ? Des interrogations intimes qu’a fait surgir en lui l’histoire de Jean-Claude Romand, mythomane et meurtrier, Emmanuel Carrère a nourri cette non-fiction inquiète, métaphysique et magistrale.
Éd. P.O.L.
8. “L’Année de la pensée magique”, de Joan Didion (2005)
L’expérience du deuil de son époux, l’écrivain John Dunne, terrassé par une crise cardiaque fin 2003, a dicté à l’iconique écrivaine et journaliste américaine Joan Didion (1934-2021) ce sobre et cru récit d’une traversée des ténèbres. Un voyage aride, sans consolation, au fin fond des terres désolées de la stupeur, du chagrin et de l’affliction.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Demarty, éd. Grasset (2007).
7. “Les Livres de Jakób”, d’Olga Tokarczuk (2014)
Dans ce roman époustouflant, précis et truculent, la Prix Nobel de littérature 2018 invite à un « grand voyage à travers sept frontières, cinq langues, trois grandes religions ». Une épopée politique et mystique qui plonge son lecteur dans la Pologne décadente du XVIIIᵉ siècle, pour s’attacher au destin extravagant du faux messie juif Jakób Frank (1726-1791).
Traduit du polonais par Maryla Laurent, éd. Noir sur blanc (2018).
6. “Les Années”, d’Annie Ernaux (2008)
L’admirable « autobiographie impersonnelle » que sont Les Années a permis à chaque lecteur de saisir pleinement ce qui fait d’Annie Ernaux (Prix Nobel de littérature 2022) une écrivaine majeure. À savoir, un geste littéraire : parler de soi pour tendre à l’autre un miroir où se reconnaître ; puiser à sa mémoire pour élaborer « une autobiographie qui se confonde avec la vie du lecteur ».
Éd. Gallimard.
5. “La Tache”, de Philip Roth (2000)
Dans ce roman, troisième volet de la Trilogie de Newark, le grand écrivain américain déroule l’histoire de la vie du professeur de lettres classiques Coleman Silk, construite sur un immense, un sidérant secret… Une narration infaillible, porteuse d’une ironique, froide et implacable dénonciation de « la tyrannie du nous […] qui meurt d‘envie d‘absorber l‘individu ».
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Josée Kamoun (2002).
4. “La Route”, de Cormac McCarthy (2006)
Son austère lenteur et sa lugubre beauté confèrent à La Route la grâce d’un long poème métaphysique. Un chant tout ensemble initiatique et sépulcral où se trouvent condensées les obsessions et les hantises de McCarthy (1933-2023),sans cesse revisitées de livre en livre : la violence des hommes, le rude combat auquel se livrent en ce monde le Bien et le Mal.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par François Hirsch, éd. Christian Bourgois (2008).
3. “La Fin de l’homme rouge”, de Svetlana Alexievitch (2013)
Auscultation du cœur et de l’âme de « l’Homo sovieticus », un individu élevé dans l’utopie socialiste puis passé sans transition du totalitarisme à une nouvelle forme de nihilisme, La fin de l’homme rouge est sans doute le plus magistral des « romans de voix » de l’autrice biélorusse. Un grand livre d’histoire humaniste, infiniment douloureux et formidablement vivant.
Traduit du russe par Sophie Benech, éd. Actes Sud (2013).
2. “Austerlitz”, de W.G. Sebald (2001)
Mêlant étroitement fiction et réalité, narration et méditation, et porté par la voix inconsolée, infiniment émouvante de l’écrivain allemand (décédé en 2001), le destin de Jacques Austerlitz, homme déraciné, perpétuel exilé, a valeur d’interrogation dense et grave sur l’Histoire, le temps vécu comme un processus de délitement, l’opacité de la mémoire. Un chef d’œuvre.
Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau, éd. Actes Sud (2002).
1. “2666”, de Roberto Bolaño (2004)
La mort prématurée de l’écrivain chilien, en 2003, laissa ce livre, paraît-il, inachevé… On veut bien le croire, mais quel roman pourtant ! Tissant cinq fils narratifs, le magistral 2666 n’en finit pas de surprendre, de digresser, de proliférer de fascinante façon, s’autorisant tous les développements et les changements de point de vue pour méditer sans fin sur le Mal.
Traduit de l’espagnol (Chili) par Robert Amutio, éd. Christian Bourgois (2008).
RECENTS
LESSONS (Ian Mc Ewan)
Editions Gallimard
MC EWAN, ENCORE UN GRAND LIVRE, COMME “SAMEDI”
On connait mon engouement pour cet auteur britannique (comme Jonathan Coe) et notamment son “Samedi” que j’ai offert, un peu idiot, à beaucoup. Son dernier livre est splendide.
UN EXTRAIT
Extrait (p26,27,28) de “LESSONS”,
Suivre les instructions, deux, trois peut-être par seconde, mobilisait toute sa concentration. Il s’oubliait, oubliait même la professeure. Le temps et le lieu se dissolvaient. Le piano s’évanouissait et avec lui l’existence même. Ce fut comme s’il s’éveillait d’une nuit de sommeil quand il se retrouva à la fin, jouant à deux mains un simple accord ouvert. Mais il ne les retira pas, contrairement à ce que lui indiquait la brève sur la partition. L’accord résonna et s’estompa dans la petite salle aux murs nus. Il ne lâcha pas le clavier en sentant la main de l’enseignante sur sa tête, même quand elle exerça une pression pour faire pivoter son visage vers elle. Rien dans son expression n’annonçait ce qui allait suivre. Elle dit calmement : « Toi… » Alors il enleva ses mains des touches. « Toi, espèce de petit… » Dans un mouvement compliqué, elle baissa et inclina la tête, son visage se rapprochant et décrivant un arc de cercle qui se termina par un baiser, ses lèvres à elle sur les siennes, un doux baiser prolongé. Il ne résista ni ne répondit à ce baiser. C’était arrivé et il la laissa faire sans rien ressentir tant que cela dura. Après coup seulement, à force de revivre et de rejouer cet épisode seul avec lui-même, en mesura-t-il l’importance. Tant que cela dura, elle avait les lèvres sur les siennes et il attendait sans bouger que le moment passe. Puis une distraction soudaine y mit fin. Un éclair dû à une ombre ou à un geste fugitif avait traversé la fenêtre en hauteur. La professeure s’écarta pour regarder, comme lui. Ils l’avaient tous deux vu ou perçu au même instant, en lisière de leur champ de vision. Était-ce un visage, un visage réprobateur et une épaule ? Mais la petite fenêtre carrée ne leur montrait que des lambeaux de nuages et des bribes de bleu pâle hivernal. Il savait que de l’extérieur cette fenêtre était trop haute pour que même le plus grand des adultes ne l’atteigne. C’était un oiseau, probablement un pigeon du colombier des anciennes écuries. Mais professeure et élève s’étaient séparés avec un sentiment de culpabilité et, bien qu’il n’ait pas compris grand-chose, il savait qu’un secret les unissait désormais. La fenêtre vide leur avait brutalement rappelé le monde des gens du dehors. Il comprenait aussi qu’il aurait été impoli de porter la main à sa bouche pour atténuer le picotement de la salive en train de sécher. La professeure se retourna vers lui et d’une voix apaisante qui suggérait qu’elle se souciait peu de la curiosité du monde extérieur, les yeux dans les siens elle s’adressa à lui, avec gentillesse cette fois et au futur, qu’elle employa pour donner au présent un semblant de raison. Et ce fut le cas. Mais il ne l’avait jamais entendue en dire si long. « Roland, dans deux semaines il y aura une demi-journée de congé. Elle tombe un vendredi. Écoute-moi attentivement. Tu iras sur ton vélo jusqu’à mon village. Erwarton. Venant de Holbrook, c’est après le pub, à droite, une porte verte. Tu arriveras à temps pour déjeuner. Tu as compris ? » Il avait acquiescé de la tête, sans rien comprendre. Qu’il doive traverser la péninsule à vélo sur des petites routes et des chemins de terre jusqu’à son village pour déjeuner alors qu’il pouvait manger à l’internat le déconcertait. Tout le déconcertait. Dans le même temps, malgré sa confusion, ou à cause d’elle, il aspirait à être seul pour retrouver la sensation de ce baiser et réfléchir. « Je t’enverrai une carte pour te le rappeler. À partir de maintenant tu prendras tes leçons avec M. Clare. Pas avec moi. Je lui dirai que tes progrès sont exceptionnels. Donc, jeune homme, nous allons faire des gammes en majeur et en mineur avec deux dièses à la clé. »
IAN MAC EWAN

Ian McEwan est un romancier et scénariste anglais.
Il passe une grande partie de sa jeunesse en Extrême-Orient à Singapour, en Afrique du Nord (en Libye), et en Allemagne, où son père, officier écossais dans l’armée britannique, était en poste. Il fait ses études à l’Université du Sussex et l’Université d’East Anglia, où il est le premier diplômé du cours d’écriture créative créé par Malcolm Bradbury.
Ian McEwan s’impose sur la scène littéraire britannique avec des recueils de nouvelles comme “Premier amour, derniers rites” (“First Love, Last Rites”, 1975) qui remporte le prix Somerset Maugham en 1976. McEwan s’y montre fasciné par la perversion et l’interdit. Il explore tous les fantasmes les plus bizarres de la sexualité, les outrances et les excès auxquels l’amour peut conduire : crimes passionnels, crimes sadiques…
Viendront ensuite des romans et de nombreuses pièces radiophoniques. “L’enfant volé” (The Child in Time, 1987) reçoit le prestigieux Whitbread Novel Award (prix Costa) et, en France, le prix Femina étranger 1993. En 2017, le roman est adapté à la télévision avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal.
L’écrivain obtient l’un de ses plus grands succès avec “Amsterdam” (1998), un ouvrage sur l’ambition et l’adultère qui alimente la controverse. Le livre a été couronné par le Booker Prize for Fiction 1998.
Il explore le monde de l’enfance à travers ses multiples facettes, étudiant également les effets pervers et durables sur une vie d’adulte des actions commises durant l’enfance, comme par exemple dans “Expiation” (Atonement), 2001. Il s’agit de son roman le plus connu, à l’origine du film “Reviens-moi” réalisé par Joe Wright en 2007, à la réalisation duquel il participe en tant que producteur exécutif.
Son ouvrage “Dans une coque de noix” (Nutshell, 2016), va plus loin encore dans l’exploration de l’enfance, si l’on peut dire, puisqu’il lui prend la fantaisie d’imaginer les perceptions du fœtus dans le ventre maternel.
En 2017, “L’Intérêt de l’enfant” (“The Children Act”, 2014) est adapté au cinéma (titre français “My Lady”), ainsi que “Sur la plage de Chesil” (“On Chesil Beach”, 2007).
Père de deux fils, il habite dans la City de Londres près de la gare St Pancras, une vaste maison victorienne qui apparaît dans son roman “Samedi” (Saturday, 2005).
Il publie “Le cafard” en 2020, une satire du Brexit auquel il est hostile.
Ian McEwan est membre de la Royal Society of Literature, de la Royal Society of Arts
Extrait Babelio.
L’EMISSION DE FINKIELKRAUT SUR LE BOUQUIN
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/repliques/les-lecons-de-ian-mcewan-2335579
UN ARTICLE DU LOS ANGELES TIME (SUR GOOGLE, TRADUCTION AUTOMATIQUE)
https://www.latimes.com/entertainment-arts/books/story/2022-09-12/ian-mcewan-reflects-on-lessons
CINQ FEMMES, MARCEL COHEN

« Il m’est arrivé de rencontrer des hommes admirables, cependant les seuls êtres à qui j’ai conscience de tout devoir sont des femmes. Elles se sont comportées à mon égard avec tant de naturel, de détermination et l’une d’elles de courage, que j’ai pu sous-estimer longtemps à quel point rien n’allait de soi.
Orphelin et enfant caché pendant la guerre, je n’acceptais ni l’autorité des hommes qui se substituaient à mon père, ni l’attachement des femmes qui avaient les gestes de ma mère. Que l’on tentât de m’imposer une volonté ou que l’on fît preuve à mon égard de trop d’affection revenait au même : c’était insupportable et je prenais la fuite. La bonne volonté ne suffisait donc pas et, aujourd’hui encore, l’opiniâtreté des femmes dont il est question dans ce livre ne va pas sans étonnement. Tout cela a-t-il bien eu lieu comme j’en ai pourtant le souvenir très exact ? »
Marcel Cohen
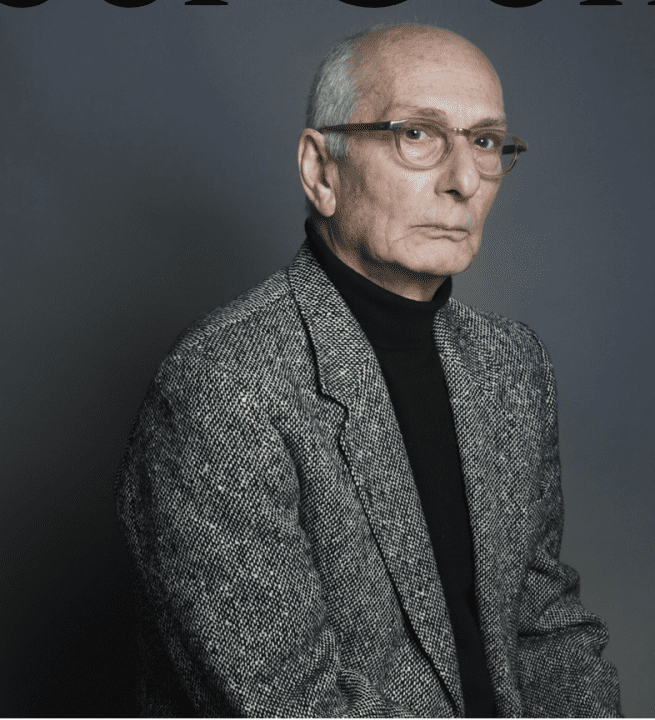
Ci-dessous WIKI sur Marcel Cohen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcel_Cohen_(écrivain)
L’AUTRE ROTH

Joseph Roth (donc pas Philip) est un immense écrivain, mort dans une chambre parisienne au-dessus du Café de Tournon, du nom de la rue, où il s’enivrait pour oublier misère et souffrances. Non peut y aller boire un verre. Leur Crozes-Hermaitage est excellent.
Roth a écrit un chef-d’œuvre, un des plus beaux livres, presque toujours a portée de ma main : ” Le poids de la grâce”. Immense. C’est son chef-d’œuvre et pas l’autre (La marche de Radesky)
En 2013, une nouvelle traduction fut publiée intitulée “ Job, roman d’un homme simple “A l’époque, pourtant très proche, les humains s’intéressaient aux mots. La profusion des idées a changé la donne, par ce trop-plein. Juste en 7 ans…Donc, j’avais passé des soirées à faire subir a des amis, du moins des personnes, de vaines envolées : cette nouvelle traduction ne me convenait pas. Elle était moins puissante, trop sèche au regard de la première, peut-être un peu dans l’enjolivure, laquelle, justement, peut être vitale. (Livre de poche). Je lisais des paragraphes et comparais les deux textes. Je devais ennuyer les convives. Sûrement. Il était déjà tard. Et ils devaient rentrer chez eux.J’ai relu aujourd’hui, avant de dormir. Je crois que j’avais raison. Mais je n’en suis plus sûr. J’attend un interlocuteur intéressé au téléphone, pour en discuter sérieusement. Lisez ce “Poids de la grâce”. Votre vie en sera bouleversée tant la beauté se terre sous les mots et le récit de Roth. Joseph…Allez en ligne pour le résumé…Job ou le poids ? Je reviens dire.
PS1. Extrait de wiki concernant Joseph Roth :il est inhumé au cimetière parisien de Thiais. L’enterrement a lieu suivant le rite « catholique-modéré » car aucun justificatif de baptême de Roth ne put être fourni. À l’occasion de l’enterrement, des groupes hétérogènes entrèrent en conflit : les légitimistes autrichiens, les communistes et les Juifs réclamèrent le défunt comme l’un des leurs.PS3. Les grands érudits pourront vous dire que Simone Weil, la philosophe catholique, a écrit un bouquin intitulé “La pesanteur et la grâce”…PS3
PS2. Je laisse juger. Première page des deux éditionS
LA PREMIÈRE : “il y a de nombreuses années……”


LA DEUXIÈME : “voici déjà bien des années….”


L’AUTRE SINGER

il n’y a pas qu’Isaac Bashevis, ils a son frère.
Beaucoup, dont un membre de ma famille ne connaissait pas le deuxième Singer, ni ses chefs-d’œuvres. Je livre donc sa présentation, incluse en tête de sa “Famille Karnovski.”
Israël Joshua Singer (1893-1944), frère aîné du Prix Nobel de littérature Isaac Bashevis Singer, est longtemps resté ignoré du grand public en France, malgré son succès outre-Atlantique : on redécouvre aujourd’hui son œuvre à la modernité inégalable. Denoël a publié en 2005 ses deux principaux romans, Yoshe le fou et Les frères Ashkenazi, puis, l’année suivante, son récit autobiographique, D’un monde qui n’est plus, suivi de La famille Karnovski en 2010, Au bord de la mer Noire et autres histoires en 2012 et De fer et d’acier en 2015.
EXTRAIT DE LA FAMILLE KARNOVSKI
“Dans l’immeuble que David Karnovski avait acheté dans le quartier ouvrier de Neukölln, les logements sont petits et bruyants. Par les nombreuses fenêtres très rapprochées les unes des autres, s’échappe un brouhaha permanent : des machines à coudre, des enfants qui pleurent, des scènes de ménage, des chiens qui aboient. Souvent, le dimanche, on peut aussi entendre sonner du clairon, c’est un soldat à la retraite, ancien membre de la fanfare militaire, qui joue un air martial.
L’unique grand appartement de la maison, calme et abrité des regards par des stores toujours baissés, même en plein jour, est celui qu’occupe le docteur Fritz Landau. Cet appartement se trouve sous le porche, au rez-de-chaussée, de telle sorte que les patients n’ont pas d’escalier à monter. Les gamins s’agglutinent près des fenêtres du cabinet médical, curieux de ce qui se passe à l’intérieur. Premièrement, le docteur Landau est le seul Juif de l’immeuble et on aimerait savoir comment se comportent ces gens-là. Deuxièmement, les malades se déshabillent, se mettent complètement nus, et pas seulement des enfants mais aussi des grandes personnes, des parents, et les gosses veulent voir à quoi ressemblent dans leur nudité les papas sévères et les mamans grondeuses. C’est surtout les femmes que les petits garçons s’efforcent d’entrevoir. Mme Krupa la gardienne, les éloigne des fenêtres à coups de balai.
À l’instar de nombreux domestiques, Mme Krupa considère comme une atteinte à sa dignité d’être concierge dans une maison peuplée de gueux. Le fait qu’un médecin habite au milieu de cette plèbe la remplit d’orgueil et elle ne permet pas à ces sales gosses de venir déranger l’appartement doctoral. Dans son courroux, elle en appelle à tous les saints :
« Sapristi ! Jésus, Marie, Joseph ! Ne venez pas chahuter sous les fenêtres du docteur ! Espèces de morveux, sales cochons, bande de voyous ! »
La seule chose qui contrarie l’estime que Mme Krupa porte au docteur, c’est que pour payer son loyer, il n’a pas la ponctualité des gens bien, il se conduit comme le bas peuple. Ça ne cadre pas avec l’idée qu’elle se fait d’un homme comme il faut, un médecin par-dessus le marché.
Un jour, alors que vers la fin du mois le docteur Landau n’avait toujours pas réglé son loyer, Mme Krupa remit l’affaire entre les mains du fils du propriétaire afin qu’il aille lui-même lui rafraîchir la mémoire comme il le faisait avec les gens du peuple quand les choses traînaient trop en longueur.
Un soir, pour la première fois depuis qu’il gérait la maison de son père, Georg Karnovski se rendit chez le docteur Landau. Sur la porte pendait un écriteau invitant les gens à entrer sans sonner. Dans le couloir étroit, une porte était ouverte. Près d’une cuisinière en fonte noircie se tenait une vieille femme occupée à tourner quelque chose dans une casserole d’où s’élevait une épaisse vapeur. Dans le couloir, il vit une longue banquette des plus ordinaires, pas rembourrée, telle qu’on en trouve dans les bistrots de campagne. Au-dessus, étaient fixées diverses pancartes : défense de fumer, défense de faire du bruit, passer dans l’ordre d’arrivée. Près d’une affiche indiquant que les crachats et autres mucosités transmettent la tuberculose, on avait accroché une deuxième mise en garde, comme quoi l’alcool et le tabac sont des poisons pour l’organisme.
Sans lever le nez de sa marmite, la femme dans la cuisine marmonna :
« Le cabinet du docteur est à droite, il faut frapper. »
Georg Karnovski frappa. Debout dans un coin, un homme d’âge moyen avec une barbe rouge cuivre sur une blouse blanche se savonnait les mains au-dessus d’une cuvette après le départ du dernier patient. Sans même tourner la tête vers le nouveau venu, il ordonna d’une voix de basse :
« On se déshabille, on se déshabille ! »
Georg sourit.
« Je suis Karnovski, le fils du propriétaire. Je viens au sujet du loyer. Je suis en bonne santé. »
Le docteur s’essuya les mains, remit rapidement sa barbe rousse en ordre et examina Georg de la tête aux pieds à travers ses épais verres de lunettes.
« Ça, jeune homme, si vous êtes en bonne santé oui ou non, c’est à moi de le dire. Vous ne pouvez jamais savoir ça tout seul. »
Georg se sentit ridicule. Le courage dont il s’était armé peu de temps auparavant pour venir réclamer le loyer s’envola d’un coup. Le docteur Landau cachait dans sa barbe un sourire enfantin.
« Hm, vous voulez de l’argent, jeune homme, pas vrai ? Ma foi, oui, ça n’est pas nouveau. C’est ce que tout le monde veut. Le problème c’est : où le trouver ? »
Voyant que le docteur plaisantait, Georg reprit de l’assurance.
« Je crois que vous avez une grosse clientèle, docteur. Je vois souvent les malades faire la queue sous le porche. »
Le docteur répliqua aussitôt :
« Les patients de Neukölln sont généreusement pourvus de maladies et chichement de marks. À certains, il faut même parfois donner quelque chose. »
LES MEILLEURS LIVRES CLASSIQUES DE TOUS LES TEMPS (LUS)
CERVANTES, DON QUICHOTTE
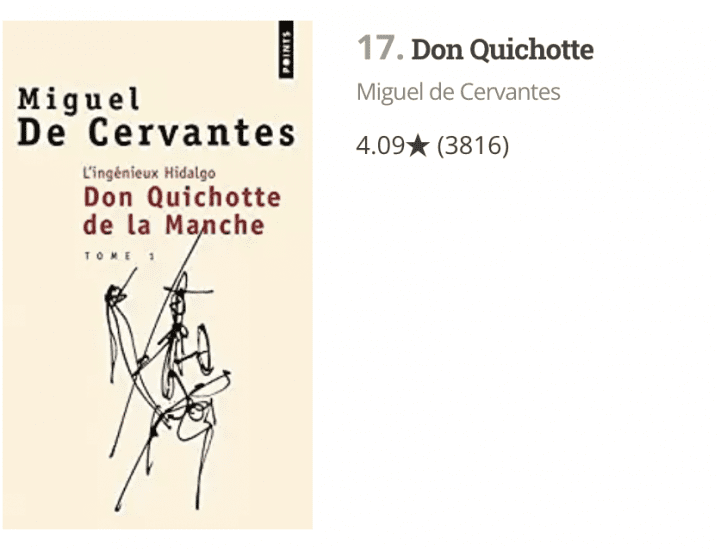
Un gentilhomme a lu tellement de livres de chevalerie qu’il en perd l’esprit. Il se nomme maintenant Don Quichotte et part à l’aventure avec un laboureur, Sancho Panza. Ils rencontreront des géants, à moins que ce ne soient des moulins à vent, et des armées en bataille, sauf si ce n’étaient que des troupeaux de moutons… Certains tenteront de l’aider, d’autres se moqueront de lui, mais Don Quichotte finira par retrouver la raison, entouré de ses amis. D’après le célèbre roman de Miguel de Cervantès, les tout-petits suivront les aventures de Don Quichotte, de manière adaptée, simple, et en même temps les parents pourront aussi (re)découvrir ce classique intemporel.”
LE PERE GORIOT
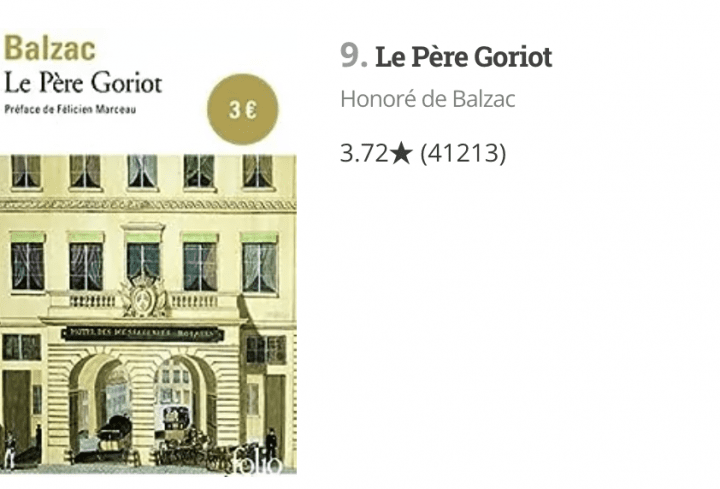
La maison Vauquer est une pension parisienne où se côtoient des résidents que tout oppose, et pourtant inexorablement liés : Rastignac, un jeune étudiant en droit, le Père Goriot, un ancien fabriquant de vermicelles, ou encore le mystérieux Vautrin.
Tous ont leurs secrets et leurs faiblesses : Rastignac, obsédé par la haute société, délaisse ses études pour tenter de s’y intégrer ; Vautrin cache un passé douloureux ; le Père Goriot s’est ruiné pour ses filles ingrates.
La maison Vauquer s’apparente alors à une peinture de cette époque, un cliché de personnages aussi différents qu’unis, criants de vérité, acteurs d’une comédie humaine.
DOSTOÏEVSKI, CRIME ET CHATIMENT

Seul l’être capable d’indépendance spirituelle est digne des grandes entreprises. Tel Napoléon qui n’hésita pas à ouvrir le feu sur une foule désarmée, Raskolnikov, qui admire le grand homme, se place au-dessus du commun des mortels. Les considérations théoriques qui le poussent à tuer une vieille usurière cohabitent en s’opposant dans l’esprit du héros et constituent l’essence même du roman. Pour Raskolnikov, le crime qu’il va commettre n’est que justice envers les hommes en général et les pauvres qui se sont fait abusés en particulier. “Nous acceptons d’être criminels pour que la terre se couvre enfin d’innocents”, écrira Albert Camus.
Mais cet idéal d’humanité s’accorde mal avec la conscience de supériorité qui anime le héros, en qualité de “surhomme”, il se situe au-delà du bien et du mal. Fomenté avec un sang-froid mêlé de mysticisme, le meurtre tourne pourtant à l’échec. Le maigre butin ne peut satisfaire son idéal de justice, tandis que le crime loin de l’élever de la masse, l’abaisse parmi les hommes. Raskolnikov finira par se rendre et accepter la condamnation, par-là même, il accédera à la purification. Crime et Châtiment est le roman de la déchéance humaine, l’oeuvre essentielle du maître de la littérature russe. –Lenaïc Gravis et Jocelyn Blériot
DOSTOÏEVSKI, LES FRERES KARAMAZOV

LOUIS GUILLOUX, “LE SANG NOIR
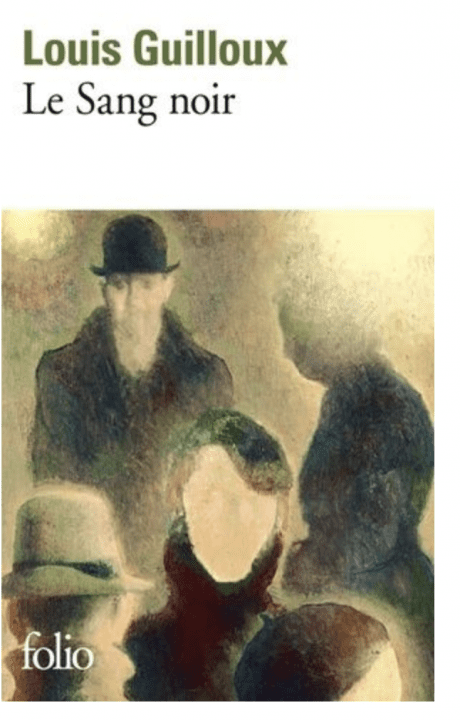
Le Sang noir se situe en 1917, année terrible où les morts fauchés par la guerre ne se comptent plus. À Saint-Brieuc, le professeur de morale Merlin, surnommé par ses étudiants « Cripure de la raison tique » parce qu’il évoque souvent la Critique de la raison pure, a perdu nombre d’illusions. Il vomit les sornettes patriotiques quotidiennement vociférées par les « aigrefins » et les « ganaches », militaristes de l’arrière. Il aime son pays mais pas ceux qui, en son nom, pérorent sur les morts glorieuses des jeunes soldats. Et s’il fait parfois semblant de partager le sentiment de beaucoup, on le soupçonne quand même de ne pas y croire. C’est un formidable roman que Louis Guilloux (1899-1980) écrivit la rage au cœur contre l’hypocrisie qui se pare de bons sentiments. Publié en 1935, il est l’un des grands textes de l’entre-deux-guerres. GL
PAGNOL, LA GLOIRE DE MON PERE

Souvenirs d’enfance est une série de quatre romans autobiographiques de Marcel Pagnol.
1957 : La Gloire de mon père – 1957 : Le Château de ma mère – 1960 : Le Temps des secrets – 1977 : Le Temps des amours, inachevé, publication posthume
L’idée d’écrire ces souvenirs est née lorsqu’un magazine féminin demanda à Pagnol une nouvelle pour son numéro de Noël. Pagnol écrivit donc l’histoire des quatre châteaux (que l’on retrouve à la fin du second tome). Ce récit éveilla en lui l’envie d’en raconter plus, et il entreprit ce qui, au départ, devait être une trilogie (l’édition originale du Château de ma mère annonce l’ouvrage suivant, Les Grandes Amours, « suite et fin des souvenirs d’enfance »).
Source : Wikipedia
JORIS-KARL HUYSMANS, A REBOURS
Au fil du temps, rien n’émousse la singularité de ce livre, publié en 1884, sur la réclusion obsessionnelle d’un excentrique nommé Des Esseintes. C’est Oscar Wilde qui le définit le mieux, en mettant le volume dans les mains de Dorian Gray : « Il s’y trouvait des métaphores aussi monstrueuses que des orchidées et aussi subtiles de couleurs. La vie des sens y était décrite dans des termes de philosophie mystique. On ne savait plus par instants si on lisait les extases spirituelles d’un saint du Moyen Âge ou les confessions morbides d’un pécheur moderne. C’était un livre empoisonné. » — M.L. Télérama
La Bible de l’esprit décadent et de la “charogne” 1900. À travers le personnage de des Esseintes, Huysmans n’a pas seulement résumé, immortalisé les torpeurs, les langueurs, les névroses vénéneuses et perverses du siècle finissant. Des Esseintes est aussi un héros kierkegaardien, à la fois grotesque et pathétique, une des plus fortes figures de l’angoisse qu’ait laissées notre littérature. Fils spirituel de René et de la génération du mal du siècle, il annonce à bien des égards le Bardamu de Céline et le Roquentin de “La Nausée”.”
Huysmans crée ici un personnage fascinant, des Esseintes, qui représente ce qu’on a appelé “la décadence“; dégoûté de la vulgaire réalité, il cherche désespérément, en recourant sans cesse à l’artifice, des sensations rares et des plaisirs toujours nouveaux, jusqu’à l’hallucination, presque jusqu’à la folie.
Dans le tohu-bohu qui accompagna la publication d'”À rebours” en 1884, Barbey d’Aurevilly écrivait : “Après un tel livre, il ne reste plus à l’auteur qu’à choisir entre la bouche d’un pistolet ou les pieds de la croix”. Huysmans lui donna raison en se convertissant peu après.
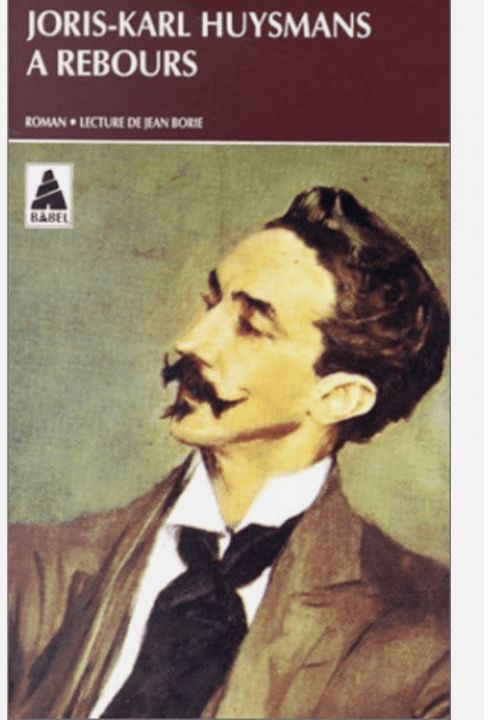
FAULKNER, LE BRUIT ET LA FUREUR
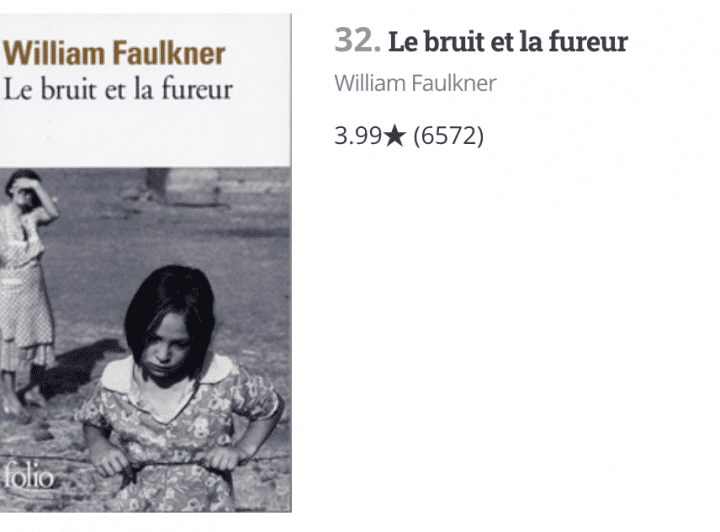
C’est avec cet ouvrage explosif que William Faulkner fut révélé au public et à la critique. Auteur de la moiteur étouffante du sud des États-Unis, Faulkner a réellement bouleversé l’académisme narratif en plaçant son récit sous le signe du monologue intérieur, un monologue d’abord “confié” à un simple d’esprit passablement dépassé par les événements qui se déroulent autour de lui.
Confusément, les images qui lui parviennent font remonter ses souvenirs: il brosse de façon impressionniste et chaotique l’histoire douloureuse de sa famille. Vient ensuite le moment d’écouter les confessions de Quentin, son frère, exposant les raisons qui le pousseront à se donner la mort.
D’amours déçues en déchirements, la fratrie (qui compte un troisième membre ayant lui aussi son monologue) se désagrège. Jouant subtilement avec les différences de registres en passant d’un personnage à l’autre, Faulkner conclut en tant que narrateur extérieur ce roman violent, où chacun se débat tant bien que mal sans réellement pouvoir se soustraire à un destin funeste. Lenaïc Gravis & Jocelyn Blériot
HENRY JAMES, LES AMBASSADEURS
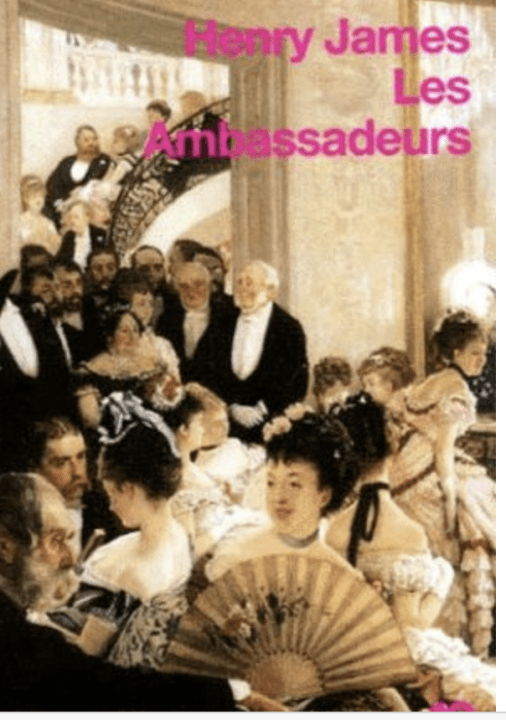
Henry James (1843-1916) lui-même considérait comme son chef-d’œuvre ce roman tardif, dans lequel se déploie la patiente description du trouble intérieur qui s’empare de Lewis Lambert Strether, un Bostonien d’âge mûr qu’un séjour à Paris plonge dans un profond chaos émotionnel. On est effectivement, avec ces Ambassadeurs, au sommet de l’esthétique jamesienne, ultrasophistiquée, inépuisable de nuances. Et dans un exercice de pénétration psychologique d’une acuité inouïe, que l’écrivain exhausse en une méditation sans fin sur l’opacité de la vie psychique des individus, sur l’ambiguïté morale qui préside à leurs actes et à leurs pensées. — Na.C.
Les Ambassadeurs est considéré comme le roman le plus important d’Henry James. C’est en tout cas celui où se trouve exposé le plus clairement le conflit entre une Amérique puritaine, moralisante, bref “bostonienne,” mais innocente, et la tradition de culture que l’Europe a héritée de l’Antiquité avec ses vices comme ses vertus.
ITALO STEVO, UNE VIE
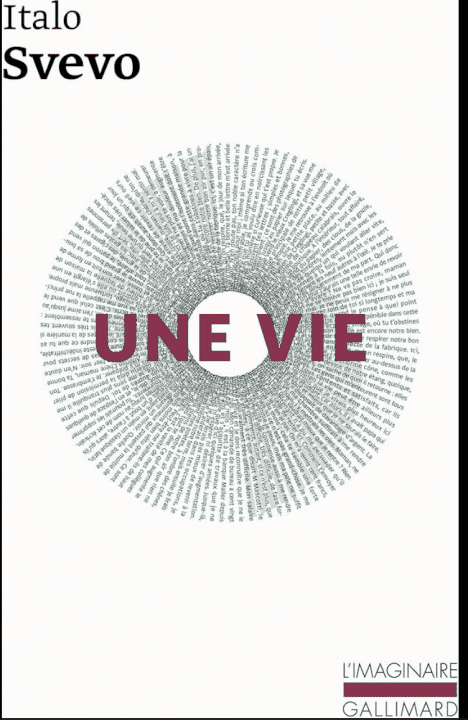
Une édition “QUARTO” ayant été publiée regrou^pant les chefs-d’oeuvre de Stevo, on comme l’articler du Monde ( Geneviève Brisac) qui la présente
“Une vie”, “Senilità”, “La Conscience de Zeno” d’Italo Svevo : la dernière cigarette d’Italo Svevo
Les trois romans du grand écrivain triestin sont pour la première fois réunis en “Quarto”.
La vie d’Italo Svevo fut largement consacrée à s’empêcher d’écrire l’oeuvre de génie dont il se savait habité. De ce génie, il eut toujours peur. Comme il avait peur de tout.
Il naquit sous le nom d’Aron Ettore Schmitz, le 19 décembre 1861 à Trieste (qui faisait alors partie de l’Empire austro-hongrois), et mourut le 13 septembre 1928, à Trieste (qui faisait désormais partie de l’Italie). Les pays valsaient, le monde basculait. Il songeait. Soixante-sept longues années à peu près immobiles, point d’aventures, presque pas de guerre : une succession d’échecs littéraires, une vie de bureau, de mélancolie profonde, d’hypocondrie caractérisée (et cinquante ans de tabagisme).
Sa famille juive italo-autrichienne est la clé de son pseudonyme : Italo Svevo, le plus impersonnel qui soit – “l’Italien souabe” -, occultant de manière significative ses origines juives, que les éditions françaises de ses livres effaçaient d’ailleurs, jusqu’à aujourd’hui.
Comme tous les écrivains, il a eu, pour commencer, peur de l’insuccès. Avec raison : son premier livre, Une vie, d’abord titré Un incapable, parut en 1892 dans une indifférence assourdissante. C’est un livre stendhalien, ultramoderne. L’histoire d’un petit employé angoissé et pauvre qui séduit, par le biais de la littérature, la fille de son patron et se suicide quand il découvre qu’il va devoir l’épouser. L’écriture ironique et subtile d’Une vie se moque des clichés et des lieux communs, à travers la rédaction d’un roman à quatre mains, écrit par le narrateur et sa patronne, Annetta.
L’échec littéraire est la hantise de Svevo. Elle l’affecte si profondément qu’elle porte atteinte à sa santé. Il vaut donc mieux ne pas écrire. Deuxième raison à ce “I would prefer not to” (le célèbre “Je préférerais ne pas” du Bartleby de Melville) : s’il s’abandonne au plaisir d’écrire – ce qu’il ne peut en vérité vraiment s’empêcher de faire -, il est immédiatement moins apte au travail pratique, car il devient distrait et inefficace. “Ce n’est pas l’activité qui me rend vivant, c’est le rêve”, explique-t-il à sa femme.
Pour barrer le chemin à la littérature, après l’échec de Senilità, il décide, à 40 ans, de consacrer son temps libre au violon, deux heures par jour. Une torture pour sa famille et ses voisins. Une volonté de fer n’est pas le moindre défaut de ce soi-disant aboulique, toujours en train de commencer une nouvelle cure miracle, un traitement médical, un régime draconien. Mais la guerre arrive. Contraint à l’inactivité, Svevo se remet à écrire autre chose que des lettres (sublimes) ou un journal intime (désopilant et profond). Le livre lui prend huit ans.
La Conscience de Zeno paraît en 1923. Svevo a 62 ans. C’est l’autobiographie d’un certain Zeno, publiée par son psychanalyste, et assortie de considérations peu flatteuses sur la personnalité du patient – “Je le publie par vengeance et j’espère, dit le docteur S., qu’il en sera furieux.” Svevo sait que c’est un chef-d’oeuvre, un livre absolument original, il est stupéfait et bouleversé par son échec – à raison. A nouveau, il cesse d’écrire. “C’est décidément trop mauvais pour ma santé”, explique-t-il, après avoir remué ciel et terre, non sans maladresses et flagorneries inutiles. Il écrit même à James Joyce, son vieil ami, censé le soutenir, comme il l’a lui-même soutenu quand il était dans la peine. Mais ils n’ont pas le même caractère. Valéry Larbaud, qui l’admire pourtant, ne répond pas non plus à ses courriers.
Tel un Franz Kafka qui aurait décidé de se marier malgré ses obsessions et sa culpabilité ; tel un Marcel Proust amoureux de la très blonde Livia Veneziani ; ou tel un James Joyce soudainement attentif aux autres, Italo Svevo décrit une vie impossible, un monde où nous trébuchons sans cesse, en butte à la cruauté et à la violence de nos déceptions, de nos arrière-pensées, de notre inconscient, et à la fascination qu’exercent sur nous nos propres sensations, nos propres intentions, nos propres faux mouvements. La brutalité des êtres.
Ainsi cette jeune personne avec qui un de ses héros, âgé de 67 ans, a une liaison onéreuse dans le but explicite de tromper Mère nature, qui ne garde en vie que ceux qui sont en état de procréer. Elle lui murmure à l’oreille : “Tu sais que tu ne me dégoûtes pas.” “Toi non plus”, répond-il gentiment. Découvrez les ateliers d’écriture organisés avec « Le Monde des livres » Le Monde Ateliers
Italo Svevo est convaincu que la vie est pleine de choses redoutables : les gestes les plus simples sont compliqués, la santé est un bien sans cesse menacé, la paix impossible à atteindre, et chaque journée un enfer. Il est – en un mot – un méfiant. Peut-être fut-il toujours vieux, lui l’auteur de Senilità, et du Vieillard, une revendication qui est au fond la pire des provocations, et le rend éternellement juvénile. “La bombe Svevo”, disait l’écrivain Roberto Balzen, qui l’avait découvert.
Pour plus de sûreté, il rédige lui-même peu de temps avant de mourir (d’un accident de voiture, on ne saurait penser à tout) un profil autobiographique d’Italo Svevo. Et comme ce texte, aussi précis que désopilant, fait partie des romans qui viennent de reparaître dans une édition annotée, préfacée et largement retraduite par Mario Fusco, nous pouvons y piocher quelques remarques.
“Italo Svevo, annonce-t-il, fit des études sérieuses et reçut le grand don d’apprendre à rire de la vie, au lieu d’en mourir.” Après avoir fait son droit, il choisit en 1886, l’étude de la chimie (comme Primo Levi : la chimie, cet art des timides et des modestes) pour devenir finalement employé de banque. Et c’est, alors, pour la première fois, à 25 ans, qu’il décide d’arrêter de fumer. Arrêter de fumer. La grande affaire de cette vie d’homme d’affaires efficace, de commerçant doué, de violoniste médiocre mais entêté, d’amant, de père, de mari. Oui, tout cela ne comptait qu’à moitié, il y avait un vrai combat, et c’était celui-là. Arrêter de fumer comme métaphore de sa lutte avec la littérature.
Comme les trois antihéros de ses trois livres, Alfonso Nitti (Une vie), Emilio Brentani (Senilità) et surtout Zeno (La Conscience de Zeno), Italo Svevo passe continuellement des propos les plus héroïques aux défaites les plus surprenantes. Il se marie et aime quand il ne voudrait pas, ne travaille pas quand il devrait le faire et travaille quand on ne lui demande rien. Il adore son père et lui fait une vie et une mort très malheureuses.
L’homme devrait pouvoir vivre deux vies, note Italo Svevo, pour éviter ces sempiternelles contradictions : l’une pour lui-même, et l’autre pour les autres. Quelle bonne idée.
UNE VIE (UNA VITA), SENILITÀ, LA CONSCIENCE DE ZENO (LA COSCIENZA DI ZENO)
d’Italo Svevo. Edition établie et présentée par Mario Fusco, traductions de l’italien de Mario Fusco, Georges Piroué et Paul-Henri Michel. Gallimard, “Quarto”, 910 p., 22 €.
Geneviève Brisac
FLAUBERT, MADAME BOVARY
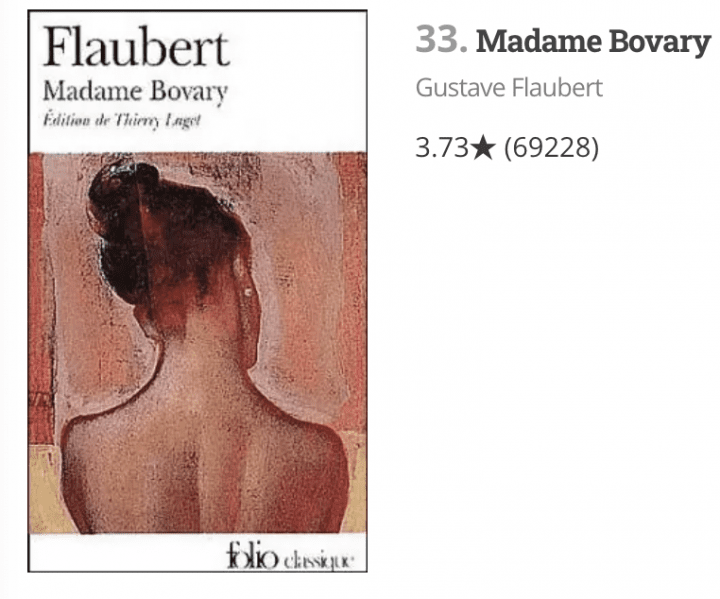
Il y a peu de femmes que, de tête au moins, je n’aie déshabillées jusqu’au talon. J’ai travaillé la chair en artiste et je la connais. Quant à l’amour, ç’a été le grand sujet de réflexion de toute ma vie. Ce que je n’ai pas donné à l’art pur, au métier en soi, a été là et le cœur que j’étudiais c’était le mien.” Flaubert défend ainsi son œuvre dans une lettre à sa maîtresse, Louise Collet. L’amour si quotidien de Charles Bovary, les passions tumultueuses de sa femme Emma étaient décrites avec tant de réalisme que l’auteur et l’imprimeur furent traînés en justice pour offense publique à la morale et à la religion. On les acquitta. Flaubert n’avait peint que la réalité, les moisissures de l’âme. Une femme, mal mariée, dans une petite ville normande, rêve d’amour et le trouve.
GARCIA MARQUEZ, CENT ANS DE SOLITUDE
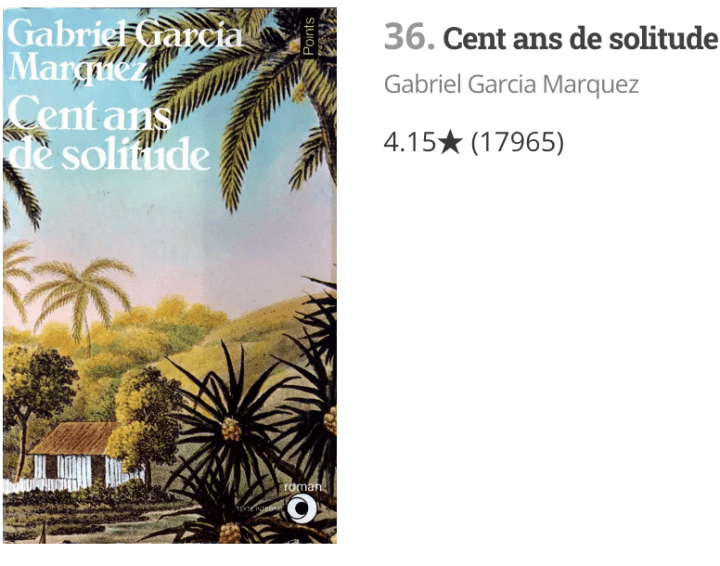
À Macondo, petit village isolé d’Amérique du Sud, l’illustre famille Buendia est condamnée à cent ans de solitude par la prophétie du gitan Melquiades… Dans un tourbillon de révolutions, de guerres civiles, de fléaux et de destructions, elle vit une épopée mythique, à la saveur inoubliable, qui traverse les trois âges de la vie : naissance, vie et décadence… Ce roman époustouflant est un chef-d’œuvre du XXe siècle.
Né en 1928 en Colombie, Gabriel García Marquez a obtenu le prix Nobel de littérature en 1982.
Traduit de l’espagnol (Colombie) par Claude et Carmen Durand
Prix Nobel de littérature
KAFKA, LE PROCES
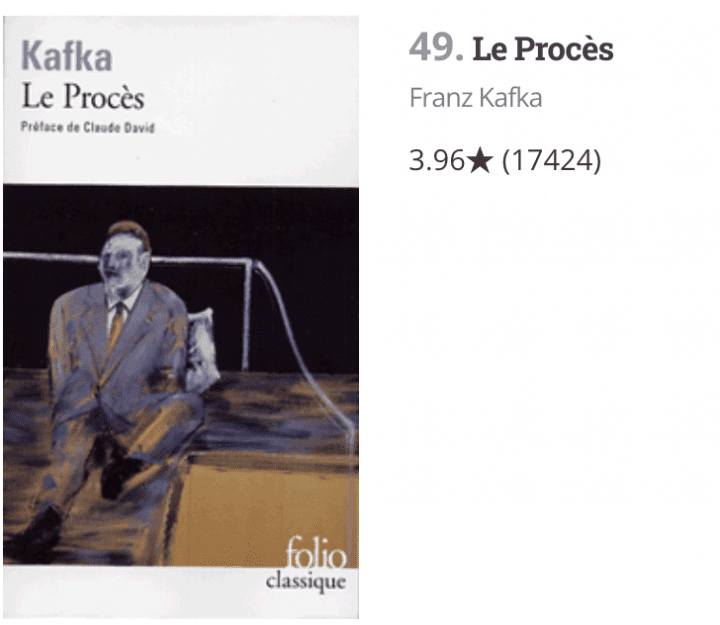
Le jour de son arrestation, K. ouvre la porte de sa chambre pour s’informer de son petit-déjeuner et amorce ainsi une dynamique du questionnement qui s’appuie, tout au long du roman, sur cette métaphore de la porte. Accusé d’une faute qu’il ignore par des juges qu’il ne voit jamais et conformément à des lois que personne ne peut lui enseigner, il va pousser un nombre ahurissant de portes pour tenter de démêler la situation. À mesure que le procès prend de l’ampleur dans sa vie, chaque porte ouverte constitue une fermeture plus aliénante sur le monde de la procédure judiciaire, véritable source d’enfermement et de claustrophobie. L’instruction suit son cours sur environ un an durant lequel l’absence d’événements est vue uniquement à travers les yeux de K. Sa lucidité, dérisoire et inutile jusqu’à la fin, contrairement à celle du héros de “La Métamorphose”, n’apporte aucun soulagement. Le Procès, pièce charnière dans l’oeuvre de ce génie de l’absurde, renonce au ressort du surnaturel pour évoquer l’angoisse de l’obsession. –Sana Tang-Léopold Wauters
KAFKA, LE CHATEAU
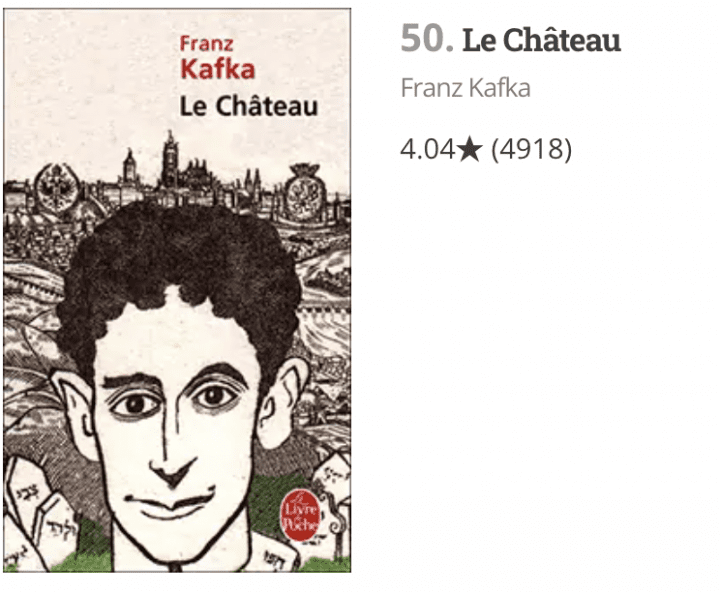
K. cherche à rencontrer son employeur afin de prendre ses fonctions. Quoi de plus courant ? A l’image de cette motivation, le langage de Kafka est simple et sobre, contrairement aux péripéties engendrées par ce désir pourtant banal, mais dont la réalisation dépend du château. Cet édifice surplombe le village et en abrite toute l’administration. Trônant sur le destin de tous les habitants, il est impénétrable et, comme tout ce qui sert de point de référence à la quête de K., est investi d’une autorité que personne ne mesure vraiment. Dans cet univers en apparence immuable, même le temps échappe à la compréhension du héros pathétique, dont les repères sont de plus en plus intangibles et fluctuants. Mais K. est-il vraiment à plaindre, lui qui refuse de fuire et persiste à vouloir s’intégrer dans cette logique, insaisissable pour l’étranger comme pour l’autochtone ? Dans ce roman qui, par son travail sur le permanent et le fluctuant, atteint à un équilibre prodigieux entre la claustrophobie et le vertige, Kafka met en scène de manière saisissante la montée progressive de l’angoisse. On comprend alors que Rushdie s’en soit inspiré pour Grimus, réflexion sur la valeur identitaire de l’obsession. –Sana Tang-Léopold Wauters
DORIS LESSING, LE CARNET D’OR
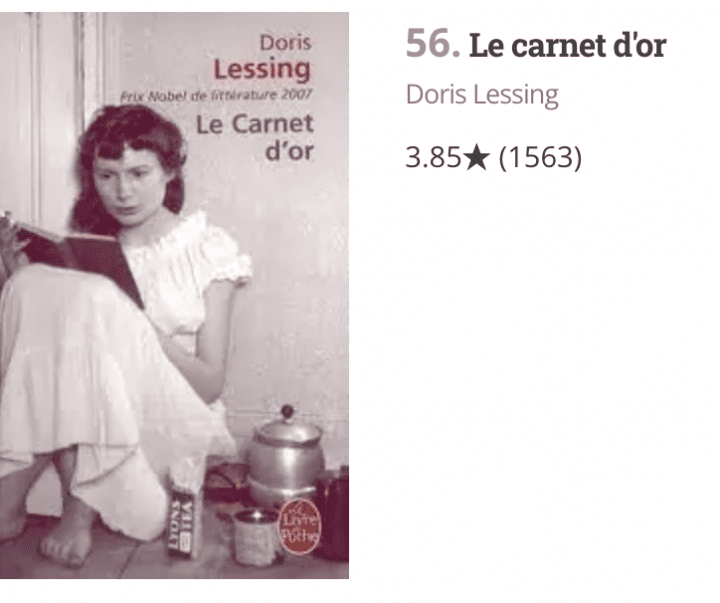
“On ne dira jamais assez combien ce livre a compté pour les jeunes femmes de ma génération. Il a changé radicalement notre conscience.” J.C Oates.
La jeune romancière Anna Wulf, hantée par le syndrome de la page blanche, a le sentiment que sa vie s’effondre. Par peur de devenir folle, elle note ses expériences dans quatre carnets de couleur. Mais c’est le cinquième, couleur or, qui sera la clé de sa guérison, de sa renaissance.
MELVILLE, MOBY DICK
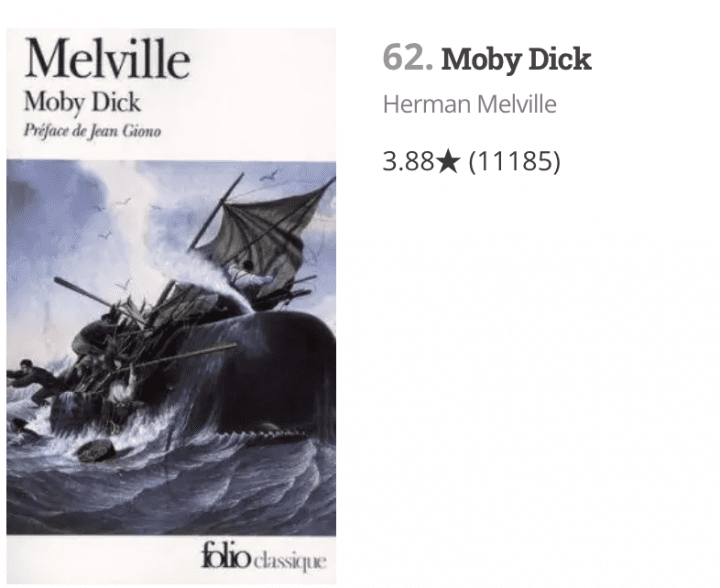
Moby Dick, c’est la monstrueuse baleine blanche, l’incarnation du Mal, cette figure de l’obsession et du double qui, des profondeurs glacées, accompagne le capitaine Achab habitué en surface aux combats titanesques des océans. Moby Dick est ce chef-d’œuvre total que tout le monde peut lire comme le plus formidable des romans d’aventures ; la quête aussi d’une humanité embarquée de force à bord d’une histoire qui reste pour elle un mystère…
(Catalogue de l’éditeur)
——————————————————-
Avec Moby Dick, Melville a donné naissance à un livre-culte et inscrit dans la mémoire des hommes un nouveau mythe : celui de la baleine blanche. Fort de son expérience de marin, qui a nourri ses romans précédents et lui a assuré le succès, l’écrivain américain, alors en pleine maturité, raconte la folle quête du capitaine Achab et sa dernière rencontre avec le grand cachalot. Véritable encyclopédie de la mer, nouvelle Bible aux accents prophétiques, parabole chargée de thèmes universels, Moby Dick n’en reste pas moins construit avec une savante maîtrise, maintenant un suspense lent, qui s’accélère peu à peu jusqu’à l’apocalypse finale. L’écriture de Melville, infiniment libre et audacieuse, tour à tour balancée, puis hachée au rythme des houles, des vents et des passions humaines, est d’une richesse exceptionnelle. Il faut remonter à Shakespeare pour trouver l’exemple d’une langue aussi inventive, d’une poésie aussi grandiose. –Scarbo
“la phrase de Melville est à la fois un torrent, une montagne, une mer.(…) Mais comme à la montagne, le torrent ou la mer, cette phrase roule, s’étire et retombe avec tout son mystère. Elle emporte ; elle noie. Elle ouvre le pays des images dans les profondeurs glauques où le lecteur n’a plus que des mouvements sirupeux, comme une algue.(…) Toujours elle propose une beauté qui échappe à l’analyse mais frappe avec violence.”
Jean Giono
LE LIVRE DE L’INTRANQUILLITE
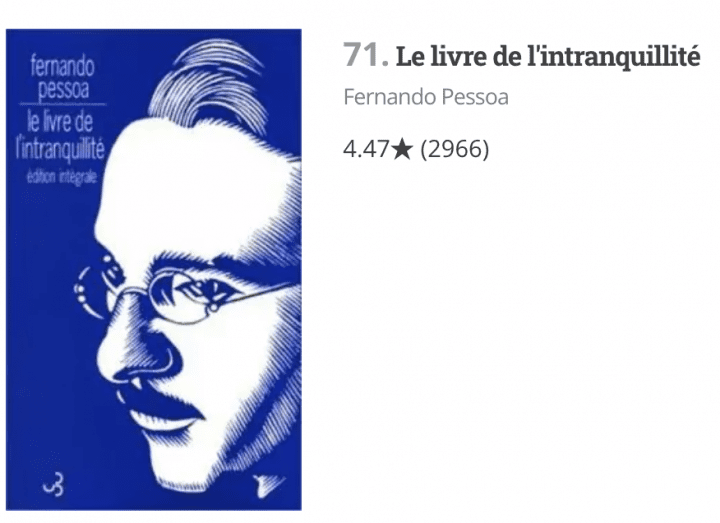
« En ces heures où le paysage est une auréole de vie, j’ai élevé, mon amour, dans le silence de
mon intranquillité, ce livre étrange… » qui alterne chronique du quotidien et méditation
transcendante. Le livre de l’intranquillité est le journal que Pessoa a tenu pendant presque toute sa vie, en l’attribuant à un modeste employé de bureau de Lisbonne, Bernardo Soares. Sans ambition terrestre, mais affamé de grandeur spirituelle, réunissant esprit critique et imagination déréglée, attentif aux formes et aux couleurs du monde extérieur mais aussi observateur de « l’infiniment petit de l’espace du dedans », Bernardo Soares, assume son “intranquillité” pour mieux la dépasser et, grâce à l’art, aller à l’extrémité de lui-même, à cette frontière de notre condition ou les mystiques atteignent la plénitude « parce qu’ils sont vidés de tout le vide du monde ». Il se construit un univers personnel vertigineusement irréel, et pourtant plus vrai en un sens que le monde réel.
Le livre de l’intranquillité est considéré comme le chef-d’oeuvre de Fernando Pessoa.
RUSHDIE, LES ENFANTS DE MINUIT
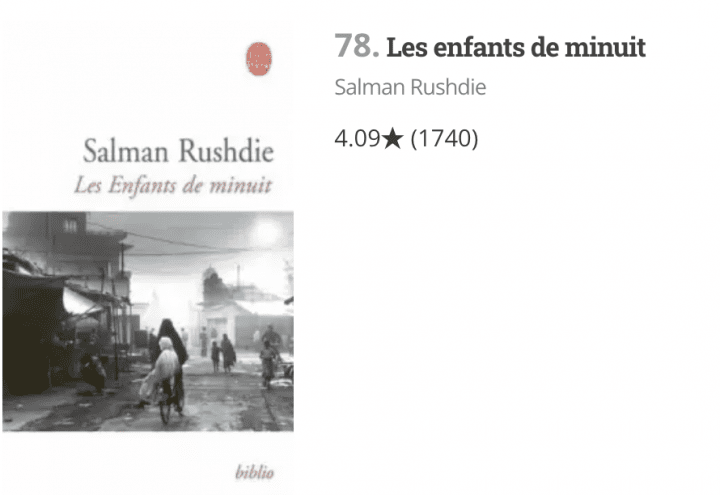
Saleem Sinai, le héros de cet extraordinaire roman picaresque, est né à Bombay le 15 août 1947, à minuit sonnant, au moment où l’Inde accède à l’indépendance. Comme les mille et un enfants nés lors de ce minuit exceptionnel, il est doté de pouvoirs magiques et va se retrouver mystérieusement enchaîné à l’histoire de son pays. “J’ai été un avaleur de vies, dit-il, et pour me connaître, moi seul, il va vous falloir avaler également l’ensemble.” Alors se déroule sous nos yeux l’étonnante et incroyable histoire de la famille Sinai : disputes familiales, aventures amoureuses, maladies terribles, guérisons miraculeuses – un tourbillon de désastres et de triomphes…
Ce récit baroque et burlesque est aussi un pamphlet politique impitoyable.
Élu en 2008 meilleur Booker Prize de l’histoire du prestigieux prix anglais, ce roman paru en 1980 a profondément influencé la littérature anglo-saxonne des trente dernières années.
VIRGINIA WOOLF, MRS DALLOWAY
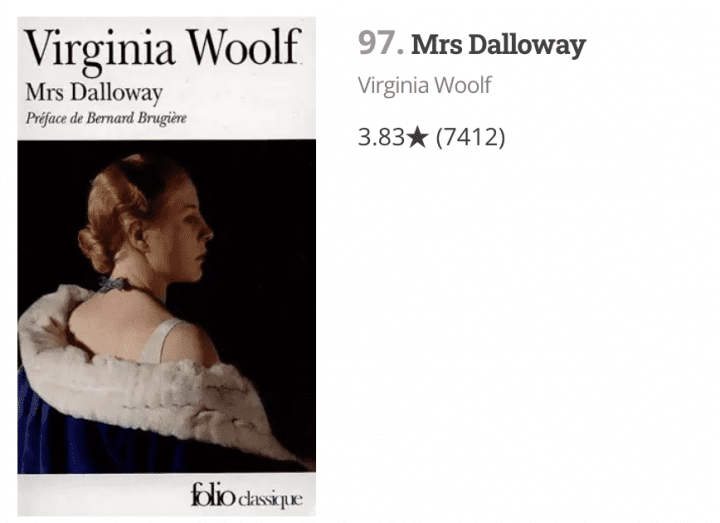
Le roman, publié en 1925, raconte la journée d’une femme élégante de Londres, en mêlant impressions présentes et souvenirs, personnages surgis du passé, comme un ancien amour, ou membres de sa famille et de son entourage. Ce grand monologue intérieur exprime la difficulté de relier soi et les autres, le présent et le passé, le langage et le silence, le mouvement et l’immobilité. La qualité la plus importante du livre est d’être un roman poétique, porté par la musique d’une phrase chantante et comme ailée. Les impressions y deviennent des aventures. C’est pourquoi c’est peut-être le chef-d’œuvre de l’auteur – la plus grande romancière anglaise du XXe siècle.
VIRGINIA WOOLF, VERS LE PHARE
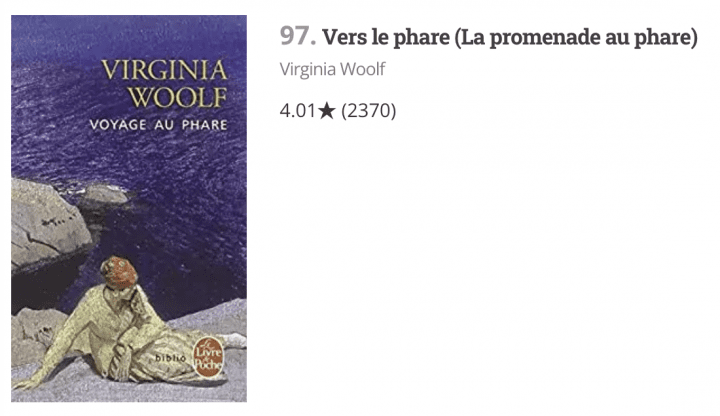
Autres titres : Voyage au phare – Au phare
Une soirée d’été sur une île au large de l’Ecosse. Pôle de convergence des regards et des pensées, Mrs Ramsay exerce sur famille et amis un pouvoir de séduction quasi irrésistible. Un enfant rêve d’aller au Phare. L’expédition aura lieu un beau matin d’été, dix ans plus tard. Entre©temps, mort et violence envahissent l’espace du récit. Au bouleversement de la famille Ramsay répond le chaos de la Première Guerre mondiale. La paix revenue, il ne reste plus aux survivants désemparés, désunis, qu’à reconstruire sur les ruines.
ON NE PEUT S’EMPECHER DE RAJOUTER DES QU’IL S’AGIT DE WOOLF. JE COLLE UN VIEL ARTICLE DE TELERAMA SUR SON DESTIN, ECRIT EN 2008
Virginia Woolf, une vie à vau-l’eau
La romancière Virginia Woolf se sentait hors du monde mais savait dévoiler les errements de l’intime et partager son vague à l’âme. Celui d’une femme toujours attirée par ses propres extrêmes, idéaliste et lucide, rêveuse et acharnée, jusqu’à la mort.
Par Marine Landrot
Publié le 12 juillet 2008 à 00h00
Mis à jour le 08 décembre 2020 à 10h26
“Chaque livre de Virginia Woolf s’ouvre immanquablement par la fin. Il ne peut en être autrement, elle l’a voulu, l’a décidé, le 28 mars 1941, à 59 ans. Ce matin-là, sa silhouette à la Modigliani disparaît volontairement dans les eaux glacées de l’Ouse en crue. Les lourdes pierres placées au fond des poches du manteau de fourrure. La fine canne abandonnée sur la rive grumeleuse. La chaleureuse lettre d’adieu laissée à Leonard, futur veuf (« je suis en train de devenir folle, j’en suis certaine »). Ces accessoires figurent à jamais dans la vitrine bien astiquée de la mémoire collective. Tragiquement connu, au point d’effacer l’œuvre, de l’engloutir, tout du moins de la délaver ou de la déformer, ce suicide fait aujourd’hui écran. Impossible d’entrer sans y penser dans l’écriture abyssale, vibrionnante, au bord de l’expérience limite, de Virginia Woolf. Impossible de ne pas guetter les signes annonciateurs de cette noyade délibérée dans ses journaux intimes comme dans ses romans, deux faces opposées d’un même miroir dont la romancière n’a jamais aimé le reflet : « Eh bien, voyez-vous, je ne vaux rien en tant qu’écrivain, je suis démodée, vieille ; ne puis faire aucun progrès, manque de discernement », se plaint-elle vingt ans avant sa mort.
Les indices sont nombreux dans ses longues phrases ondoyantes, résolument aquatiques. Commençons par la fin, donc. Feuilletons à rebrousse-pages son Journal intégral, plongeons dans les remous des derniers jours. « Curieuse impression de bord de mer aujourd’hui […] Chacun s’arcboutant, luttant contre le vent, saisi, réduit au silence. Entièrement vidé de sa chair », consigne-t-elle le 24 mars 1941, quatre jours avant le saut final. Six ans plus tôt, le 4 septembre 1935 : « Oh, quel déluge ! J’ai étrenné mon parapluie pour traverser le jardin. Nous avons vu un serpent manger un crapaud : il en avait déjà avalé la moitié. De temps à autre, il aspirait. Le crapaud lentement disparaissait. L. a tâté, du bout du bâton, la queue du serpent qui a vomi le crapaud en bouillie, et moi j’ai rêvé d’hommes qui se suicidaient et vu leur cadavre fendre les eaux. » Déjà, le 28 juin 1923, la tentation de l’immersion la hante. Perdre pied pour mieux avoir prise sur le monde reste son rêve suprême : « Oh ! pouvoir sans effort entrer et sortir des choses, m’y plonger au lieu de demeurer sur les bords ! »
Virginia Woolf, ce nom lui-même sonne comme une aberration, un choc des contraires voué à la désagrégation. Vierge et louve, rêveuse et acharnée, prudente et vorace, idéaliste et lucide, elle oscille toujours entre deux pôles, comme elle griffe tour à tour les pages de son journal et de ses romans avec un « stylo qui pleure son encre ». Raconter sa vie la révulse, car, écrit-elle dans L’Art de la biographie, « la majorité des biographies victoriennes ressemblent aux figures de cire conservées à l’abbaye de Westminster et que l’on transportait à travers les rues dans des cortèges funèbres, des effigies n’ayant qu’un vernis de ressemblance avec le corps contenu dans le cercueil ».
Pourtant, Virginia Woolf pratique comme personne l’écriture intime, au plus près de ses soubresauts intérieurs et de ses tracas quotidiens. La force inextinguible de ses textes vient de ce paradoxe, dont elle a fait sa raison d’être : parler de soi sans s’épancher, être concis dans la logorrhée, transparent dans l’opacité. Son secret, pour y parvenir ? Le port du masque, qu’elle maîtrise comme personne. Se cacher derrière ses personnages de roman, leur prêter les modulations de sa voix, tour à tour étouffée, implorante, rieuse ou légère. Le subterfuge n’est pas nouveau, mais Virginia Woolf y a recours avec un art unique de l’effacement tourbillonnant. Elle écrit par cercles concentriques, comme si elle frottait une gomme sur l’esquisse de son propre visage, jusqu’à faire dans le papier un trou béant dans lequel elle ne parvient plus à se cacher.« Elle avait toujours le sentiment qu’il était très, très dangereux de vivre, ne serait-ce qu’un seul jour. »
Extrait de Mrs Dalloway
Autoportrait à double fond, son roman Mrs Dalloway est l’exemple le plus frappant. Virginia Woolf mène le récit parallèle de deux errances, celles de Clarissa Dalloway et de Septimus Warren Smith, en perdition dans les méandres de leurs regrets, tergiversations et accès de lucidité. Ces deux funestes personnages ne se rencontrent jamais mais éprouvent le même désarroi devant la vacuité de l’existence, que seule atténue la beauté des choses. Douleur ressentie par la romancière elle-même, qui pourrait reprendre à son compte cette description de Mrs Dalloway : « Elle se sentait très jeune ; et en même temps, indiciblement âgée. Elle passait au travers de choses comme une lame de couteau ; et en même temps, elle était en dehors de tout, et elle regardait. Elle avait perpétuellement la sensation d’être en dehors, en dehors, très loin en mer et toute seule ; elle avait toujours le sentiment qu’il était très, très dangereux de vivre, ne serait-ce qu’un seul jour. » De même, Virginia Woolf ne peut que partager les terrifiantes angoisses de Septimus, devant la déchirante transparence de ses écrits : « Elle lui apporta ses papiers, les choses qu’il avait écrites. Elle les déversa sur le sofa. Ils les regardèrent ensemble. Des diagrammes, des croquis, des petits bonshommes ou bonnes femmes brandissant des bâtons en guise de bras, avec des ailes (c’était vraiment des ailes ?) sur le dos. Des cercles tracés autour de pièces d’un shilling ou de six pence, les soleils et les étoiles. De zigzagantes parois à pic avec des alpinistes en cordée qui en faisaient l’ascension, on aurait dit des couteaux et des fourchettes ; des vues marines avec de petits visages farceurs émergeant de ce qui était peut-être des vagues : la carte du monde. Brûle tout ça ! cria-t-il. Et puis ses écrits ; que les morts chantent derrière les massifs de rhododendrons ; des odes au Temps ; des conversations avec Shakespeare ; l’amour universel : le sens du monde. Brûle tout ça ! cria-t-il. »
Traquer la métamorphose, l’instant précis où l’on glisse d’une idée à l’autre, d’une pensée à un rêve, d’une colère à un apaisement. Virginia Woolf a devancé Nathalie Sarraute dans ce savant dépeçage de la réalité, pour toucher des mots l’indicible, l’inconcevable. Pour mesurer cette technique pénétrante et avant-gardiste, il faut lire La Chambre de Jacob, éblouissant diaporama composé par une série de témoins qui tentent à tour de rôle de retracer la vie d’un défunt. Comme toujours chez Virginia Woolf, les points-virgules offrent une étrange respiration dans les phrases. Ils sont des reprises de souffle, entre deux plongées en apnée sous la surface des choses. Et s’il en était de même pour ces mystérieux ronds d’encre qui crèvent les pages de son Journal d’adolescence ? Bouches bées, bulles de survie, zéros pointés, boucles bouclées… L’énigme n’a jamais été percée. Peut-être s’agit-il tout simplement de l’entrée du tunnel qui permet d’accéder à l’univers intérieur de celle qui écrivait : « Je creuse de belles grottes derrière mes personnages. Je crois que cela donne exactement ce que je désire : humanité, humour, profondeur. » Alors, entrons, tombons. C’est tout. C’est tout. Comme aime à le marmonner Mrs Dalloway, en arpentant Bond Street”.
A LIRE
“Journal intégral”, 1915-1941, traduit de l’anglais par Colette-Marie Huet et Marie-Ange Dutartre, éd. Stock, 1 558 p., 39 €.
“La Chambre de Jacob”, traduit de l’anglais par Agnès Desarthe, éd. Stock, 252 p., 18,50 €.
“Journal d’adolescence”, 1897-1909, traduit de l’anglais par Marie-Ange Dutartre, éd. Stock, 498 p., 26 €.
PS MBEJA : JE PASSE TROP ALLEGREMENT SUR SON ANTISEMITISME…
YOURCENAR, MEMOIRES D’HADRIEN
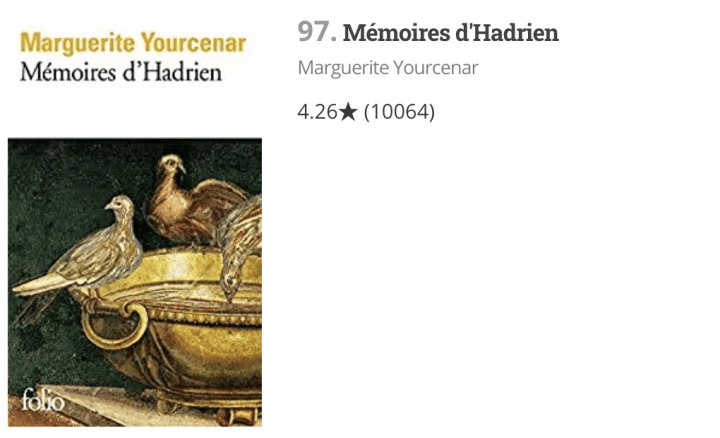
« J’ai formé le projet de te raconter ma vie. » Sur son lit de mort, l’empereur romain Hadrien (117-138) adresse une lettre au jeune Marc Aurèle dans laquelle il commence par donner “audience à ses souvenirs”. Très vite, le vagabondage d’esprit se structure, se met à suivre une chronologie, ainsi qu’une rigueur de pensée propre au grand personnage. Derrière l’esthète cultivé et fin stratège qu’était Hadrien, Marguerite Yourcenar aborde les thèmes qui lui sont chers : la mort, la dualité déroutante du corps et de l’esprit, le sacré, l’amour, l’art et le temps. À l’image de ce dernier, ce “grand sculpteur”, elle taille, façonne, affine avec volupté chacun des traits intérieurs du grand homme à qui elle fait dire : « Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être ou tout au moins pour me mieux connaître avant de mourir. »
Marguerite Yourcenar trouva un jour dans la Correspondance de Flaubert une phrase inoubliable :
“Les dieux n’étant plus, et le Christ n’étant pas encore, il y a eu, de Cicéron à Marc Aurèle, un moment unique où l’homme seul a été.”
Et l’auteur des Mémoires d’Hadrien ajoute : “Une grande partie de ma vie allait se passer à essayer de définir, puis à peindre, cet homme seul et d’ailleurs relié à tout.”
Traduit dans seize langues, salué par la presse du monde entier, les Mémoires d’Hadrien n’ont jamais cessé, depuis leur publication en 1951, d’entraîner de nouveaux lecteurs vers cet Empereur du IIe siècle, cet « homme presque sage » qui fut, en même temps qu’un initiateur des temps nouveaux, l’un des derniers libres esprits de l’Antiquité.
TOSTOÏ, ANNA KARENINE
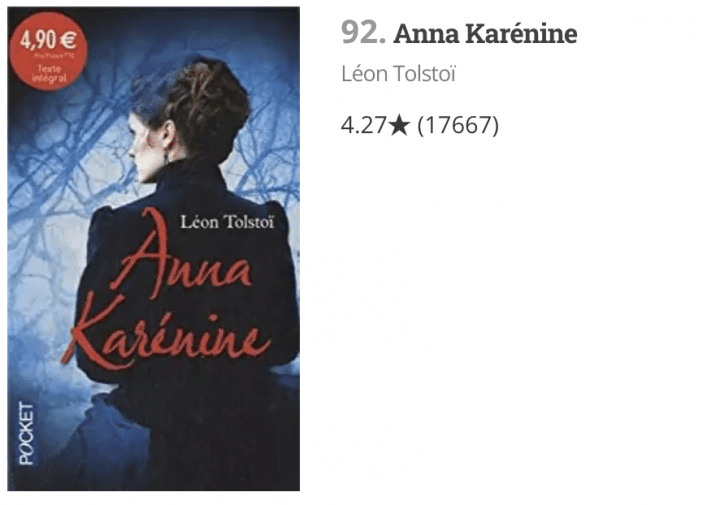
En visite à Moscou chez son frère Stépan Oblonski, la jeune et belle Anna, femme d’Alexis Karénine, haut fonctionnaire pétersbourgeois, et mère d’un garçon de huit ans, rencontre à sa descente du train le comte Alexeï Vronski. Bientôt, leur liaison éclate au grand jour à Saint-Pétersbourg. Enceinte, la jeune femme est sur le point de mourir en couches. Karénine lui accorde son pardon, tandis que Vronski tente de se suicider. Rétablie, elle quitte son mari et son enfant pour vivre avec son amant en marge de la société aristocratique qui les rejette… Mais la passion jalouse d’Anna commence à peser à son amant. Victime d’une passion à laquelle elle a tout sacrifié, Anna finira par se jeter sous un train… Commencé peu après l’achèvement de Guerre et Paix et inspiré à Léon Tolstoï (1828-1910) par le suicide d’une femme abandonnée par son amant en 1872, Anna Karénine se veut une « expérience de laboratoire » sur le thème de « l’idée familiale » dans le cadre réaliste de la société russe. Le roman parut d’abord en feuilleton, avec succès. Tolstoï y brocarde l’hypocrisie de la haute société pétersbourgeoise. Car le drame d’Anna Karénine, qui ne sait ni mentir ni tricher, n’est pas tant d’avoir succombé à la passion que de lui avoir tout sacrifié, y compris sa vie de femme et de mère.
LAURENCE STERNE, VIE ET OPINIONS DE TRISTAM SHRANDY, GENTILHOMME
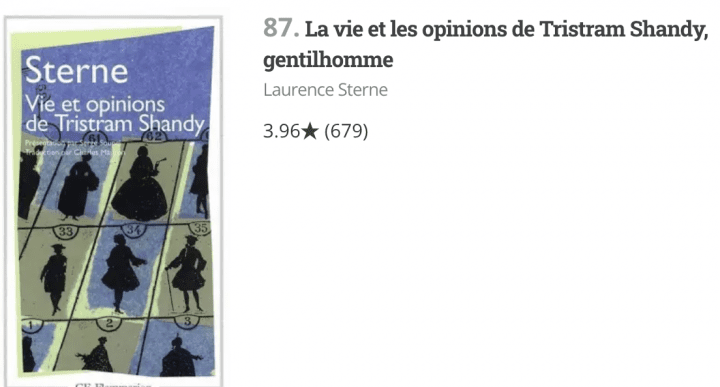
D’une force comique et subversive incomparable, cette chronique d’une maisonnée campagnarde – où l’on assiste aux déboires et aux débats véhéments et passionnés des membres de la famille Shandy, de leurs amis, voisins et domestiques, dans des domaines aussi variés que l’obstétrique, la religion, l’amour ou l’art de la guerre – apparaît d’abord comme le roman de la liberté absolue de l’écrivain : ” Il faudrait savoir à la fin si c’est à nous autres écrivains de suivre les règles – ou aux règles de nous suivre ! ” disait Laurence Sterne.
Il existe plusieurs traductions en français de ce grand roman moderne du XVIIIe siècle anglais, considéré comme l’un des sommets de la littérature universelle, à l’égal des œuvres de Rabelais ou de Cervantès.
Ici une traduction de 1848 signée Léon de Wailly.
Accessible gratuitement sur toute bibliothèque numérique qui se respecte.
JANE AUSTEN, ORGUEIL ET PREJUGES

Mr et Mrs Bennett ont cinq filles à marier. À l’arrivée d’un nouveau et riche voisin, la famille espère que l’une d’entre elles pourra lui plaire… Au-delà des aventures sentimentales des cinq filles Bennett, Jane Austen dépeint les rigidités de la société anglaise au tournant du XIXe siècle. Le comportement et les réflexions d’Elizabeth Bennett, son personnage principal, révèlent les problèmes auxquels sont confrontées les femmes de la gentry campagnarde pour s’assurer sécurité financière et statut social : la solution passe en effet par le mariage.
Drôle et romanesque, ce chef-d’oeuvre de Jane Austen continue à jouir d’une vive popularité et a donné lieu à de nombreuses adaptations.
ECHENOZ, CHEROKEE
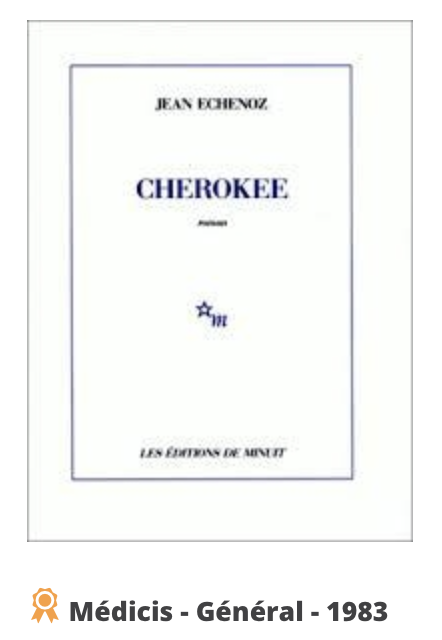
Georges Chave, né à Ivry-sur-Seine le jour de la bataille d’Okinawa, est domicilié à Paris dans le 11e arrondissement. Il vit de peu, meuble son existence d’une activité de bars, de cinémas, de voyages en banlieue, de sommeils imprévus, d’aventures provisoires ; écoute souvent des disques américains. L’un de ces disques lui manque, une version rare de Cherochee, qu’on lui a dérobé il y a dix ans. Tout cela n’est rien, mais il s’en contente jusqu’à ce que Véronique surgisse dans sa vie. Dès lors, Georges s’agite un peu.
Il ne voulait pas grand-chose, pourtant : gagner assez d’argent pour offrir cette robe jaune à Véronique. Mais déjà elle l’a quitté. Et à peine rencontre-t-il une autre femme qu’elle aussi disparaît. Celle-là, Georges va la chercher partout, suivre ses traces jusqu’à la mer du Nord, cependant que tout le monde se lance à sa poursuite — policiers, voleurs, divers intermédiaires. Sait-il seulement pourquoi ? Le voilà seul comme un Peau-Rouge dans un jeu de piste truqué, sur le sentier d’une guerre qu’il n’avait pas songé à déclarer.
ISHIGURO, L’INCONSOLE

Pianiste de renommée internationale, Ryder a accepté de donner un récital dans une petite ville d’Europe centrale où il est attendu comme le messie. Â peine débarque-t-il, épuisé, de son long voyage, qu’il devient la proie d’une cohorte d’admirateurs aussi obséquieux qu’envahissants. Sans cesse distrait d’un programme officiel dont i1 ne se souvient pas, manquant systématiquement ses rendez-vous, il plonge peu à peu dans un univers étrange et imprévisible. Les gens, les lieux et les durées s’enchevêtrent mystérieusement, sans susciter chez lui autre chose qu’une légère surprise…
Intensément comique et envoûtant, L’Inconsolé, déjà traduit dans vingt pays, a été salué par la critique internationale comme un chef-d’oeuvre.
DEBORAH LEVY, LE COÛT DE LA VIE, CE QUE JE NE VEUX PAS SAVOIR, ETAT DES LIEUX
Nationalité : Afrique du Sud
Né(e) à : Johannesburg, Afrique du Sud , le 06/08/1959
Biographie : Deborah Levy est une romancière, dramaturge et poétesse britannique.
Elle s’est d’abord concentrée sur l’écriture pour le théâtre — ses pièces ont été mises en scène par la Royal Shakespeare Company — avant de se concentrer sur la fiction en prose. Ses premiers romans comprennent Beautiful Mutants, Swallowing Geography et Billy & Girl. Son roman Swimming Home a été dans la shortlist du Prix Booker en 2012 et The Man Who Saw Everything fut dans la première sélection du Prix Booker en 2019.
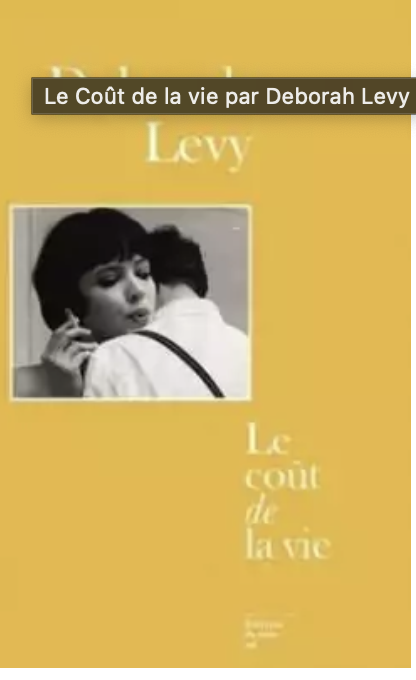
Un divorce forcément douloureux, une grande maison victorienne troquée contre un appartement en haut d’une colline dans le nord de Londres, deux filles à élever et des factures qui s’accumulent… Deborah Levy a cinquante ans quand elle décide de tout reconstruire, avec pour tout bagage, un vélo électrique et une plume d’écrivain. L’occasion pour elle de revenir sur le drame pourtant banal d’une femme qui s’est jetée à corps perdu dans la quête du foyer parfait, un univers qui s’est révélé répondre aux besoins de tous sauf d’elle-même. Cette histoire ne lui appartient pas à elle seule, c’est l’histoire de chaque femme confrontée à l’impasse d’une existence gouvernée par les normes et la violence sournoise de la société, en somme de toute femme en quête d’une vie à soi.
Ce livre éblouissant d’intelligence et de clarté, d’esprit et d’humour, pas tant récit que manifeste, ouvre un espace où le passé et le présent coexistent et résonnent dans le fracas incessant d’une destinée.
Le Coût de la vie tente de répondre à cette question : que cela signifie-t-il pour une femme de vivre avec des valeurs, avec sens, avec liberté, avec plaisir, avec désir ? La liberté n’est jamais gratuite et quiconque a dû se battre pour être libre en connaît le coût. Marguerite Duras nous dit qu’une écrivaine doit être plus forte que ce qu’elle écrit. Deborah Levy offre en partage cette expérience.
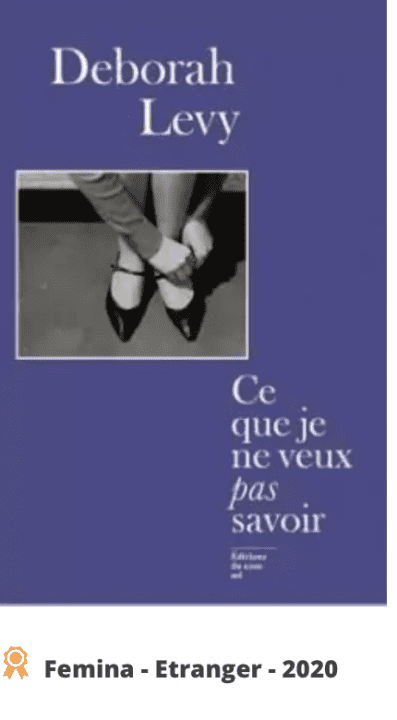
Deborah Levy revient sur sa vie. Elle fuit à Majorque pour réfléchir et se retrouver, et pense à l’Afrique du Sud, ce pays qu’elle a quitté, à son enfance, à l’apartheid, à son père – militant de l’ANC emprisonné –, aux oiseaux en cage, et à l’Angleterre, son pays d’adoption. À cette adolescente qu’elle fut, griffonnant son exil sur des serviettes en papier. Telle la marquise Cabrera se délectant du “chocolat magique’, elle est devenue écrivaine en lisant Marguerite Duras et Virginia Woolf. En flirtant, sensuelle, avec les mots, qui nous conduisent parfois dans des lieux qu’on ne veut pas revoir. Ce dessin toujours inédit que forme le chemin d’une existence.
Ce que je ne veux pas savoir est une œuvre littéraire d’une clarté éblouissante et d’un profond secours. Avec esprit et calme, Deborah Levy revient sur ce territoire qu’il faut conquérir pour écrire. Un livre talisman sur la féminité, la dépression, et la littérature comme une opération à cœur ouvert.
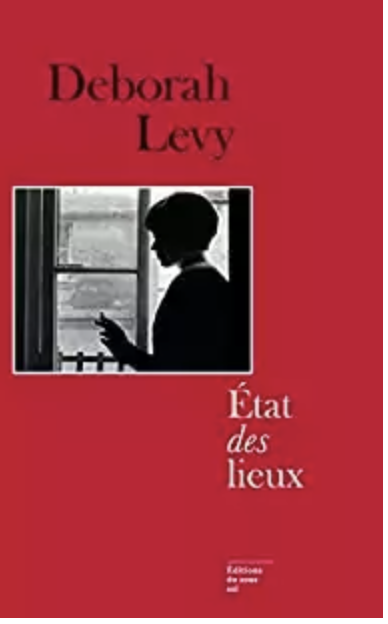
Nous avions quitté Deborah Levy gravissant sur son vélo électrique les collines de Londres et écrivant dans une cabane au fond d’un jardin. Nous la retrouvons, plus impertinente et drôle que jamais, prête à réinventer une nouvelle page de sa vie.
Tandis que ses filles prennent leur envol, elle nous emmène aux quatre coins du monde, de New York aux îles Saroniques en passant par Mumbai, Paris ou Berlin, tissant une méditation exaltante et follement intime sur le sens d’une maison et les fantômes qui la hantent.
Entremêlant le passé et le présent, le personnel et le politique, la philosophie et l’histoire littéraire, convoquant Marguerite Duras ou Céline Sciamma, elle interroge avec acidité et humour le sens de la féminité et de la propriété.
Par l’inventaire de ses biens, réels ou imaginaires, elle nous questionne sur notre propre compréhension du patrimoine et de la possession, et sur notre façon de considérer la valeur de la vie intellectuelle et personnelle d’une femme.
Pour être romancière, une femme a besoin d’une chambre à soi, nous disait Virginia Woolf. Deborah Levy complète ce tableau par l’étude d’une demeure pour soi.
Avec État des lieux, qui fait suite à Ce que je ne veux pas savoir et Le Coût de la vie, prix Femina étranger 2020, Deborah Levy clôt son projet d’“autobiographie en mouvement”, ou comment écrire sa vie sans mode d’emploi
ISHIGURO, LES VESTIGES DU JOUR
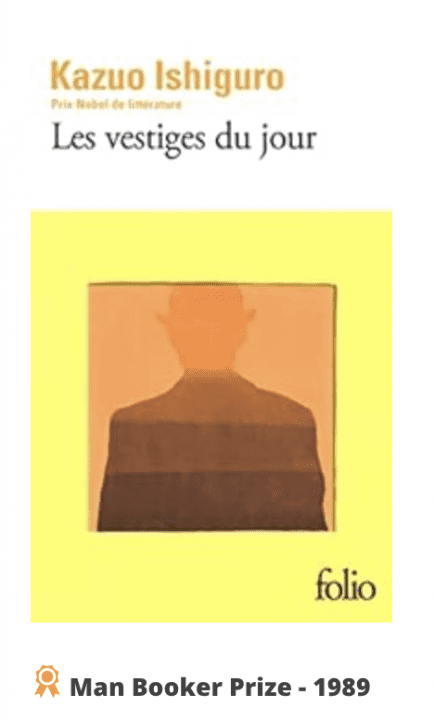
“Les grands majordomes sont grands parce qu’ils ont la capacité d’habiter leur rôle professionnel, et de l’habiter autant que faire se peut ; ils ne se laissent pas ébranler par les événements extérieurs, fussent-ils surprenants, alarmants ou offensants. Ils portent leur professionnalisme comme un homme bien élevé porte son costume. C’est, je l’ai dit, une question de “dignité”.”
Stevens a passé sa vie à servir les autres, majordome pendant les années 1930 de l’influent Lord Darlington puis d’un riche Américain. Les temps ont changé et il n’est plus certain de satisfaire son employeur. Jusqu’à ce qu’il parte en voyage vers Miss Kenton, l’ancienne gouvernante qu’il aurait pu aimer, et songe face à la campagne anglaise au sens de sa loyauté et de ses choix passés
COLETTE FELLOUS

Avenue de France, à Tunis, on pouvait voir autrefois, entre le petit Café de France et la patisserie Licari, l’enseigne “Fellous Frères” sur la première manufacture de tabac du pays. La femme qui marche aujourd’hui, place de la Nation à Paris, se souvient de la petite fille qui connaissait tous les commerçants de l’avenue de France. Pourtant son propos n’est pas de se pencher avec nostalgie sur le temps passé mais de témoigner pour ceux qui n’ont pas pu le faire, pour ce frère mort trop tôt, pour la génération des parents ou des grands-parents, pour tout un peuple. C’est une prière qui aimerait épeler l’histoire d’un siècle non seulement dans cette région du monde, Tunisia North Africa, mais aussi dans tous les autres pays tissés de cabrioles, migrations, déplacements, illusions, glissements, métamorphoses, collages, paradoxes, clans, réseaux, rivalités, colonisations, grands cauchemars organisés, abandons, rêves de tous les jours, servitudes volontaires, hallucinations en tous genres. Le récit de Colette Fellous possède tout à la fois la ferveur d’une prière et la qualité musicale d’un hymne aux voix chères qui se sont tues. —Yves Bellec
PHILIP ROTH, UN HOMME
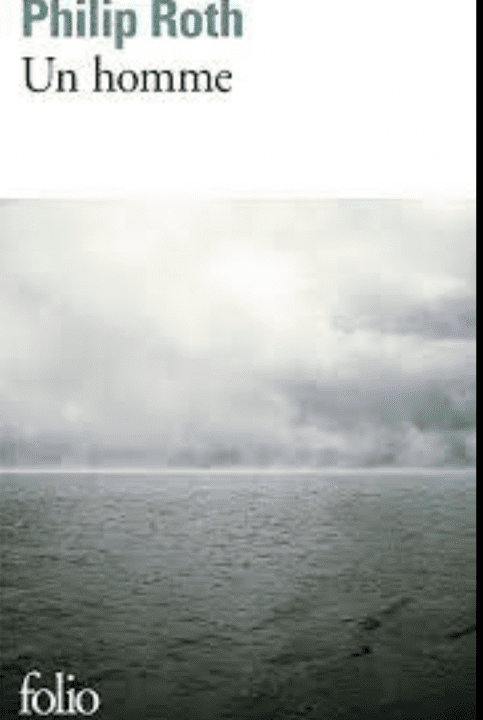
Un homme. Un homme parmi d’autres. Le destin du personnage de Philip Roth est retracé depuis sa première et terrible confrontation avec la mort sur les plages idylliques de son enfance jusque dans son vieil âge, quand le déchire la vision de la déchéance de ses contemporains et que ses propres maux physiques l’accablent. Entre-temps, publicitaire à succès dans une agence à New York, il aura connu épreuves familiales et satisfactions professionnelles. D’un premier mariage, il a eu deux fils qui le méprisent et, d’un second, une fille qui l’adore. Il est le frère bien-aimé d’un homme sympathique dont la santé vigoureuse lui inspire amertume et envie, et l’ex-mari de trois femmes, très différentes, qu’il a entraînées dans des mariages chaotiques. En fin de compte, c’est un homme qui est devenu ce qu’il ne voulait pas être.
Ce roman puissant – le vingt-septième de Roth – prend pour territoire le corps humain. Il a pour sujet l’expérience qui nous est commune et nous terrifie tous.
ALBERT COHEN, SOLAL
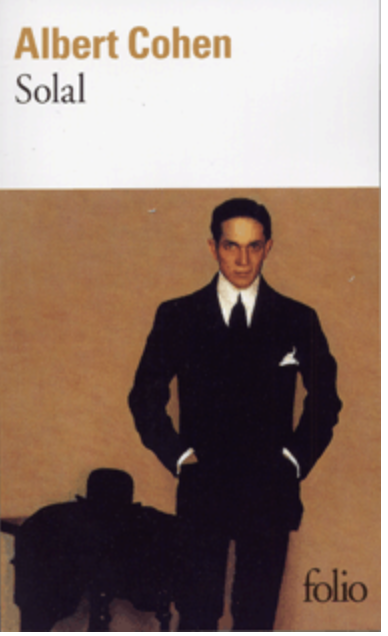
Avez-vous lu Solal ? C’est la question que, ces jours derniers, je pose à tous ceux que je rencontre. Solal est un très grand livre, une œuvre forte et riche. (Marcel Pagnol, Les NouvelIes littéraires)
Œuvre désordonnée et magnifique, Solal mérite d’être lu et relu. Il possède les caractéristiques de la grandeur. Il dévoile au lecteur de nouveaux tréfonds de l’âme humaine. C’est le seul véritable critère de la grandeur. (New York Times)
Livre magnifique, bouillonnant de sève, d’une opulence barbare, d’une intelligence aiguë. Un talent extraordinaire. (Gazette de Lausanne)
Solal est un livre à nul autre pareil. C’est très rarement que surgit un roman qui soit l’oeuvre d’un génie évident. (San Francisco Chronicle)
Solal a été proclamé, par les critiques d’Europe et d’Amérique un grand roman, un chef-d’oeuvre. (The Times)
Un livre étonnant. Avec Solal, le roman contemporain s’éveille à une vie nouvelle, d’une originalité absolue. (Vossische Zeitung)
KUNDERA, LA PLAISANTERIE

En Tchécoslovaquie, Ludvik est étudiant et communiste. A la suite d’une blague mal interprétée qu’il a écrite sur une carte postale et envoyée à une étudiante, il est enrôlé de force dans l’armée des « noirs » c’est-à-dire des ennemis politiques.
Achevé en 1965, La plaisanterie est le premier roman de Milan Kundera alors âgé de 36 ans. Publié en Tchécoslovaquie en 1967, il coïncide avec les prémices du « printemps de Prague », tentative de libéralisation sévèrement réprimée par l’U.R.S.S. en août 1968. Parce qu’il prend pour cadre le régime de son pays, ce roman a été perçu comme un livre essentiellement politique. Ce que Kundera a démenti en le qualifiant « d’histoire d’amour », unique sentiment résistant à la désillusion de l’Histoire.
AJAR, GARY, GROS-CALIN

Je sais parfaitement que la plupart des jeunes femmes aujourd’hui refuseraient de vivre en appartement avec un python de deux mètres vingt qui n’aime rien tant que de s’enrouler affectueusement autour de vous, des pieds à la tête. Mais il se trouve que Mlle Dreyfus est une Noire de la Guyane française, comme son nom l’indique. J’ai lu tout ce qu’on peut lire sur la Guyane quand on est amoureux et j’ai appris qu’il y a cinquante-deux familles noires qui ont adopté ce nom, à cause de la gloire nationale et dur racisme aux armées en 1905. Comme ça, personne n’ose les toucher.”
—————————————-
Lorsqu’on a besoin d’étreinte pour être comblé dans ses lacunes, autour des épaules surtout, et dans le creux des reins, et que vous prenez trop conscience des deux bras qui vous manquent, un python de deux mètres vingt fait merveille. Gros-Câlin est capable de m’étreindre ainsi pendant des heures et des heures.
Gros-Câlin paraît au Mercure de France en 1974. Il met en scène un employé de bureau qui, à défaut de trouver l’amour chez ses contemporains, s’éprend d’un python. L’auteur de ce premier roman, fable émouvante sur la solitude de l’homme moderne, est un certain Emile Ajar. La version publiée à l’époque ne correspond pas tout à fait au projet initial de son auteur qui avait en effet accepté d’en modifier la fin.
On apprendra plus tard que derrière Emile Ajar se cache le célèbre Romain Gary. Dans son ouvrage posthume, Vie et mort d’Emile Ajar, il explique l’importance que revêt, à ses yeux et au regard de son oeuvre, la fin initiale de Gros-Câlin. Il suggère qu’elle puisse un jour être publiée séparément…
Réalisant le souhait de l’auteur, cette nouvelle édition qui paraît aujourd’hui reprend le roman Gros-Câlin dans la version de 1974, et donne en supplément toute la fin ” écologique “, retranscrite à partir du manuscrit original.
(éd. Mercure de France, 4e de couv.)
ROBERTO BOLONO, LES DETECTIVES SAUVAGES
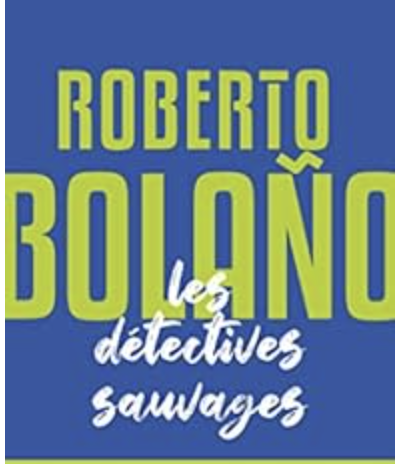
Livre du chaos magistralement mis en chœur, livre aussi de l’amitié, de la passion, Les Détectives sauvages brasse des éléments de la vie errante de Roberto Bolaño et de son ami Mario Santiago Papasquiaro, qu’il transfigure en une épopée ouverte, lyrique, triste et joyeuse de destins qui ont incarné la poésie. La critique internationale a comparé ce roman polyphonique aux grandes œuvres de Cortazar, de Garcia Marquez, de Pynchon. Cette œuvre marque avec force l’arrivée de nouveaux écrivains latino-américains qui sont des héritiers hérétiques des grands auteurs du XXe siècle.
MARCEL COHEN, DETAILS

Détails qui s’inscrit dans le prolongement de la trilogie des Faits (publiée entre 2002 et 2010), témoigne une nouvelle fois chez l’auteur, mais sous un angle légèrement différent, du sens tout à fait unique de l’observation, de l’introspection et de l’Histoire. En faisant du détail d’un paysage, d’une situation, d’une ?uvre d’art, l’essentiel, il renverse le point de vue habituel et réveille singulièrement le regard et la pensée de son lecteur
DEL CASTILLO, LA NUIT DU DECRET
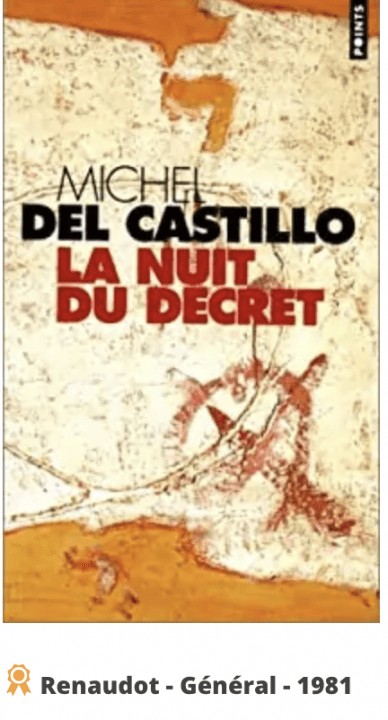
Dans certains villages de Catalogne, le nom du commissaire Avelino Pared éveille encore une terreur sourde.
Responsable de la répression à l’époque de la guerre civile, ce fonctionnaire secret officie maintenant dans une petite ville du nord de l’Espagne : Huesca, où l’inspecteur Laredo, nouvellement nommé, entrera bientôt en fonction. Pour préparer leur rencontre, le jeune policier mène l’enquête, interroge d’anciens témoins, et pénètre peu à peu dans le silence glacé de l’époque franquiste. Le voyage serait sans danger si l’histoire d’Avelino Pared, avec ses craquelures infimes, ses places sombres et enneigées, son enfance perdue, ne renfermait une énigme
COLETTE, “LE PUR ET L’IMPUR”
“C’est selon mon vœu personnel que le volume intitulé Ces plaisirs… s’appellera désormais Le Pur et l’Impur. S’il me fallait justifier un tel changement, je ne trouverais qu’un goût vif des sonorités cristallines, une certaine antipathie pour les points de suspension bornant un titre inachevé – des raisons, en somme, de fort peu d’importance”.
Le texte de Colette intitulé donc “le Pur et l’impur” est celui qui m’a accompagné tout l’Été 2021. C’est un texte, qui, en même temps qu’un être, est de ceux qui viennent à point nommé, qui accompagne, comme pour le chasser, le sentiment de désertion, exacerbé par la ville vidée, rues dramatiquement désertes. La désertion individuelle (celle de l’écart dramaturgique) est facile. Elle n’est que convenance de confort personnel, exclusif d’une imagination de l’autre, de mise en scène de soi. Elle se prend pour un acte hugolien, décisif et digne de respect. Mais on ne déserte toujours que son propre désert. C’est ce que nous dit Colette, à peu près, sans le dire. Elle qui cherche, comme tout grand écrivain, les humains et constate les fracas de leurs vies. Mais elle, Colette, a un regard venu d’ailleurs. Une compositrice cosmique, comme tous ceux à qui les forces supérieures ont offert ce don, qui n’en est qu’un pour toute l’humanité. Quoi, Colette, comme Bach ou Rimbaud ? Oui.
Complexe solitude. Et dans les plongeons dans ses rencontres, ses sentiments qui tiennent bon devant tous les vents mauvais, donnés au lecteur dans un style incroyable, on se dit que cet écrivain est née pour nous rappeler, dans le pur, l’impur, l’humanité (encore) des humains dont certains tournent le dos à la petitesse. Colette, elle, n’est pas une déserteuse. Au contraire, elle envahit le vide, toujours ses yeux posés au bon centre. Une femme, quoi. Un être, si on veut. Pas une citrouille.
Je l’ai offert 4 fois cette année, en même temps que du mascara Christian Lacroix, ce bouquin de l’immense, l’insensée Colette. Dieu que je l’aime. Sans chats, évidemment. MB.
un extrait
En haut d’une maison neuve, on m’ouvrit un atelier vaste comme une halle, pourvu d’une large galerie à mi-hauteur, tendu de ces broderies de Chine que la Chine exécute pour l’Occident, à grands motifs un peu bâclés, assez belles. Le reste n’était que piano à queue, secs petits matelas du Japon, phonographe et azalées en pots. Sans surprise, je serrai la main tendue d’un confrère journaliste et romancier, et j’échangeai des signes de tête avec des amphitryons étrangers qui me parurent, Dieu merci, aussi peu liants que moi-même. Bien préparée à l’ennui, je pris place sur mon petit matelas individuel, en déplorant que la fumée de l’opium, gaspillée, s’envolât lourdement jusqu’aux verrières. Elle s’y décidait à regret, et son noir, apéritif parfum de truffe fraîche, de cacao brûlé, me donna la patience, une faim vague, de l’optimisme. Je trouvai aimables la couleur sourde et rouge des lumières voilées, la blanche flamme en amande des lampes à opium, l’une toute proche de moi, les deux autres perdues comme des follets, au loin, dans une sorte d’alcôve ménagée sous la galerie à balustres. Une jeune tête se pencha au-dessus de cette balustrade, reçut le rayon rouge des lanternes suspendues, une manche blanche flotta et disparut avant que je pusse deviner si la tête, les cheveux dorés collés comme des cheveux de noyée, le bras vêtu de soie blanche appartenaient à une femme ou à un homme.
« Vous venez en curieuse ? » me demanda mon confrère.
Il gisait sur son petit matelas ; je m’avisai qu’il avait troqué son smoking contre un kimono brodé et une aisance d’intoxiqué ; je ne souhaitai que m’écarter de lui, comme je fais des Français, toujours inopportuns, que je rencontre au-delà des frontières.
« Non, répondis-je. Par devoir professionnel. »
Il sourit.
« Je le pensais bien… Un roman ? »
Et je le détestai davantage, pour ce qu’il me croyait incapable – moi qui l’étais en effet – de goûter ce luxe : un plaisir tranquille, un peu bas, un plaisir inspiré seulement par une certaine forme du snobisme, l’esprit de bravade, une curiosité plus affectée que réelle… Je n’avais apporté qu’un chagrin bien caché, qui ne me laissait point de repos, et une affreuse paix des sens.
Un des hôtes inconnus ressuscita de sa couche pour m’offrir de fumer l’opium, de priser la cocaïne, de boire un cocktail. À chaque refus il levait légèrement la main pour exprimer sa déception. Il finit par me tendre une boîte de cigarettes, sourit d’une bouche anglaise et suggéra :
« Ne puis-je vraiment vous être utile en rien ? »
Je remerciai, et il se garda d’insister.
Je me souviens encore, après quinze ans et plus, qu’il était beau et semblait sain, sauf qu’il tenait ses yeux trop ouverts entre des paupières raidies, comme on voit aux êtres qui souffrent d’insomnies longues et invétérées.
….
“Écouter, c’est une application qui vieillit le visage, courbature les muscles du cou, et roidit les paupières à force de tenir les yeux fixés sur celui qui parle… C’est une sorte de débauche studieuse… Non seulement l’écouter, mais le traduire… Hausser jusqu’à son sens secret une litanie de mots ternes, et l’acrimonie jusqu’à la douleur, jusqu’à la sauvage envie…
« De quel droit ? De quel droit ont-elles eu, toujours, plus que moi ? Si encore je pouvais en douter. Mais je n’avais qu’à les voir… Leur plaisir n’était que trop vrai. Leurs larmes aussi. Mais leur plaisir surtout… »
Ici, il ne se permit aucune digression sur l’impudeur féminine. Il eut un imperceptible redressement du buste, pour s’écarter de ce qu’en effet il voyait dans sa mémoire, « subdivisée intérieurement », elle aussi.
« Être leur maître dans le plaisir, mais jamais leur égal… Voilà ce que je ne leur pardonne pas. »
Il respira, heureux d’avoir si clairement expulsé de lui le motif essentiel de sa grande lamentation à mi-voix. Il se tourna de côté et d’autre comme pour appeler un valet, mais toute la vie nocturne de l’hôtel s’était retirée dans un seul ronflement humain, proche et régulier. Damien se contenta donc d’un reste d’eau gazeuse tiède, essuya posément sa douce bouche, et me sourit gentiment du fond de son désert. La nuit passait sur lui légère, et sa vigueur avait l’air de faire partie d’un particulier ascétisme… Depuis qu’au début de sa confidence il avait successivement isolé, pour les faire briller mieux, la fameuse amie du grand usinier, la lady, la comédienne, il ne s’était servi que du pluriel. Perdu, tâtonnant dans une foule, dans un troupeau, à peine guidé par les repères du sein, de la hanche, par le sillon phosphorescent d’une larme…
« Le plaisir, bon, oui, le plaisir, c’est entendu. Si quelqu’un en ce monde sait ce qu’est le plaisir, ce quelqu’un c’est moi. Mais de là à… Elles vont trop loin. »
Il vida avec force le fond de son verre sur le tapis comme un roulier dans une auberge, et ne s’excusa pas. Ces gouttes d’eau tiédie insultaient-elles une femme, ou toute la horde invisible qui ne craignait pas l’exorcisme ?
« Elles vont trop loin. » Elles vont d’abord jusqu’où l’homme les mène, exigeant, ivre lui-même et titubant de la science qu’il leur verse. Puis : « Où est mon ignorante d’hier ? » soupire-t-il dès le lendemain, « et qu’ai-je de commun avec cette chèvre de sabbat ? »
« Elles vont vraiment si loin ?
– Croyez-moi, dit-il laconiquement. Et elles ne savent pas revenir en arrière. »
Il détourna les yeux d’une manière qui lui était personnelle, ostensiblement et comme un homme qui devant une lettre ouverte se défend de la lire par crainte de refléter sur son visage ce que déloyalement il y pourrait surprendre.
« C’était peut-être votre faute. N’avez-vous jamais donné à une femme le temps de s’habituer à vous, de s’adoucir, de se reposer ?
– Quoi donc ? fit-il railleur. La paix, alors ? La pommade aux concombres pour la nuit et les journaux au lit le matin ? »
Il reprit un petit balancement du buste, à peine sensible, unique aveu d’une fatigue nerveuse. Je respectai le silence, la parole elliptique d’un homme qui n’avait, de toute sa vie, traité avec l’ennemie, ni déposé son armure, ni admis dans l’amour cette décrépitude qu’est le repos…
COLETTE. “Le pur et l’impur”. Éditions Fayard. Hachette littérature.
PUIS, POUR CONTINUER SUR COLETTE, UN DOCU ARTE “
https://www.arte.tv/fr/videos/079398-000-A/colette-l-insoumise/
JONATHAN COE “BILLY WILDER ET MOI”

Ce bouquin est enchanteur. Jonathan Coe nous emmène loin dans son écriture placide. Il faut vite le lire si ce n’est pas fait. Et c’est grâce à Coe et Wilder, l’un de mes cinéastes préférés, lequel, dans un des dialogues du roman rend hommage à son maitre Ernst Lubitsch que j’ai pu, immédiatement, replonger dans le plaisir cinématographique et revoir ce film délicieux intitulé “The shop around the corner” dont le titre choisi pour la France est “rendez-vous”, qui est mon préféré et dont j’ai offert le DVD à celles et ceux que j’aimais.
Extrait du bouquin de Jonathan Coe. On y parle d’abord de Brooks, de l’humour et “l’école de Lubistch” :
« Oui, c’était assez marrant, reconnut-il. J’aime bien monsieur Brooks. C’est un type intelligent. Très intelligent, très drôle. Mais même là, voyez-vous… » Il se tourna vers Gill et moi, comme s’il dispensait un cours. « Vous savez, il y a cette scène où les cow-boys sont tous assis autour du feu, et ils se mettent à lâcher des vents les uns après les autres. Ce n’est pas ce que je qualifierais d’humour sophistiqué, n’est-ce pas ? Monsieur Diamond et moi n’avons jamais eu envie d’écrire une scène de ce genre. Nous sommes plutôt de l’école de Lubitsch. (Encore un nom qui ne signifiait rien pour aucune de nous deux.) On ne souligne pas les choses. On les suggère »

Ce film est un chef d’oeuvre dans la lignée de la “wonderful life” (“la vie est belle”, en français) de Capra (à ne pas confondre avec Benini ) Curieusement les deux avec un James Stewart gonflé naturellement à bloc de tous les sentiments du monde, portant dans ses yeux lumineux et son front lisse, une bonté, encore simple qui nous fait oublier les trahisons, les désillusions, les infamies. Le genre de film qui nous rappelle que la seule vérité est qu’il y a du bien et du mal et des bons et des méchants, ces derniers ne devant pas aller au Paradis. Enfantin. La vie est simple aurait du titrer Capra.
Wilder “faisait dans l’être humain” et pas dans les requins de Spielberg
Encore un extrait du roman de Coe :
« Elle fronça le nez. « Les Dents de la mer, c’était bien.
— Oh oui, Les Dents de la mer, c’était incroyable », approuvai-je en opinant vigoureusement du chef. Ma mère, mon père et moi étions allés le voir le jour de sa sortie en Grèce – le lendemain de Noël 1975 – et je l’avais revu deux fois depuis.
La mention de ce film arracha pourtant un soupir à monsieur Wilder (qui était davantage résigné que fâché).
« Mon Dieu, ce film avec le requin. Quand est-ce que les gens arrêteront de parler de ce film avec le requin ? Vous savez, cette maudite bestiole a fait davantage recette aux États-Unis que n’importe quoi d’autre dans l’histoire d’Hollywood. Même Monroe, même Scarlett O’Hara n’ont pas généré autant d’argent que ce requin. Et maintenant, tous les crétins de producteurs que compte la ville veulent plus de films avec des requins. Voilà comment ils réfléchissent, ces gens-là. On a gagné cent millions de dollars avec ce requin, il nous faut un autre requin. Il nous faut plus de requins, il nous faut des requins plus gros, il nous faut des requins plus dangereux. Mon idée, c’était un film qui s’intitulerait Les Dents de« Les Dents de la mer à Venise. Vous voyez, vous avez toutes ces gondoles qui sillonnent le Grand Canal, tous les touristes japonais, et puis voilà une centaine de requins qui remontent le canal et se mettent à les attaquer. J’ai soumis l’idée à un type de chez Universal, pour la blague. Il a cru que j’étais sérieux. Il a adoré. N’importe quel film que vous pouvez leur décrire en trois mots, vous savez, ils adorent, ils adorent ces histoires toutes simples, et il a trouvé que Les Dents de la mer à Venise, c’était parfait. Alors j’ai dit, d’accord, très bien, je vous fais cadeau de l’idée, mais ce n’est pas moi qui ferai ce film pour vous. Je ne suis pas très à l’aise avec les poissons, vous voyez ? Regardez tous mes films, et vous verrez qu’on n’y trouve aucun gros poisson. Je suis plutôt le genre de réalisateur qui fait dans l’être humain. »
J’en veux un peu à Coe qui de m’avoir empêché de dormir puisque j’ai passé toute une nuit à revoir des films de Wilder et de Lubitsch. Encore une fois, deux immenses. Encore du sentiment, du vrai et la haine de la méchanceté. Ca fait du bien, on redevient petit garçon, loin des “effacements”, ceux de la mémoire et d’autres, et l’assassinat des temps. A mille lieues de ce qui cause le chagrin. Dans l’humanité. Sans violence, à part celle du sentiment.
PS2. Je ne savais qu’arrivé presque au bout du roman, j’allai lire des lignes de la narratrice sur le film de Lubitsch que j’ai vu dans la nuit (The shop..). Je suis donc revenu dans mon billet pour un PS2. Je donne l’extrait. Il y a des moments, comme ça, assez curieux.
Le film que Matthew et moi allions voir s’appelait Rendez-vous en français. En anglais, il s’intitule The Shop Around the Corner. C’était bizarre de le voir par cette chaude soirée d’août à Paris, parce que c’est foncièrement un film de Noël. Ça racontait une belle histoire d’amour toute simple entre un vendeur et une vendeuse d’un modeste magasin de Budapest qui s’éprennent l’un de l’autre par lettres interposées, mais ne se supportent pas dans la vraie vie. Ce qui m’a le plus marquée dans cette séance, c’était le calme qui y régnait. Je ne parle pas de la salle, car le cinéma était plein et il y avait beaucoup de rires. Je parle du calme à l’écran : parce que le film n’avait absolument aucune musique (à part les génériques de début et de fin) et que presque tous les dialogues entre les deux amants étaient prononcés sur le ton du murmure. Ce n’était pas simplement un film sans coups de feu, sans explosions ou vrombissements de moteurs, c’était un film dans lequel il n’y avait pratiquement jamais un mot plus haut que l’autre. Mais malgré – ou peut-être grâce à – cette retenue, la chaleur du film s’insinuait progressivement en vous, vous irradiait de son rayonnement ambré, jusqu’à ce que vous aussi vous n’ayez qu’une envie : partager la féerie tendre et feutrée de l’amour que se déclarent James Stewart et Margaret Sullavan dans la scène finale. À mon sens, c’est peut-être le film le plus romantique qui ait jamais été réalisé. Dès notre sortie du cinéma, alors que nous commencions à marcher dans la rue, ma main chercha celle de Matthew et il la serra en retour.
SAMEDI, IAN MAC EWAN
Ian Mac Ewan est un immense écrivain. “Samedi”est un chef d’oeuvre.
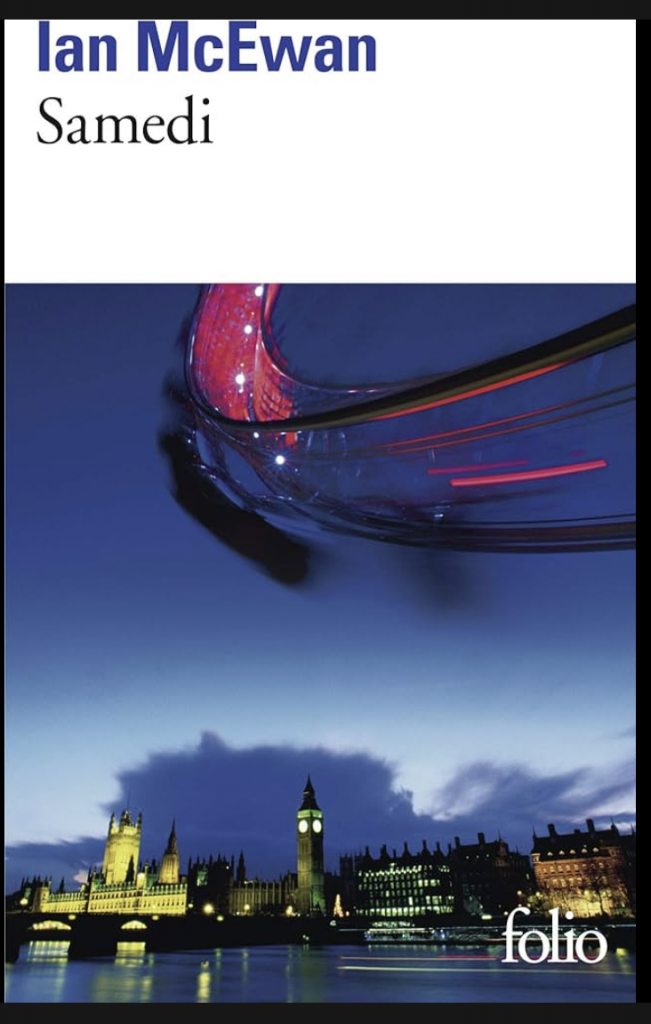
Il ne faut pas avoir peur d’employer ce terme. Il y en a beaucoup. Ne pas hésiter à lire tous les autres livres de Mc Ewan, liste ci-dessous :
- Le Jardin de ciment (The Cement Garden, 1978), trad. Claire Malroux, Seuil (1980)
- Un bonheur de rencontre / Étrange Séduction (The Comfort of Strangers, 1981), trad. Jean-Pierre Carasso, Seuil (1983) / Points Roman no 448 (1991)
- L’Enfant volé (The Child in Time, 1987, Whibread Novel of the Year Award), trad. Josée Strawson, Gallimard « Du monde entier » (1993, prix Femina étranger 1993)
- L’Innocent (The Innocent or the Special Relationship, 1990), trad. Jean Guiloineau, Seuil (1990)
- Les Chiens noirs (Black Dogs, 1992), trad. Suzanne V. Mayoux, Gallimard « Du monde entier » (1994)
- Délire d’amour (Enduring Love, 1997), trad. Suzanne V. Mayoux, Gallimard « Du monde entier » (1999)
- Amsterdam (Amsterdam, 1998, prix Booker 1998), trad. Suzanne V. Mayoux, Gallimard « Du monde entier » (2001)
- Expiation (Atonement, 2001), trad. Guillemette Belleste, Gallimard « Du monde entier » (2003)
- Samedi (Saturday, 2005) (James Tait Black Memorial Prize), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2006)
- Sur la plage de Chesil (On Chesil Beach, 2007), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2008)
- Solaire (Solar, 2010), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2011). Sur le thème du réchauffement climatique.
- Opération Sweet Tooth (Sweet Tooth, 2012), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2014)
- L’Intérêt de l’enfant (The Children Act, 2014), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2015)
- Dans une coque de noix (Nutshell, 2016), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2017)
- Une machine comme moi (Machines Like Me, 2019), trad. France Camus-Pichon, Gallimard « Du monde entier » (2019)
- Le Cafard (The Cockroach, 2019), trad. France Camus-Pichon, Gallimard (2020)
LA TACHE, PHILIP ROTH
La tâche, roman du siècle qui advient ? Ci-dessous, interview de Josyane Savigneau (“Le Monde des livres”) sur FR3, lors de la sortie du livre en France (2000).

Conçu à la mi-mars 1821 d’un coup de reins que j’ai toujours eu quelque peine à imaginer je suis né le mercredi 12 décembre à quatre heures du matin. Il neigeait sur Rouen, une légende familiale prétend que ma mère se montra si stoïque pendant le travail qu’on pouvait entendre tomber les flocons sur les toits de la ville. Quant à moi, je serais bien resté quelques années de plus dans le ventre à l’abri de l’imbécillité du monde.
Désespéré de naître j’ai poussé un atroce hurlement. Épuisé par mon premier cri je semblais si peu gaillard qu’on attendit le lendemain pour me déclarer à l’état civil car si j’étais mort entre-temps on en aurait profité pour signaler mon décès par la même occasion.
Le 8 mai 1880 au matin Gustave Flaubert prit un bain. Il décéda peu après dans son cabinet de travail d’une attaque cérébrale sans doute précédée d’une de ces crises d’épilepsie dont il était coutumier. Allongé dans l’eau il revoit son enfance, sa jeunesse, ses rêves de jeune homme, ses livres dont héroïnes et héros viennent le visiter. Il se souvient d’Élisa Schlésinger, la belle baigneuse de Trouville qui l’éblouit l’année de ses quinze ans, de Louise Colet dont les lettres qu’il lui adressa constituent à elles seules un chef-d’œuvre mais aussi de l’écrivain Alfred Le Poittevin qui fut l’amour de sa vie.
L’œuvre de Régis Jauffret est composée de vingt-cinq ouvrages dont Microfictions, Sévère, La Ballade de Rikers Island et Papa.
MARTIN BUBER, JUDAÏSME
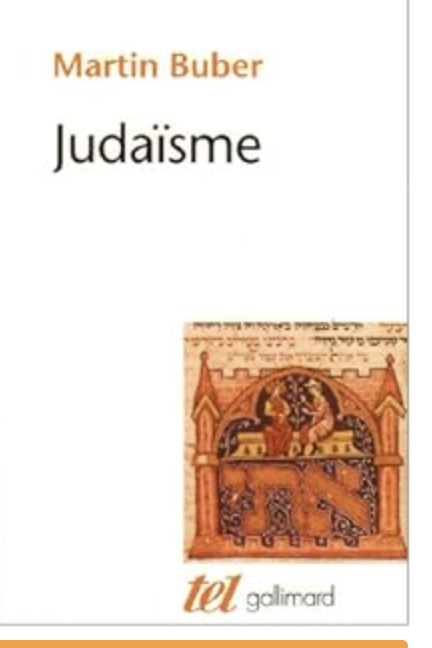
” La tradition est la plus noble des libertés pour la génération qui l’assume avec la conscience claire de sa signification, mais elle est aussi l’esclavage le plus misérable pour celui qui en recueille l’héritage par simple paresse d’esprit. ” À travers ces textes, dont la publication s’échelonne entre 1909 et 1952, Martin Buber s’efforce de penser le judaïsme et, plus précisément, ” le processus spirituel du judaïsme qui s’accomplit dans l’histoire comme un effort vers la réalisation toujours plus parfaite de trois idées connexes: l’idée d’unité, l’idée d’action, l’idée d’avenir ” ; l’idée n’étant pas entendue comme concept abstrait, mais comme force de manifestation de l’être au monde.
JOSE SARAMAGO, L’AVEUGLEMENT

Un homme devient soudain aveugle. C’est le début d’une épidémie qui se propage à une vitesse fulgurante à travers tout le pays. Mis en quarantaine, privés de tout repère, les hordes d’aveugles tentent de survivre à n’importe quel prix. Seule une femme n’a pas été frappée par la “blancheur lumineuse.” Saura-t-elle les guider hors de ces ténèbres désertées par l’humanité ?
FRANCIS SCOTT FITZGERALD, TENDRE EST LA NUIT

Tendre, la nuit ne le fut que brièvement pour les héros de ce roman, chez qui l’on pressent dès le début une fêlure qui laisse présager la chute. L’évolution est implacable, orchestrée par un récit impeccablement construit, efficace et délivré à travers plusieurs points de vue, dont l’alternance est motivée par la présence successive des protagonistes au devant de la scène. Bien plus que le roman autobiographique du couple légendaire Francis Scott et Zelda Fitzgerald, bien plus que la chronique d’une génération d’expatriés dite perdue, ce roman est un paradigme de la quête qui échoue.
De la Côte d’Azur à la Côte d’Azur en passant par la Suisse, cadre d’une évocation nostalgique du passé, les personnages semblent être à peine plus que des fantômes. Gares, cliniques, hôtels… de lieu de transition en lieu de transition, Fitzgerald met en scène un tourbillon de personnages pathétiques et fascinants, arrogants et fragiles, êtres humains voués à demeurer mortels, incapables de prolonger à l’infini le chant divin du rossignol de l’ode de Keats, épigraphe au roman. –Sana Wauters–
JEAN ECHENOZ, L’EQUIPEE MALAISE
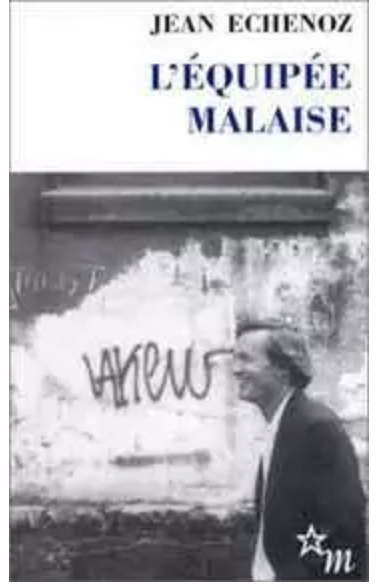
La Malaisie, ce serait la belle vie si le duc Pons ne risquait de s’en voir chassé. Cette idée n’est pas supportable : plutôt que renoncer au pouvoir, au grand air, à ses projets astronomiques, le duc choisit la résistance. D’Europe il va faire venir des renforts, à bord d’un cargo cypriote.
Ces renforts, à Paris, viennent d’affronter des épreuves redoublées, des amours parallèles. Ils n’en peuvent plus. Supérieurement fourbus par le décalage horaire, ils jouent aux dés en attendant d’aller se battre.
TANIZAKI, UN AMOUR INSENSE

Dans le Japon des années vingt, un ingénieur de trente ans, Jôji Kawai, modèle du « type bien », s’éprend d’une jeune serveuse de quinze ans, Naomi, qui rêve de devenir « terriblement moderne ».
L’occidentalisation, cette plaie du Japon moderne, thème majeur de l’œuvre de Tanizaki, fait de Naomi un être irréductiblement cynique, vulgaire, inconstant, dont les roueries et l’érotisme, cependant, fascinent Jôji Kawai. Amoureux, il l’épouse.
SOPHIE NORDMAN, PHILOSOPHIE ET JUDAÏSME

Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas : trois réflexions contemporaines déterminantes pour comprendre la rencontre de la philosophie et du judaïsme. Cette inspiration commune renouvelle de multiples questions : relation de l’éthique à la religion, constitution de la subjectivité, inscription de l’individu au sein de la communauté humaine, sens de l’Histoire… Une telle méditation s’approfondit dans un dialogue constant avec les grandes figures de la pensée juive et de la philosophie moderne et contemporaine : Kant, Hegel, Heidegger, mais aussi Maimonide, Spinoza, Leo Strauss, Martin Buber. A l’horizon se dessine la perspective d’une ” éthique de l’altérité “, qui, hors de toute dogmatique religieuse, ouvre la pensée à l’accueil de la transcendance, de l’Autre, contre tout enfermement de la philosophie contemporaine dans les catégories de l’immanence et du Même.
BOULGAKOV, LE MAITRE ET MARGUERITE
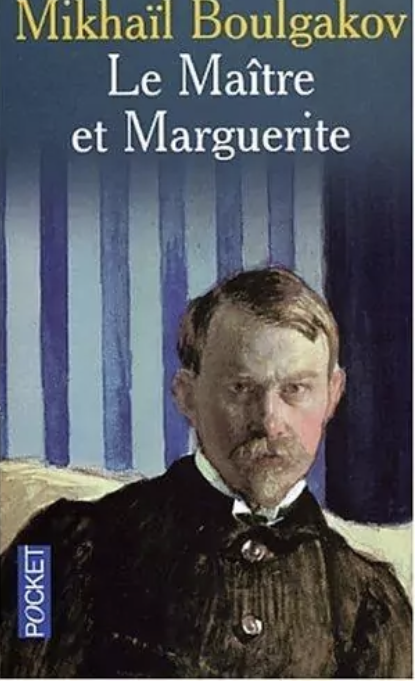
Pour retrouver l’homme qu’elle aime, un écrivain maudit, Marguerite accepte de livrer son âme au diable. Version contemporaine du mythe de Faust, transposé à Moscou dans les années 1930, Le Maître et Marguerite est aussi une des histoires d’amour les plus émouvantes jamais écrites. Mikhaïl Boulgakov a travaillé à son roman durant douze ans, en pleine dictature stalinienne, conscient qu’il n’aurait aucune chance de le voir paraître de son vivant. Écrit pour la liberté des artistes et contre le conformisme, cet objet d’admiration universelle fut publié un quart de siècle après la mort de celui qui est aujourd’hui considéré comme l’égal de Dostoïevski, de Gogol et de Tchekhov réunis.
AGNES DESARTHE, CE COEUR CHANGEANT

Rose Mathissen est la fille d’un officier français et d’une aristocrate danoise. Née à l’aube du XXe siècle, il lui faudra un long détour pour retrouver le manoir familial et découvrir qui elle est vraiment.
Seule à Paris, à 17 ans, Rose est projetée dans un monde qui est aussi bien celui de Zola que de Dickens avant de basculer dans la modernité : l’affaire Dreyfus, la guerre de 14, les années folles, les voitures Panhard-Levassort, la naissance du féminisme… la ville est en ébullition. Rose y trace son chemin, d’une fumerie d’opium à l’appartement de Montparnasse qu’elle partage avec Louise, dont elle est amoureuse. Passant des bas-fonds à la vie de bohême, elle risque à tout moment de tomber. Mais sa vitalité et son idéalisme la protègent. Il lui reste à déchiffrer ce destin dont le sens lui échappe, au point de lui donner parfois le vertige.
Mené tambour battant, ce roman éblouissant marque le retour à la fiction d’Agnès Desarthe, après un essai et un recueil de nouvelles.
JONATHAN COE, LE COEUR DE L’ANGLETERRE, BIENVENUE AU CLUB, LA PLUIE AVANT QU’ELLE TOMBE
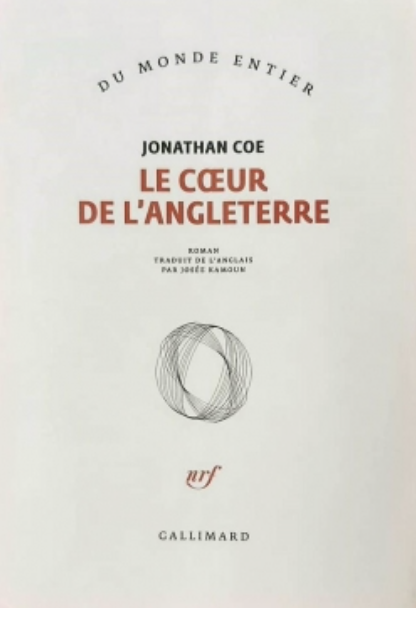
Comment en est-on arrivé là ? C’est la question que se pose Jonathan Coe dans ce roman brillant qui chronique avec une ironie mordante l’histoire politique de l’Angleterre des années 2010. Du premier gouvernement de coalition en Grande-Bretagne aux émeutes de Londres en 2011, de la fièvre joyeuse et collective des Jeux Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le Brexit, Le Cœur de l’Angleterre explore avec humour et mélancolie les désillusions publiques et privées d’une nation en crise.
Dans cette période trouble où les destins individuels et collectifs basculent, les membres de la famille Trotter reprennent du service. Benjamin a maintenant cinquante ans et s’engage dans une improbable carrière littéraire, sa sœur Lois voit ses anciens démons revenir la hanter, son vieux père Colin n’aspire qu’à voter en faveur d’une sortie de l’Europe et sa nièce Sophie se demande si le Brexit est une cause valable de divorce.
Au fil de cette méditation douce-amère sur les relations humaines, la perte et le passage inexorable du temps, le chantre incontesté de l’Angleterre questionne avec malice les grandes sources de crispation contemporaines : le nationalisme, l’austérité, le politiquement correct et les identités.
Dans la lignée de Bienvenue au club et du Cercle fermé, Le Cœur de l’Angleterre est le remède tout trouvé à notre époque tourmentée.

Imaginez ! L’Angleterre des années soixante-dix, si pittoresque, si lointaine, avec ses syndicats prospères et sa mode baba cool. Une image bon enfant que viennent lézarder de sourdes menaces : tensions sociales, montée de l’extrême droite, et une guerre en Irlande du Nord qui ne veut pas dire son nom.
Mais dans ces années où l’État-providence laisse place au thatchérisme, Benjamin, Philip, Doug et leurs amis ont d’autres choses en tête : s’intégrer aux clubs de leur lycée, oser parler aux filles, monter un groupe de musique, s’échapper de Birmingham l’endormie pour des aventures londoniennes… Trop innocents pour saisir les enjeux et les intrigues qui préoccupent leurs parents. Jusqu’à ce que le monde les rattrape.
Dans ce roman foisonnant, premier volet d’un diptyque,
Jonathan Coe renoue avec la veine de Testament à l’anglaise, usant de tous les styles, entremêlant en virtuose récits et personnages, tirant d’une main experte tous les fils du destin, pour nous offrir à la fois un roman d’apprentissage nostalgique, et le tableau ample, grave et lucide d’un pays en pleine mutation.
Traduit de l’anglais par Jamila et Serge Chauvin.
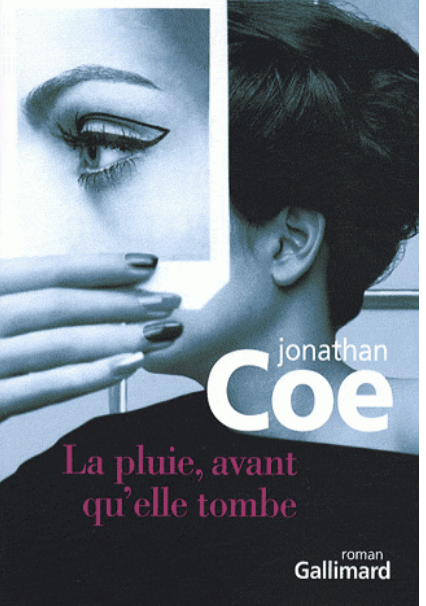
Rosamond vient de mourir, mais sa voix résonne encore, dans une confession enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogen.
S’appuyant sur vingt photos soigneusement choisies, elle laisse libre cours à ses souvenirs et raconte, des années quarante à aujourd’hui, l’histoire de trois générations de femmes, liées par le désir, l’enfance perdue et quelques lieux magiques. Et de son récit douloureux et intense naît une question, lancinante : y a-t-il une logique qui préside à ces existences ?
Tout Jonathan Coe est là : la virtuosité de la construction, le don d’inscrire l’intime dans l’Histoire, l’obsession des coïncidences et des échos qui font osciller nos vies entre hasard et destin. Et s’il délaisse cette fois le masque de la comédie, il nous offre du même coup son roman le plus grave, le plus poignant, le plus abouti.
ITALO CALVINO, LE BARON PERCHÉ

Monté à douze ans dans les arbres, Côme, baron du Rondeau, décide de ne plus jamais en descendre. Nous sommes en 1770. Des années plus tard, toujours perché, il séduira une marquise fantasque et recevra Napoléon en grande pompe.
Autoportrait, conte philosophique, “Le Baron perché” est une éblouissante invention littéraire, où Côme circule au milieu des yeuses comme Calvino dans les lignes.
Une des inventions les plus étonnantes de toute l’histoire de la littérature : comment un enfant monté à douze ans dans les arbres y reste, comment l’homme y passe toute sa vie, pour prouver à ses contemporains ce que c’est que la liberté et l’intelligence et pour leur prouver qu’ils n’agissent, eux, qu’en balourds et à l’étourdie: pas seulement dans leurs rapports à la nature, mais aussi bien dans leurs engagements historiques (nous sommes au temps de la révolution) ou dans leurs amours si dépourvus de fantaisie. Un autoportrait d’un des plus grands écrivains de ce temps : Côme circule dans les yeuses comme Calvino dans les lignes..
STEINBECK, DES SOURIS ET DES HOMMES
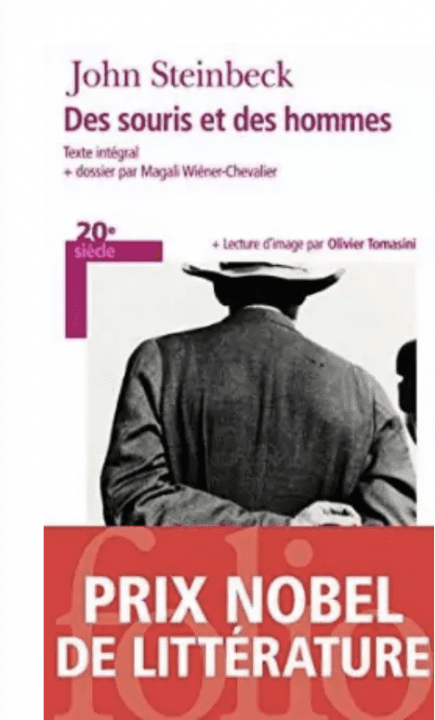
En Californie, dans les années 1930, deux amis travaillent rudement de ranch en ranch pour gagner modestement leur vie en dépit de la crise économique qui sévit dans tout le pays. George est un homme petit à l’esprit vif qui s’est promis de veiller sur Lennie, un grand gaillard simple d’esprit ayant la fâcheuse manie de se fourrer dans le pétrin. Ces deux amis, que tout oppose en apparence, partagent le même rêve : économiser suffisamment pour posséder une petite ferme et y vivre comme des rentiers.Des souris et des hommes conte l’histoire d’une amitié touchante devenue mythique.
FRANÇOISE SAGAN DES BLEUS A L’ÂME

Sébastien et Éléonore, frère et soeur, complices inséparables, la quarantaine proche, se retrouvent à Paris. Également beaux et blonds, comme il se doit, les voici nonchalamment installés dans un meublé de hasard, parfaitement désargentés et parfaitement disponibles. Presque aussitôt, se pressent autour d’eux Nora, une Américaine aussi riche que mûre, Bruno, jeune premier du cinéma français, Robert, un célèbre imprésario… Françoise Sagan nous offre ici ses sentiments, elle nous parle de sa vie et se met en scène comme rarement. Elle utilise le “je” pour justifier ses choix et lui redonne, dans une pirouette finale, son statut romanesque. Une très grande oeuvre.
Qui parle encore de Françoise Sagan ? Qui aime sa phrase, ses nerfs, sa langueur bégayante et rapide ? Ses mots vite avalés de peur d’être entendus, ancrés et immuables ? Ses yeux constamment baissés sur ses lèvres fines qui rêvent d’être pulpeuses et embrasser, dans une fougue inédite l’être à ses côtés dans une décapotable aux ailes un peu froissées par une conduite d’un zigzag éthylique ? Personne ne parle plus de Sagan qu’on laisse, statufiée, dans son adolescente de ce “Bonjour tristesse “.
On a tort. Il faut l’aimer Sagan. Cette femme est un personnage. Ce qui devient rare, tant la femme ne veut plus l’être, de peur d’être nommée. Certes, diront les faux proustiens qui sont de vrais faiseurs, ce n’est pas de la grande littérature, même si elle n’est peut-être pas de gare…Ils ont tort. Lorsque Sagan plonge dans la solitude, le seul vrai sujet de l’écrivain, elle est sublime, d’une plume fulgurante, de celle qui arrache les cœurs et ligote les plexus. J’aime Sagan, n’en déplaise aux faux stendhaliens, aux vrais escrocs du mot.
J’ai repris, récemment, pour tester ma fidélité, son petit essai, vite écrit vers Deauville (“Des bleus à l’âme “).Je n’ai pas été déçu. Alors, immédiatement, j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé une nièce liseuse des Musso et autres Levy, en lui conseillant du Sagan. J’ai, d’emblée, regretté la démarche, un réflexe idiot que je combattais (Sagan pour les jeunes filles). Je viens à l’instant même de recevoir un coup de fil du compagnon de ma nièce qui a suivi le conseil. Il me dit être bouleversé par cette écriture vitaliste (son mot).
Sagan est un écrivain . Une écrivaine si vous voulez, une auteure.
P.S. j’ai failli, emporté par la facilité, intituler mon billet “Aimez-vous Sagan ? “. En référence å son roman d’où est tiré le film avec Ingrid Bergman et Anthony Perkins (“Aimez vous Brahms ?”) et sa musique qui fait pleurer les adolescents sentimentaux. Trop facile. MB
E.M FORSTER, HOWARDS END
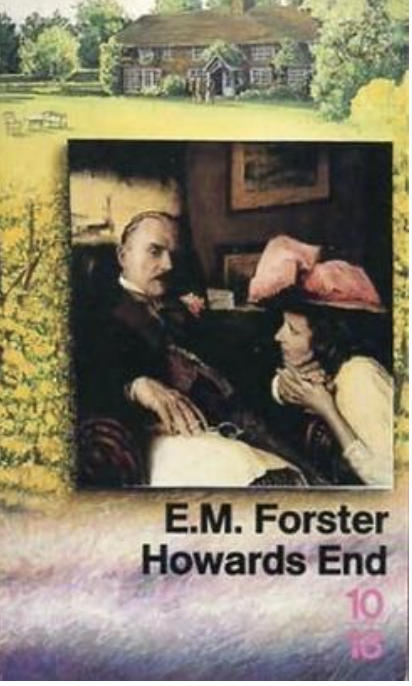
Observateur subtil de la société britannique, E. M. Forster n’a peut-être jamais mieux décrit les antagonismes et les entrelacs d’intérêts entre aristocratie et bourgeoisie que dans Howards End. Dans cette histoire d’héritage et de remariage s’affrontent deux familles, les Schlegel et les Wilcox, et à travers eux deux visions du monde. A la veille de la Première Guerre mondiale, la société victorienne se fissure et les idées féministes et progressistes gagnent du terrain, malgré la résistance aveugle et hautaine des tenants de la tradition. Comme le montre habilement et cruellement ce roman indémodable, cette opposition brutale destinée à façonner la société du XXe siècle ne se déroulera pas sans faire de victimes.
JAROSLAV HASEK, LE BRAVE SOLDAT CHVEIK
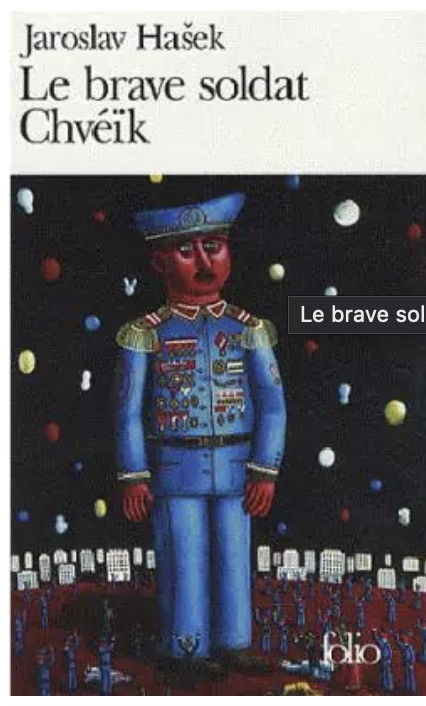
Le brave soldat Chvéïk (Dobrý voják Švejk) est un roman satirique inachevé de l’écrivain tchèque Jaroslav Hašek (1883-1923), publié en quatre tomes de 1921 à 1923. Les trois premiers tomes sont intégralement de l’auteur, tandis que le quatrième a dû être achevé après sa mort par son ami Karel Vanek.
L’œuvre relate sur le mode de l’absurde et du grotesque les pérégrinations de Josef Chvéïk, brave Tchèque de Prague vivant à l’époque de la Grande Guerre, sous la domination austro-hongroise.
GABRIEL GARCIA MARQUEZ, L’AMOUR AU TEMPS DU CHOLERA
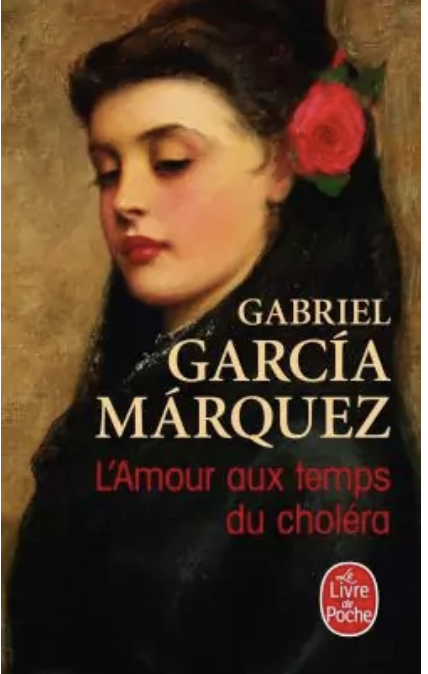
Dans une petite ville des Caraïbes, à la fin du siècle dernier, un jeune télégraphiste, pauvre, maladroit, poète et violoniste, tombe amoureux fou de l’écolière la plus ravissante que l’on puisse imaginer. Sous les amandiers d’un parc, il lui jure un amour éternel et elle accepte de l’épouser. Pendant trois ans, ils ne feront que penser l’un à l’autre, vivre l’un pour l’autre, rêver l’un de l’autre, plongés dans l’envoûtement de l’amour. Jusqu’au jour où l’éblouissante Fermina Daza, créature magique et altière, irrésistible d’intelligence et de grâce, préfèrera un jeune et riche médecin, Juvenal Urbino, à la passion invincible du médiocre Florentine Ariza. Fermina et Juvenal gravissent avec éclat les échelons de la réussite en même temps qu’ils traversent les épreuves de la routine conjugale.
Florentine Ariza, repoussé par Fermina Daza, se réfugie dans la poésie et entreprend un carrière de séducteur impénitent et clandestin. Toute sa vie, en fait, n’est tournée que vers un seul objectif : se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu’il ne cessera jamais d’aimer en secret et avec acharnement chaque instant de chaque jour pendant plus d’un demi siècle.
L’Amour aux temps du choléra est le grand roman tant attendu de García Márquez, aussi fondamental dans son œuvre que Cent ans de solitude dont il forme le vrai pendant.
KAFKA, LA METAMORPHOSE

La Métamorphose révèle une vérité méconnue, les conventions disparaissent, les masques tombent. Le récit qui porte ce titre est un des plus pathétiques et des plus violents que Kafka ait écrits ; les effets en sont soulignés à l’encre rouge, les péripéties ébranlent les nerfs du lecteur. C’est l’histoire, «excessivement répugnante», dit l’auteur, d’un homme qui se réveille changé en cancrelat. Cette transformation est un châtiment imaginaire que Kafka s’inflige. Et son personnage est celui qui ne peut plus aimer, ni être aimé : le conflit qui se déroule dans une famille bourgeoise prend une ampleur mythique. Seuls quelques éléments comiques ou grotesques permettent de libérer de l’oppression du cauchemar.
LILAN KUNDERA, L’IDENTITE
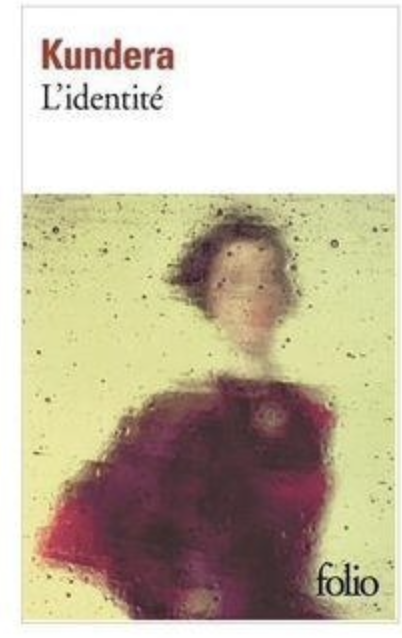
Car tel est bien l’amour de Jean-Marc et Chantal : un espace aménagé en marge du monde, à l’écart de la vie, contre la vie, en fait, et donc ” une hérésie, une transgression des lois non écrites de la communauté humaine “.
François Ricard
Autre présentation:
Confondre l’apparence physique de l’aimée avec celle d’une autre. Combien de fois il a déjà vécu cela ! Toujours avec le même étonnement : la différence entre elle et les autres est-elle donc si infime ? Comment se peut-il qu’il ne sache pas reconnaître la silhouette de l’être le plus aimé, de l’être qu’il tient pour incomparable ?
JOHN IRVING HOTEL NEW HAMPSCHIRE
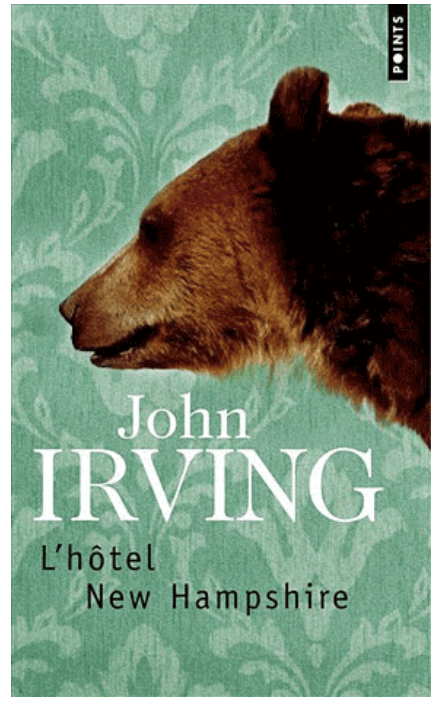
Rarement une voix avait su captiver l’imagination des lecteurs et des critiques comme celle de John Irving, dans le Monde selon Garp, son premier roman traduit en français. Une fois encore, avec son nouveau livre, l’Hôtel Nezv Hampshire, chacun se laisse envelopper et séduire par un univers tout aussi étrange et désarmant : celui de l’excentrique famille Berry.
Car, comme l’explique John – narrateur et troisième rejeton de cette famille qui comprenait cinq enfants, un ours et un chien nommé Sorrow : « Notre histoire favorite concernait l’idylle entre mon père et ma mère : comment notre père avait fait l’acquisition de l’ours; comment notre père et notre mère s’étaient retrouvés amoureux et, coup sur coup, avaient engendré Frank, Franny et moi-même (« Pan, Pan, Pan!» disait Franny) — puis, après un bref intermède, Lily et Egg (« Paff et Pschitt! » disait Franny).
C’est ainsi que la voix de John Berry, tour à tour nostalgique et passionnée, nous relate son enfance et celle de ses frères et sœurs dans trois hôtels et sur deux continents différents. « La première des illusions de mon père était que les ours peuvent survivre à la vie que mènent les humains, et la seconde que les humains peuvent survivre à la vie que l’on mène dans les hôtels. » Ce qu’il advint des rêves de Win Berry et comment ces rêves influèrent sur la destinée de ses enfants, tel est le sujet de ce roman grave et hilarant dû à « l’humoriste américain le plus important de ces dix dernières années », selon les termes de Kurt Vonnegut.
ISAAC BASHEVIS SINGER, LA FAMILLE MOSKAT
Publié pour la première fois aux Etats-Unis en 1950, La famille Moskat fut accueilli comme un authentique chef-d’oeuvre, opinion qui n’a fait que se renforcer au fil des années.
Située en Pologne de 1914 à 1939, cette grande “saga” retrace l’histoire d’une riche famille de Varsovie, d’abord unie sous l’autorité de son patriarche qui maintient chacun dans l’ordre établi. Mais au fil des années, sous l’influence des idées nouvelles, à travers des mariages mixtes, à travers aussi l’attrait du communisme naissant, les différents personnages vont se disperser et le clan se désagréger.
Deux caractères exceptionnels dominent: Abraham Shapiro, jouisseur, coureur, défiant toute morale, mais partisan du statu quo, qui meurt d’une crise cardiaque dans le lit d’une servante. Et son opposé, Asa Heschel qui recherche, lui, la perfection à travers le changement. fragile et passionné, héros d’une poignante histoire d’amour, Asa Heschel est un personnage particulièrement cher à Isaac Bashevis Singer,- et dont on peut supposer qu’il ressemble beaucoup à ce que fut son auteur à la même époque.
Et pui survient la tourmente dont on sait qu’elle détruira tout sur son passege….
“Le monde décrit par I.B.singer a disparu, devasté par la plus violente de toutes les calamités qui se soient abattues sur les juifs. Mais il revit dans ses souvenirs et dans l’ensemble de son oeuvre”, ont déclaré les jurés du Prix Nobel, en couronnant cette oeuvre exceptionnelle, à la fois, ont-ils ajouté, “très humaine et représentatibe de toute l’humanité”.
NICOLAS BOUVIER, L’USAGE DU MONDE

A l’été 1953, un jeune homme de vingt-quatre ans, fils de bonne famille calviniste, quitte Genève et son université, où il suit des cours de sanscrit, d’histoire médiévale puis de droit, à bord de sa Fiat Topolino.
Nicolas Bouvier a déjà effectué de courts voyages ou des séjours plus longs en Bourgogne, en Finlande, en Algérie, en Espagne, puis en Yougoslavie, via l’Italie et la Grèce. Cette fois, il vise plus loin : la Turquie, l’Iran, Kaboul puis la frontière avec l’Inde.
Il est accompagné de son ami Thierry Vernet, qui documentera l’expédition en dessins et croquis.
Ces six mois de voyage à travers les Balkans, l’Anatolie, l’Iran puis l’Afghanistan donneront naissance à l’un des grands chefs-d’oeuvre de la littérature dite « de voyage », L’Usage du monde, qui ne sera publié que dix ans plus tard et à compte d’auteur la première fois avant de devenir un classique.
Par son écriture serrée, économe de ses effets et ne jouant pas à la « littérature », Nicolas Bouvier a réussi à atteindre ce à quoi peu sont parvenus : un pur récit de voyage, dans la grande tradition de la découverte et de l’émerveillement, en même temps qu’une réflexion éthique et morale sur une manière d’être au monde parmi ses contemporains, sous toutes les latitudes.
ROGER NIMIER, LE HUSSARD BLEU

Le livre insolent, romantique et tendre qui rendit Nimier célèbre à vingt-cinq ans. Le roman qui fit école et donna naissance à la génération littéraire des « hussards ». La chronique intime, à la fois cynique et sentimentale, d’un peloton de hussards qui pénètre en Allemagne, en 1945.
SUSKIND, LE FUM

Au XVIIIème siècle vécut en France un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque.
Il s’appelait Jean-Baptiste Grenouille.
Sa naissance, son enfance furent épouvantables et tout autre que lui n’aurait pas survécu.
Mais Grenouille n’avait besoin que d’un minimum de nourriture et de vêtements, et son âme n’avait besoin de rien. Or ce monstre de Grenouille avait un don, ou plutôt un nez unique au monde, et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l’univers, car “qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes”.
C’est son histoire abominable… et drolatique, qui nous est racontée dans Le Parfum, un best-seller mondial.
JEAN-LUC ALLOUCHE, LE ROMAN DE MOÏSE

Moïse sauvé des eaux, prince à la cour de Pharaon, berger compatissant, libérateur des Hébreux, interlocuteur privilégié de Dieu, guide des Enfants d’Israël vers la Terre promise où il n’entrera jamais… Peu de vies de héros ont été si pleines de péripéties, de drames, de tensions. La littérature, les arts, et jusqu’au cinéma se sont saisis de la personnalité de Moïse pour nous livrer une palette infinie de visions du plus grand des prophètes.
Fasciné par le seul homme ayant « connu Dieu face à face », Jean-Luc Allouche a voulu réécrire l’histoire du plus malheureux des hommes. Et du Moïse à « la langue embarrassée », il a fait un contestataire à la langue bien pendue devant l’arbitraire divin. Dans ce livre passionnant, nourri notamment du Midrach, ce trésor « romanesque » des commentaires des Sages, Jean-Luc Allouche ajoute sa part de fiction et révèle un Moïse inédit, dépouillé de tout cliché.
MB : Dieu n’a pas d’associé (sur le bouquin d’Allouche)

Ancien rédacteur en chef à Libération et correspondant de ce journal à Jérusalem, Jean-Luc Allouche a un vrai culot. Avoir du culot, ce n’est pas entrer sans frapper dans le bureau du patron pour obtenir une augmentation ou se planter tous les soirs devant la porte de la femme qu’on désire pour, sans un mot, lui offrir des fleurs, ou encore se permettre de s’inviter à la soirée magnifique de laquelle l’on est chassé, du fait de son trop grand toupet. Non, avoir du culot, c’est, au crépuscule d’une vie, s’attaquer à Dieu lequel (l’on ne sait jamais) peut se tapir dans un coin du ciel le jour où (l’on ne sait toujours pas) il cueillera votre âme. Surtout quand on le dit (c’est le cas d’Allouche) presque sans pitié et imbu de lui.
Donc, Allouche a un vrai culot lorsqu’il nous décrit, dans son dernier bouquin (Le roman de Moïse. Albin Michel. 2018) un Dieu irritable, colérique, injuste, caractériel. Il avoue, au demeurant que “ce Dieu de la Bible n’est pas à mon goût”. Ce Dieu, sans figure en prend plein la sienne, si la matière se prêtait à un mauvais jeu de mots.
Allouche a donc écrit un “roman de Moïse”, en collant au texte biblique, l’agrémentant des commentaires du Talmud du Midrach, des grands commentateurs et pas seulement Rachi ou Maimonide… Le bouquin est passionnant, magnifiquement écrit, documenté. Et l’on sent, sous la plume, des vibrations pas toujours positives, qui vont de la colère envers ce Dieu querelleur jusqu’à la caresse sur les lèvres bégayantes de Moïse.
On ne peut raconter, il faut lire ce long bouquin qui a accompagné plusieurs nuits, transformant l’épisode biblique en un roman qui est celui de la guerre (le mot n’est pas trop fort) entre Dieu et le peuple qu’il a fait sortit d’Egypte pendant ces quarante années d’errance dans la colère des deux (le peuple et Dieu s’affrontant), entre Dieu et Moïse qui implore le pardon pour ledit peuple et la vie pour lui, pour lui permettre d’entrer dans le pays promis, terre de lait et de miel. Dieu, malgré les supplications de tous ses anges, de tous ses cieux ne fléchira pas.
Je colle ici le dernier paragraphe du bouquin :
“Allons, une ultime pirouette inspirée par ce merveilleux magicien de l’hébreu, et longtemps homme politique courageux, feu Yossi Sarid, à qui j’emprunte cette citation :
« Moïse n’aurait pas dû mourir. Sa santé était relativement bonne, compte tenu de son âge : “Son regard ne s’était point terni, et sa vigueur n’était point épuisée.” Mais Dieu, lui aussi, se préoccupe de son statut et n’est pas du tout disposé à partager le crédit de ses actes avec d’autres : c’est lui qui nous a fait sortir d’Égypte, qui a fendu la mer en deux pour nous, et a couvert tous nos besoins dans le désert. Dieu n’a pas d’associé.
Donc, Allouche a du culot ? A vrai dire, pas vraiment. C’est Dieu qui en a, en ne sombrant pas dans l’amour et le bon sentiment, affirmant sa prééminence, sans se départir de la parole première. Si Dieu n’avait pas eu ce culot, l’on aurait basculé dans une autre religion, celle de notre ère. Celle qui prétend abolir les sentiments et les contradictions, pour les fondre dans la béatitude de l’amour plat et mièvre.
Le judaïsme admet la colère de Dieu. Mieux, il ne saurait se reproduire sans la crainte de cette colère, du type, légitime, qu’a généré la fabrication du veau d’or. La colère justifiée est bonne. Je vais le dire à Allouche, pour le consoler : son culot est à la mesure de celui de Dieu. Et s’il ne peut être un associé, il est, lui, Allouche, image de Dieu, un bon collaborateur, à l’image de son créateur qui n’est pas qu’amour. Qui est unique,sans nom, et pourtant multiple. Sephirot… L’unique et son pluriel, dirait je ne sais qui.
Relisez. Tout sauf du petit blasphème d’athée de service.
MENDELSSOHN, LES DISUS
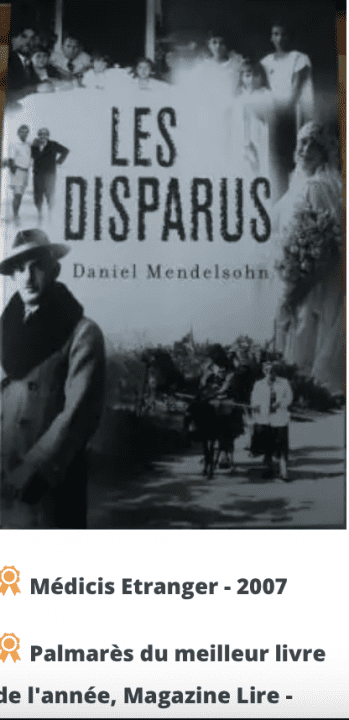
Depuis qu’il est enfant, Daniel Mendelsohn sait que son grand-oncle Shmiel, sa femme et leurs quatre filles ont été tués, quelque part dans l’est de la Pologne, en 1941. Comment, quand, où exactement ? Nul ne peut lui en dire plus. Et puis il découvre ces Lettres désespérées écrites en 1939 par Shmiel à son frère, installé en Amérique, des lettres pressant sa famille de les aider à partir, des lettres demeurées sans réponse…
Parce qu’il a voulu savoir ce qui s’est passé, parce qu’il a voulu donner un visage à ces six disparus, Daniel Mendelsohn est parti sur leurs traces, rencontrant, année après année, des témoins épars dans une douzaine de pays. Cette quête, il en a fait un livre, puzzle vertigineux, roman policier haletant, plongée dans l’Histoire et l’oubli – un chef-d’œuvre.
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Guglielmina.
PHILIPPE CLAUDEL, LES AMES GRISES

Une jeune enfant est retrouvée morte, assassinée sur les berges engourdies par le gel d’un petit cours d’eau. Nous sommes en hiver 1917.
C’est la Grande Guerre. La boucherie méthodique. On ne la voit jamais mais elle est là, comme un monstre caché. Que l’on tue des fillettes, ou que des hommes meurent par milliers, il n’est rien de plus tragiquement humain.
Qui a tué Belle de Jour ? Le procureur, solitaire et glacé, le petit Breton déserteur, ou un maraudeur de passage ?
Des années plus tard, le policier qui a mené l’enquête, raconte toutes ces vies interrompues: Belle de jour, Lysia l’institutrice, le médecin des pauvres mort de faim, le calvaire du petit Breton… Il écrit avec maladresse, peur et respect. Lui aussi a son secret.
Les âmes grises sont les personnages de ce roman, tout à la fois grands et méprisables. Des personnages d’une intensité douloureuse dans une société qui bascule, avec ses connivences de classe, ses lâchetés et ses hontes.
La frontière entre le Bien et le Mal est au cœur de ce livre d’une tension dramatique qui saisit le lecteur dès les premières pages et ne faiblit jamais. Jusqu’à la dernière ligne.
DORIS LESSING, LES GRANDS-MERES
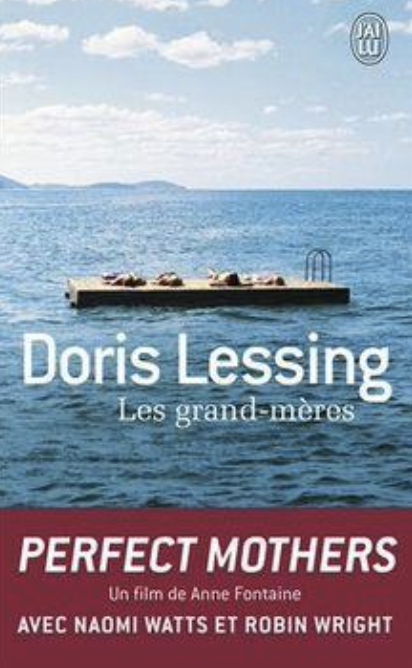
Un été au bord de la mer.
Deux familles apparemment sans histoires se prélassent au soleil : Roz et Lil, deux femmes mûres mais encore belles, leurs fils, deux hommes séduisants dans la force de l’âge, et leurs charmantes petites-filles tout occupées à leurs jeux d’enfants. Depuis toujours Roz et Lil sont aussi inséparables que des soeurs jumelles, et l’affection qu’elles se portent s’est doublée peu à peu d’un amour pour le moins trouble de chacune pour le fils de l’autre.
Ce jour-la les règles du jeu vont changer. Mais qui a vraiment les cartes en main. A 86 ans, Doris Lessing signe un texte sulfureux et dérangeant sur des amours scandaleuses. Roman du non-dit et de la dissimulation, Les Grand-mères fait résonner haut et fort la plume de la grande dame des lettres anglaise
VARGAS LLOSA, QUI A TUE PALOMINO ?

Le corps d’un jeune homme affreusement mutilé, accroché à un arbre, a été découvert par un jeune chevrier. L’enquête conduit le lieutenant Silva et le sergent Lituma dans l’univers préservé d’une base militaire dirigée par le colonel Mindreau, et dans le labyrinthe de la petite ville de Talara organisée autour de la gargote de Dofia Adriana. D’un côté, le monde secret de l’armée, de l’autre toute une population haute en couleur, pitoyable, mesquine, truculente. Qui, dans tout cela, a tué Palomino Molero?
Au suspense sans faille d’un véritable roman policier, Mario Vargas Llosa greffe une rigoureuse analyse des problèmes sociaux du Pérou et une dénonciation ironique, implicite, des mécanismes du pouvoir.
DASHIELL HAMMETT, LA MOISSON ROUGE

Depuis que le maire Elihu Willsson leur a demandé de l’aide pour briser les grèves de mineurs, les truands règnent en Maîtres à Personville. Son fils Don, patron de presse fait appel au célèbre détective de l’agence Continental pour y mettre un terme. Mais Don est assassiné avant d’avoir pu lui parler… Avec des méthodes aussi expéditives que celles des criminels, le détective s’emploie alors à nettoyer la ville gangrenée par la corruption, le chantage et le vice.
PHILIP ROTH NEMESIS
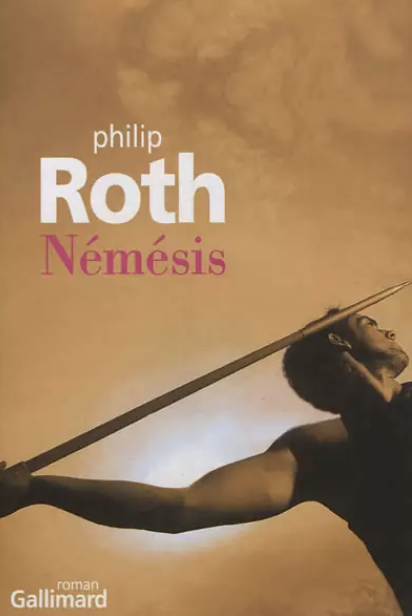
C’est le long et chaud été de 1944 dans le quartier Weequahic de Newark. La plupart des jeunes hommes du pays sont engagés à l’étranger, mais Bucky Cantor, un muscle-bound, instructeur de 23 ans PE, est coincé à la maison à cause de ses yeux louches. Au lieu d’aider son pays dans la lutte contre Hitler, son travail pour l’été est de superviser le bien-être d’un groupe d’enfants, en tant que directeur de l’un des terrains de jeux de la ville. C’est à peine le rôle glorieux qu’il voulait pour lui-même, mais Bucky, qui a un sens profond de l’honneur, se rapproche de ses fonctions – du moins au début – avec un dévouement inlassable.
PIERRE LOTI, LES DESENCHANTEES

Dans ce roman, Loti l’amoureux d’Istanbul se fait la voix des femmes, les femmes des harems, dans les toutes dernières heures de l’Empire ottoman.
Trois femmes de la haute société entrent en contact avec André Lhéry, un écrivain et diplomate français en poste dans l’ancienne Constantinople. Des échanges complexes, passionnés et violents naissent entre l’auteur et ces femmes encore prisonnières de leurs voiles et d’un mode de vie carcéral. Un livre captivant et troublant.
«Et elles lui tendirent des petites mains gantées de blanc. Elles parlaient du reste français avec des voix très douces et une aisance parfaite, ces deux nouvelles ombres.
– Nos amies nous ont annoncé, dit l’une, que vous alliez écrire un livre en faveur de la musulmane du XXe siècle, et nous avons voulu vous en remercier.
– Comment cela s’appellera-t-il ? demanda l’autre, en s’asseyant avec une grâce languissante sur l’humble divan décoloré.
– Mon Dieu, je n’y ai pas songé encore. C’est un projet si récent, et pour lequel on m’a un peu forcé la main, je l’avoue… Nous allons mettre le titre au concours, si vous voulez bien… Voyons !… Moi, je proposerais : Les Désenchantées.
– « Les Désenchantées », répéta Djénane avec lenteur. On est désenchanté de la vie quand on a vécu ; mais nous au contraire qui ne demanderions qu’à vivre !… Ce n’est pas désenchantées, que nous sommes, c’est annihilées, séquestrées, étouffées…»
